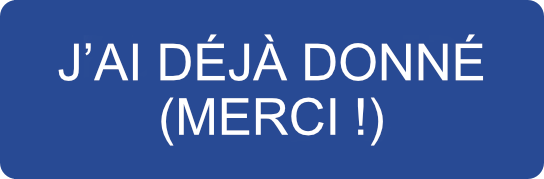Graphisme : Afrique XXI
Morose et délaissée pendant longtemps, c’est une ville dont l’éclat actuel ne peut passer inaperçu : située au centre du pays, l’ancienne capitale coloniale, Gitega, est devenue la capitale politique du Burundi en 2019. Elle est aussi et surtout la ville d’où est originaire l’actuel président de la République, Evariste Ndayishimiye. Gitega semble aujourd’hui profiter de plusieurs effets combinés, historico-politiques et géographiques, avec la construction de nouveaux hôtels un peu partout, l’ouverture de nouveaux business (particulièrement les magasins de matériaux de construction), dans le bruit quotidien des sirènes qui se relaient pour forcer le passage d’un ministre qui va à une conférence, d’un haut gradé de l’armée qui va visiter sa ferme, ou d’une haute autorité du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, de retour d’un meeting politique.
Le doute sur ce rayonnement s’installe quand le regard se détourne des grands chantiers de construction et se dirige vers les simples citoyens, dans les rues ou sur les collines. Nous sommes devant Matergo, l’un des nouveaux hôtels les plus prisés de la ville, où se succèdent autorités, diplomates, hommes d’affaires.... Deux véhicules sont garés côte à côte, trappes de carburant ouvertes. Un homme placé entre les deux en vide un pour en remplir un autre. « Le deal doit être intéressant, susurre un passant. L’acheteur lui a peut-être proposé cinq fois le prix normal, voire plus. C’est le nouveau business ici, si tu as une voiture. Tu fais la queue durant des jours à une station et si tu as la chance d’avoir le carburant, tu le revends à quelqu’un qui n’a pas ce courage. C’est cela le Burundi aujourd’hui. Mon pays va vraiment mal ! », poursuit l’homme en tournant la tête à droite et à gauche, pour s’assurer que ses propos ne tombent pas dans une oreille indiscrète.
Sa sécurité en dépend. Au Burundi, même les rues semblent désormais avoir des oreilles. Dire que le pays va mal, que la vie des citoyens est au point mort à cause d’une pénurie généralisée de carburant qui dure depuis plus de trois ans, c’est défier le narratif officiel, celui d’un pays où coulent le lait et le miel. En effet, il ne peut y avoir que de la joie dans « le jardin d’Eden », ainsi qu’Evariste Ndayishimiye a courageusement baptisé le Burundi.
Un régime paranoïaque
Gitega est une ville sous haute surveillance. Comme tout le pays d’ailleurs. Les élections législatives et communales du 5 juin se sont déroulées dans un contexte de verrouillage politique : la plupart des opposants politiques sont en exil depuis dix ans, et ceux qui sont restés au pays sont presque tous neutralisés. Résultat : le CNDD-FDD s’est assuré 100 % des sièges à l’Assemblée nationale, un score à la nord-coréenne jusque-là jamais atteint par aucun autre parti depuis l’introduction du multipartisme, dans les années 1990.
Dans les rues, la tension est palpable. Les centaines de jeunes du parti au pouvoir, les Imbonerakure, qualifiés de milice par les Nations unies1, en jogging, parfois armés et en treillis, scandent des chants martiaux, quand la police procède à des contrôles minutieux. Les rumeurs de rebelles burundais qui se seraient infiltrés dans le pays vont bon train. La police cherche des caches d’armes sous les sièges des voitures, dans les coffres, partout. Il faut ajouter le contexte régional avec le mouvement rebelle M23 (soutenu par le Rwanda, selon plusieurs rapports de l’ONU) aux portes de Bujumbura, la capitale économique du Burundi. La rébellion contrôle déjà la ville de Bukavu, en plus de Goma, capitales respectives du Sud-Kivu et du Nord-Kivu, qui forment la province de l’est de la RD Congo. Bukavu n’est qu’à quatre heures de route de Bujumbura.
Le régime burundais, dont les relations diplomatiques avec le Rwanda sont exécrables depuis presque dix ans, craint une exportation de la guerre de l’est de la RD Congo sur son sol. La menace n’a jamais été aussi forte depuis 2015, quand des centaines de milliers de Burundais avaient pris le chemin de l’exil, après la décision de Pierre Nkurunziza (décédé en 2020) de briguer un troisième mandat et la crise politique qui en avait découlé. Le Rwanda avait accueilli une bonne partie des réfugiés. Depuis, le régime burundais accuse constamment Kigali d’héberger des rebelles qui veulent le renverser.
Le risque d’un effondrement politique
Curieusement, on ne cherche pas que des armes. La bière est aussi ciblée. Mais pas n’importe laquelle : la Primus et/ou l’Amstel, des produits de la Brarudi, la principale et plus ancienne brasserie du pays. Tout comme le carburant, trouver la bière de la Brarudi c’est chercher une aiguille dans une botte de foin. Celle qui a été la boisson de monsieur Tout-le-Monde durant des décennies, la plus accessible jusque dans les coins les plus reculés du pays, est devenue un produit de luxe qu’on ne trouve que dans les grands hôtels. Et l’État s’est donné la rude tâche de réguler sa distribution. « La pénurie de carburant aura un impact sur les résultats des urnes, parce que le peu de carburant revient au parti au pouvoir pour faire campagne. C’est le cas aussi pour la bière, témoigne un journaliste qui a suivi la campagne électorale. À Bururi, dans le sud du pays, je suis allé au bar pour m’acheter une bière, tout près de là où le CNDD-FDD tenait un meeting. On m’a signifié que toutes les boissons disponibles dans la localité avaient été prises par le parti au pouvoir. »
La Brarudi, plus grand contribuable du pays (on parlait de 68 milliards de francs burundais d’impôts en 2024, soit plus de 19,8 millions d’euros), annonçait l’an dernier manquer de malt, matière première indispensable à la fabrication de ses boissons, et ce, à cause d’un « manque de devises ». Le Burundi, classé deuxième pays le plus pauvre du monde juste devant le Soudan du Sud, n’avait que l’aide internationale, principalement de l’Union européenne, comme principale source de devises. Cet appui s’est arrêté en 2016 à la suite du refus du régime de dialoguer avec ses opposants.
Avec une économie nationale à l’agonie (87 % de la population vit avec moins de 1,6 euro par jour, selon la Banque mondiale), des problèmes de bonne gouvernance, notamment des cas de grande corruption et de détournements dont on ignore toujours l’ampleur exacte (fin 2023, lors de sa condamnation à perpétuité pour tentative de coup d’État, on apprenait2 qu’Alain-Guillaume Bunyoni, l’ancien Premier ministre, possédait à lui seul près de 150 maisons, rien qu’au Burundi), combinés à un contexte politique instable, le régime d’Évariste Ndayishimiye, miné par des guerres intestines entre de puissants généraux, semble aujourd’hui faire face à un double risque : un effondrement économique du pays et son propre effondrement politique.
« Les jeunes fuient tous azimuts le pays »
Pour la population, l’enjeu dépasse la survie économique, comme l’explique un analyste qui a requis l’anonymat :
Les Burundais sont en principe habitués à vivre du peu qu’ils ont. Le Burundi n’a jamais été un pays développé avec toute l’abondance qui va avec. Mais cela n’a jamais été vu comme la fin du monde par la population locale. Aujourd’hui, le grand défi est que le pays devient de plus en plus invivable. Plus d’espoir d’avenir pour les jeunes qui fuient tous azimuts le pays. Il n’y a pas très longtemps, c’était inconcevable de voir un homme avec des petits-enfants laisser sa famille derrière lui et quitter le pays. Les Burundais sont très attachés à la famille. Malheureusement, son tissu se déchire de plus en plus. Le régime a infiltré jusqu’à la cellule familiale. On souffre, on ne peut même pas en parler, même pas chez soi. L’espionnage est arrivé jusque dans les ménages.
« Les jeunes qui fuient tous azimuts le pays » est peut-être le plus inquiétant pour l’avenir de ce petit pays d’Afrique de l’Est de 13 millions d’habitants et dont 65 % de la population a moins de 25 ans3. L’exode ne s’est pas tari depuis la répression sanglante contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza, il y a dix ans. Aujourd’hui, les grandes capitales régionales, Kigali, Kampala, Nairobi, grouillent de jeunes Burundais, parfois encore des enfants. Deux médias locaux consacraient en février dernier une édition spéciale pour alarmer sur un taux d’abandon scolaire historique de 70 %, citant les « plus de 4 500 élèves » qui ont décroché, en seulement trois mois, dans une seule province, Kayanza (nord du Burundi), durant l’année scolaire 2024-2025.
20 000 départs entre janvier et octobre 2022
Ces mêmes jeunes, qui ne croient plus à ce que peut leur apporter l’école (au Burundi, on dit que la carte de membre du parti au pouvoir vaut désormais mieux qu’un diplôme), déambulent aujourd’hui jusque dans les collines rurales du Kenya, parfois sans aucun document légal, vendant des arachides et des beignets aux passants. L’un d’eux explique : « Ce business nous permet au moins d’envoyer quelque chose à nos familles qui vivent dans une misère sans nom au Burundi. » Il affirme pouvoir envoyer au moins 3 000 shillings kényans par mois (environ 20 euros, soit plus que ce que gagnent certains fonctionnaires de l’État au Burundi). Les jeunes filles sont envoyées dans les pays arabes via des agences intermédiaires dont certaines appartiennent à des responsables du parti au pouvoir. D’autres jeunes encore, par dizaines de milliers, surtout issus de familles plus aisées, ont migré vers l’Europe via la Serbie (VOA Afrique avançait4 un chiffre de 20 000 départs entre janvier et octobre 2022.). Des milliers de médecins sans emploi ont fui à la recherche de travail dans les pays voisins. Pour rappel, le Burundi disposait de 0,1 médecin pour 1 000 habitants en 2020, dix fois moins que le minimum recommandé par l’Organisation mondiale de la santé.
Pendant la campagne électorale, face à la misère presque généralisée, le président de la République a dû sortir l’artillerie lourde pour essayer de convaincre les foules : le 15 mai, il a garanti 1 million de francs à chaque Burundais d’ici à deux ans. Il était à Gitega, dans sa ville. Sauf que ce million de francs burundais (environ 291 euros), d’ici-là, aura peut-être perdu plus de deux fois sa valeur actuelle si l’économie continue à se détériorer. La promesse sera-t-elle tenue ? En 2020, quand il a pris le pouvoir, il avait prononcé presque les mêmes mots, promettant « de l’argent dans chaque poche ». Cinq ans plus tard, les Burundais doivent-ils encore le croire ? Le pays a davantage besoin de secours que de promesses.
Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables) :
Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables).
 Faire un don
Faire un don
Les articles présentés sur notre site sont soumis au droit d’auteur. Si vous souhaitez reproduire ou traduire un article d’Afrique XXI, merci de nous contacter préalablement pour obtenir l’autorisation de(s) auteur.e.s.
1Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, « Les violences croissantes d’une milice “pourraient faire basculer le Burundi” », 9 juin 2015, à lire ici.
2Jean Noël Manirakiza et Abbas Mbazumutima, « Affaire Bunyoni : perpétuité requise pour l’ancien Premier ministre et saisie de ses biens », Iwacu Burundi, 10 novembre 2023, à lire ici.
3Cécile Leclerc-Laurent, « Jeunes et pauvres au Burundi », Secours catholique, 10 septembre 2024, disponible ici.
4Geoffrey Mutagoma et Pierre Claver Niyonkuru, « La Serbie met fin à l’entrée sans visa des ressortissants burundais », VOA Afrique,
24 octobre 2022, à lire ici.
5Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, « Les violences croissantes d’une milice “pourraient faire basculer le Burundi” », 9 juin 2015, à lire ici.
6Jean Noël Manirakiza et Abbas Mbazumutima, « Affaire Bunyoni : perpétuité requise pour l’ancien Premier ministre et saisie de ses biens », Iwacu Burundi, 10 novembre 2023, à lire ici.
7Cécile Leclerc-Laurent, « Jeunes et pauvres au Burundi », Secours catholique, 10 septembre 2024, disponible ici.
8Geoffrey Mutagoma et Pierre Claver Niyonkuru, « La Serbie met fin à l’entrée sans visa des ressortissants burundais », VOA Afrique,
24 octobre 2022, à lire ici.