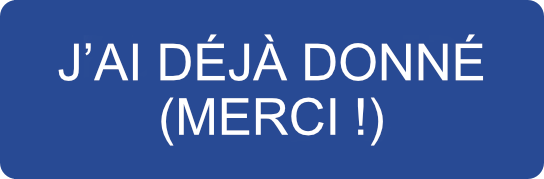Au cours d’un dîner informel à Genève en 2025, le politologue Jean-François Bayart, avec la lucidité ironique qui lui est coutumière, proposait une formule saisissante pour caractériser la scène politique camerounaise : un « État-Ehpad ». Par cette expression, empruntée au lexique de la gérontologie institutionnelle – les Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) –, il ne s’agissait nullement de pointer l’existence d’une politique sociale tournée vers les aînés, quasi inexistante au Cameroun, mais bien de désigner une forme particulière de gouvernementalité, dans laquelle la vieillesse, loin de marquer le retrait, est le cœur même du pouvoir. Cette métaphore révèle un fait saillant : l’architecture de l’État camerounais repose sur une gérontocratie institutionnalisée, où les plus hauts sommets des pouvoirs civil et militaire sont occupés par des figures âgées, souvent octogénaires ou nonagénaires, et dont la longévité dans les fonctions d’autorité dépasse l’entendement.
Le président Paul Biya, qui aura 93 ans en février 2026, en incarne l’illustration la plus éloquente. À la tête du pays depuis 1982, il vient d’annoncer sa candidature – pour un huitième mandat – à l’élection présidentielle du 12 octobre. Il gouverne entouré d’un cercle restreint d’hommes et de femmes dont plusieurs occupent depuis des décennies des postes stratégiques de la République. Dans la sphère civile, cette gérontocratie se manifeste par la longévité exceptionnelle d’acteurs tels que Marcel Niat Njifendji, réélu à la présidence du Sénat à 91 ans, Cavaye Yeguie Djibril, 85 ans, président de l’Assemblée nationale depuis 1992, ou encore Adolphe Moudiki, 86 ans, directeur général de la Société nationale des hydrocarbures depuis 1992.
Les institutions judiciaire, diplomatique, et d’autres postes parlementaires et ministériels ne sont pas en reste, avec Laurent Esso (82 ans), Clément Atangana (84 ans), Laurentine Koa Mfegue (88 ans), ou encore Madeleine Tchuente (76 ans), tous encore en fonction malgré le poids de l’âge. Nombre de leurs homologues aujourd’hui décédés ont, jusqu’à leur dernier souffle, continué à siéger, comme Delphine Zanga Tsogo ou Delphine Medjo. Dans les rangs de l’armée, le tableau est tout aussi évocateur. Les nominations militaires de juillet ont conforté cette logique de la reconduction d’un personnel militaire sénescent : Martin Mbarga Nguelé, 93 ans ; René Claude Méka, 89 ans ; Emmanuel Amougou, 73 ans…
Une élite du troisième, voire du quatrième âge
Ce gouvernement des anciens compose ainsi un même État-Ehpad à deux visages : civil et militaire. Profondément imbriquées, ces deux sphères s’articulent autour d’une même logique de continuité oligarchique et de conservation du pouvoir entre les mains d’une élite vieillissante.
Cette configuration n’est pas l’apanage du seul Cameroun. D’autres États africains présentent des traits similaires de gérontocratie prolongée, comme la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville, l’Ouganda, l’Érythrée ou le Zimbabwe. Un peu partout sur le continent, le pouvoir suprême est accaparé par des dirigeants dont l’âge dépasse de très loin celui de la population qu’ils dirigent, accentuant l’écart générationnel entre gouvernants et gouvernés1. Dans le cas du Cameroun, la jeunesse représente une large majorité de la population : plus de la moitié a moins de 20 ans, et seulement 3,6 % plus de 65 ans.
Achille Mbembe le résume avec mordant : « L’Afrique est gouvernée par des vieillards qui peinent à rester éveillés2 ». En effet, la plupart de ces « vieux » présentent ou ont souvent présenté des signes de fatigue visibles lors de leurs très rares apparitions publiques : déplacements à pas de tortue ou assistés, somnolence lors des conférences et forums internationaux, malaises en public, absences prolongées sur la scène publique et au travail, troubles récurrents de la mémoire, longs et fréquents séjours médicaux à l’étranger, dysarthrie lors des prises de parole en public, etc. C’est un fait de la nature que le fabuliste français Jean de La Fontaine a bien croqué : par la force des choses, tous les vieux sont « décrépit[s], goutteux, n’en pouvant plus [de souffrance] (« Le lion, le loup et le renard »), « gémissant[s], courbé[s] et march[a]nt à pas pesants, […], n’en peuv[a]nt plus d’effort et de douleur (« La Mort et le Bûcheron »), ce qui est le lot des résidents des maisons de retraite.
« Pardon, va te reposer »
Ce phénomène de sénescence du pouvoir n’est pas sans susciter critiques et résistance. La pétition d’écrivains africains contre la « présidence à vie » en 20203, le titre provocateur du chanteur camerounais Longuè Longuè (« Papa, tu es fatigué, pardon, va te reposer »), la lassitude exprimée par le jeune artiste Satellite Leking (« le vieux, faut nous laisser, on est fatigué, on veut le changement »), les positions individuelles de certains évêques camerounais contre une énième candidature du président, les publications satiriques du journal Le Popoli représentant le président en train de ronronner, ou encore le reportage de Naja TV sur « Ces papis qui gouvernent le Cameroun »4 illustrent cette fronde contre l’ordre vieillissant.
Si donc le constat semble acquis – le Cameroun est gouverné par des vieillards –, il reste à comprendre comment cette gérontocratie s’est instituée, consolidée, légitimée, et comment elle parvient, malgré les protestations, à s’imposer comme mode de gouvernement et comme norme dans l’imaginaire politique, avec son corollaire de production de désespoir.
Au Cameroun, l’État-Ehpad repose sur un dispositif sophistiqué de représentation par lequel la vieillesse physique et morale des élites gouvernantes est volontairement niée, neutralisée, et même inversée. Le pouvoir, dans sa forme actuelle, s’enracine dans un double imaginaire politique : la sacralisation de l’âge comme gage de sagesse politique et un processus actif d’effacement des signes de sénescence, dans les images officielles comme dans les discours sociaux.
« Toujours en forme », le déni du temps qui passe
La première opération de cette fabrique symbolique s’appuie sur une conception platonicienne du pouvoir, qui fait de l’âge avancé le sceau d’une vertu politique supérieure. Le vieux au sommet de l’État est supposé désintéressé, apaisé, éclairé par l’expérience. Répondant à un contradicteur dans le cadre d’un débat télévisé, l’ancien opposant Jean de Dieu Momo (président du parti politique Les patriotes démocrates pour le développement du Cameroun), désormais membre du gouvernement (ministre délégué auprès du ministre de la Justice), affirmait5] en 2018 :
« Son âge [celui du président Paul Biya, NDLR], c’est son meilleur atout. Il a l’âge où on n’a plus peur de mourir, il a l’âge où on transmet la succession, il a l’âge où on conseille les enfants, il a l’âge de diriger, il a l’âge de la sagesse, il a l’âge de la bibliothèque… »
Dans cette logique, la vieillesse n’est pas un déclin, mais un capital moral et politique. À rebours des passions, de l’impatience et de la corruption prêtées à la jeunesse, elle incarne la stabilité, la pondération, la hauteur de vue. Le président n’est pas un homme fatigué, mais un « patriarche », dont le corps fléchi serait le signe d’une conscience élevée tournée vers le bien commun.
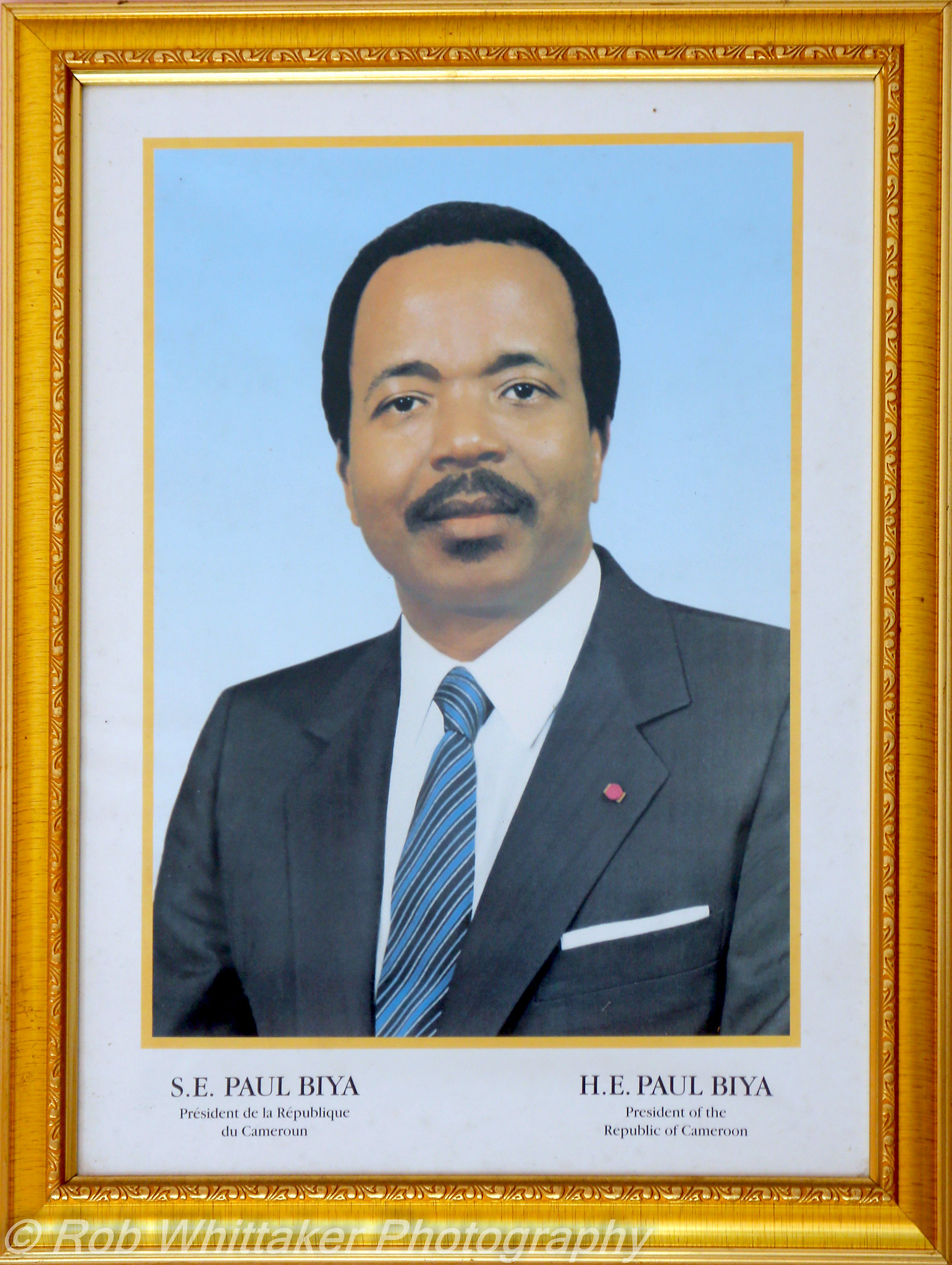
Ce discours est relayé par tout un appareil politique, institutionnel et iconographique qui s’emploie à nier les marques physiques de l’âge de Paul Biya. Les images officielles du chef de l’État sont figées dans le temps : costume impeccable, sourire de façade, regard vif, teint lissé, comme s’il était resté prisonnier des années 1980, qui ont vu son accession à la magistrature suprême. La voix tremblante, les gestes lents, les absences prolongées ne font pas partie du récit. Mieux : la propagande présidentielle nie vigoureusement tout soupçon de déclin, notamment en cas de rumeurs de décès. On le présente alors comme « toujours chaud gars » « en parfaite santé » – formules rituelles censées conjurer la mort. Le blanchiment des cheveux est soigneusement évité ; les signes de calvitie sont masqués. Tout concourt à maintenir la fiction d’un dirigeant invincible, éternellement jeune. Ce phénomène n’est pas propre au Cameroun : le maintien au pouvoir d’Abdelaziz Bouteflika en Algérie, quasi muet et cloué dans un fauteuil roulant, relevait de la même logique d’illusion, jusqu’à son effondrement brutal, en 2019. Ailleurs, en Italie, le président du Conseil des ministres, Silvio Berlusconi, avait été entièrement relooké par la chirurgie esthétique et plastique pour faire oublier son âge.
Recyclé par l’énergie juvénile de la rue
Cette stratégie ne se limite pas aux salons de la présidence. Elle se prolonge dans la rue, dans la musique, dans les imaginaires. La vieillesse au pouvoir emprunte les codes de la jeunesse, ses rythmes, ses expressions, ses danses, avec la complicité même de ceux qui les produisent. C’est ainsi que de jeunes policiers fraîchement sortis de l’école de formation ont composé une chanson en l’honneur de Martin Mbarga Nguélé, 93 ans, délégué général à la Sûreté nationale, en adoptant le style musical le plus en vogue parmi les jeunes, le Mbolè6. D’abord chantée dans les casernes comme hymne de ralliement, cette mélodie a ensuite accompagné les défilés officiels avant d’envahir les réseaux sociaux, reprise, remixée et dansée jusque dans les boîtes de nuit de Yaoundé, Douala et Paris. Par un retournement saisissant, la figure du vieil homme d’État se confond ainsi avec l’énergie juvénile de la rue, jusqu’à devenir objet de fête.
Même Paul Biya participe de cette captation symbolique : en février 2024, il reprend une formule née sur les réseaux sociaux – « le Cameroun est un continent » – aussitôt salué par des réactions enthousiastes : « Ashh, le pater là connaît ! », « Il est jeune dans la tête », « c’est un wise-man », etc.
Tous ces exemples montrent que l’État-Ehpad forme un théâtre où l’on joue la jeunesse, pendant que le corps du pouvoir se désagrège en silence. Il doit se montrer invincible, presque immortel. Il parle le langage de la jeunesse, reprend ses expressions, mime ses aspirations. Il fabrique une intimité factice avec la base sociale qui lui permet de maintenir l’illusion d’un pouvoir proche, souple, moderne et vivace. Ce processus de mimétisme symbolique contribue à rendre pensable l’éternité politique de vieillards biologiquement affaiblis.
Médecine, magie et aphrodisiaques
Cette théâtralisation de l’« en forme » est une véritable entreprise de déni : du temps qui passe, de la fatigue, de la maladie. Dans le contexte du pouvoir camerounais, les dispositifs iconographiques des dirigeants, les discours politiques et les imaginaires populaires façonnent un environnement où la vieillesse se pense et s’imagine en se niant en tant qu’instance du déclin, de la décrépitude, de la fatigue, de la morbidité. On est clairement là dans une forme spécifique de sociobiologie fictive de l’État : l’existence de personnalités qui durent et vieillissent au pouvoir et à des postes au sein de l’administration n’a rien d’incongrue, mais elle est sous-tendue par une conception mythique, presque « phénixienne », de l’existence : la dégradation physiologique du corps est compensée par une opération imaginaire et fictive de régénération des facultés physiques, mentales et morales. Comme le phénix, le vieillissement n’est pas un point de chute, mais le point culminant d’un renouvellement sans fin. Vieillir à la tête de l’État, c’est rajeunir deux fois.
Dans ces représentations, la vieillesse des dirigeants n’est pas associée à l’impuissance, mais à une puissance sexuelle surmultipliée, entretenue par la médecine, la magie ou encore les aphrodisiaques. Les vieillards sont décrits comme absorbant potions et décoctions pour conserver leur vigueur, quitte à en mourir. C’est dans ce registre qu’a circulé l’histoire du préfet du Haut-Plateau (58 ans), retrouvé mort en janvier 2019 après un supposé rapport sexuel avec une jeune fille de 19 ans7. Cet épisode a été immédiatement interprété sur les réseaux sociaux comme emblématique d’une génération vieillissante qui « suce » littéralement la vitalité de la jeunesse. Démenti dans les faits, l’événement continue néanmoins d’alimenter l’imaginaire collectif de « vieux jouisseurs éternels » qui consomment la jeunesse pour se régénérer.
À cette jouissance sexuelle s’ajoute une autre forme d’avidité, plus opaque, plus sinistre : la régénération occulte. Dans les récits populaires, les vieux au sommet de l’État consomment – littéralement – la jeunesse. Leur survie physique et politique serait assurée par une prédation rituelle : sang frais, liquides séminaux, fœtus broyés, capture de jeunes pénis, défloration de jeunes vagins et anus. Les rumeurs persistantes de « disparitions de sexe » au Cameroun s’inscrivent dans ce registre. Elles expriment l’angoisse d’une jeunesse spoliée de sa vigueur et vivant dans la hantise d’une castration soudaine et la crainte d’un pouvoir vampirisant qui se nourrit des parties vitales pour se maintenir en forme. Les évacuations sanitaires des hauts dirigeants vers des hôpitaux suisses ou français alimentent aussi ces imaginaires de prédation rituelle : là-bas, dit-on, s’effectueraient des transfusions de jeunesse, des dopages discrets à base de sang frais. Il ne s’agirait pas de simples soins médicaux, mais de véritables rites de rechargement vital, à la croisée du biomédical et du mystique.
Un désir infini de jouir
Ces récits ne sont pas anodins. Ils traduisent une réalité forte : les vecteurs, même sorcellaires, de l’État-Ehpad reposent sur une « extraversion » permanente, soutenue à la fois par l’ancienne puissance coloniale et par des pays supposés « neutres », comme la Suisse. Ces espaces offrent aux dirigeants vieillissants un accès continu à des soins de qualité devenus autant de ressources vitales pour leur maintien au pouvoir. L’État-Ehpad n’est pas une monade close sur elle-même. D’autre part, ces récits structurent les colères, nourrissent les colportages, galvanisent les mobilisations. En février, un père de famille marchait dans les rues de Douala, brandissant une pancarte en carton8 : « “First of all”, je ne fais pas la politique, mais mon bébé a été mangé sous les hautes instructions de la présidence de la République »… Il a été arrêté, frappé, placé en garde à vue. Mais son cri portait une vérité plus vaste : aux yeux de nombreux Camerounais, la vieillesse ne gouverne pas, elle dévore pour durer. Bref, en même temps qu’ils sont considérés comme des gages de sagesse et de stabilité politique, les vieux dirigeants sont accusés de se régénérer aux dépens des jeunes. Derrière, se dessine une idée fondamentale au sujet de la vieillesse au pouvoir : l’entêtement vital, le refus farouche de céder à la disparition.
Au fond, ce désir de s’agripper à la vie dit deux choses essentielles. La première, c’est que, contrairement à la tradition platonicienne qui associe la vieillesse à la sagesse, les vieux au pouvoir apparaissent souvent comme des épicuriens accomplis. Moins proches de l’ascèse que de la jouissance, ils ne sont pas des corps éteints que l’on imagine penchés sur la vertu ; ce sont des vivants, charnels, attachés aux plaisirs terrestres. N’assiste-t-on pas, au Cameroun, à une forme spectaculaire de jouissance chez certains dirigeants séniles qui, jusqu’à l’absurde, semblent vouloir consommer la vie jusqu’à la dernière goutte ?
Sur des scènes parfois orgiaques, ils s’entourent de jeunes corps – filles et garçons – dont ils sucent la vigueur comme on presse un fruit trop mûr. Ils festoient sous des lustres dorés, trinquent aux alcools importés, rient à gorge déployée autour de tables débordant de viandes fines et de montagnes de pâtisseries. Ils vident les caisses publiques, acquièrent des biens immobiliers par la prédation, blanchissent de l’argent dans des investissements opaques, s’entourent de prête-noms pour masquer leur fortune9. Voilà donc la première vérité que révèle cet acharnement à rester en vie : un appétit dévorant pour les plaisirs, un désir insatiable de jouir, une volonté de posséder, de consommer, de dominer.
Un pouvoir violent et impitoyable
Mais il en révèle une seconde, tout aussi fondamentale : la violence sourde, structurelle, que les vieux au pouvoir exercent pour conserver cette vie qu’ils redoutent de perdre. Jean de La Fontaine le pressentait lorsqu’il écrivait : « La vieillesse est impitoyable » (« Le vieux chat et la jeune souris »). Et cette impitoyabilité, au Cameroun, s’exprime par exemple par l’interdit de parole : il est particulièrement périlleux de nommer la vieillesse au pouvoir, d’en évoquer les faiblesses, de montrer les signes du corps qui vacille, surtout quand il s’agit du chef de l’État. Toute allusion à la fatigue de Paul Biya, à ses absences prolongées ou à sa démarche ralentie est la dangereuse violation d’un tabou. Dieudonné Essomba en a fait l’amère expérience10. Alors consultant pour l’émission Club d’Élites sur Vision 4 – une chaîne privée dirigée par Jean-Pierre Amougou Belinga, proche du pouvoir –, il a osé affirmer :
On ne fait que concentrer le pouvoir au Palais [présidentiel] entre les mains de quelqu’un qui est de plus en plus vieux et de plus en plus incapable, du point de vue physiologique. Regardez dans nos campagnes : quand on dit déjà que quelqu’un a 80 ans, la majorité traîne avec 90 ans ! Même en URSS, qui était un gouvernement de vieillards, on n’a pas connu ça. À 89 ans, quelle que soit la santé, quelle que soit la force, vous n’êtes plus à l’optimum, vous n’êtes même plus à 25 % de vos capacités. C’est physiologique.
La sanction a été immédiate : licenciement, interpellation par la gendarmerie, bannissement de l’antenne. Vision 4 a publié un communiqué sec et froid le 14 février 2022 : « Le docteur Dieudonné Essomba n’est plus consultant […] pour manquement grave et récidive. » Et même lorsqu’il a finalement été réintégré, après d’obscures tractations, le message restait clair : il est dangereux, voire interdit, de dire que le Vieux au sommet est affaibli. Il faut parler de lui comme d’un immortel, ou se taire. Point.
Alors, qui gouverne dans un État-Ehpad ?
Dans l’architecture de l’État-Ehpad camerounais, le vieillissement du pouvoir réorganise aussi les manières de gouverner, faisant émerger des dynamiques de plus en plus marquées par la délégation, l’absence et la mise en scène d’un pouvoir spectral. Le pouvoir ne s’incarne plus dans une parole active, mais dans des gestes répercutés, des instructions relayées, des apparitions mesurées comme des liturgies. Ce que l’on voit désormais, ce ne sont plus les actes du président, mais leurs traductions.
En effet, depuis 2019, Paul Biya a confié à son ministre d’État, le secrétaire général de la présidence (SGPR) Ferdinand Ngoh Ngoh, un rôle central dans le pilotage des affaires. Ce dernier détient une délégation permanente du pouvoir de signature – un geste technique en apparence, mais qui signifie beaucoup : le cœur du pouvoir bat désormais ailleurs que dans le corps du président. Ce gouvernement par procuration s’est manifesté de façon éclatante à deux reprises : lors de la gestion des fonds liés à la pandémie de Covid-19, où le SGPR a été l’architecte de la communication et des orientations ; et, aujourd’hui, dans la préparation de la campagne présidentielle et de l’élection à venir.
Dans le premier cas, le SGPR a été au centre de la répartition, de l’utilisation et de la justification des ressources liées à la pandémie. Alors que le pays faisait face à une urgence sanitaire majeure, c’est lui qui apparaissait, parlait, tranchait au nom d’un président invisible. Cette crise a révélé à quel point la verticalité du pouvoir était désormais incarnée ailleurs, dans un dédoublement fonctionnel qui entretient un flou volontaire entre autorité et autorisation, absence et omniprésence.
Dans le second cas, encore plus significatif, c’est ce même Ngoh Ngoh qui a pris les devants dans les négociations politiques préélectorales en réunissant à la présidence les élites des dix régions du pays pour recueillir les promesses de soutien à la candidature de Paul Biya. C’est lui qui a reçu, en grande pompe, la somme de 40 millions de F CFA (61 000 euros), présentée par les représentants de la jeunesse comme un « don » en faveur de cette candidature. C’est encore lui qui a, au nom du chef de l’État, effectué des tournées régionales, observé la situation sur le terrain, échangé avec les populations. Chaque fois, il assurait11 que « le Président est là », qu’« il suit tout », qu’« il sera bel et bien candidat », etc. On le voit, ce mode d’exercice du pouvoir par procuration s’est donc peu à peu affirmé comme une nouvelle architecture, une sorte de République en suspens gouvernée en pilotage automatique par des échos et des instructions indirectes.
Déploiement d’un bras droit ou substitution du pouvoir ?
Ce que certains ont vu comme le déploiement loyal d’un bras droit, d’autres l’ont perçu comme un détournement plus ou moins discret de l’autorité présidentielle et, en un mot, un état de régence. Dans certaines localités du nord du pays, les réactions hostiles d’élites ou de populations à la venue du secrétaire général de la présidence ont été relayées par les réseaux sociaux, avant que, mystérieusement, ces résistances s’évanouissent quelques heures plus tard. Pressions politiques ? Rattrapage financier ? Difficile de savoir. Ce sont là les mystères de la loyauté politique au Cameroun qui navigue entre manifestation de soutien indéfectible et défection, comme l’a montré Marie-Emmanuelle Pommerolle dans De la loyauté au Cameroun. Essai sur un ordre politique et ses crises(Karthala,2024). Ce que l’on voit, en revanche, c’est la manière dont le pouvoir circule sans le président, mais au nom du président, dans une logique de ventriloquie institutionnelle.
Mais cette orchestration par procuration, aussi bien huilée soit-elle, n’est pas sans créer des remous au sein même du régime. L’ascension silencieuse de Ferdinand Ngoh Ngoh, devenu en quelque sorte le « vice-président de fait », irrite jusque dans les rangs des plus fidèles compagnons de Paul Biya. Plusieurs figures historiques du pouvoir biyaïste ont récemment pris leurs distances. Issa Tchiroma Bakary et Bello Bouba Maïgari, anciens ministres et soutiens indéfectibles depuis les années 1980-1990, ont quitté le navire récemment pour se présenter à l’élection présidentielle d’octobre. Ils n’ont pas attaqué frontalement Paul Biya, mais ils ont exprimé leur désarroi face à un régime devenu méconnaissable.
Ce n’était plus Paul Biya qu’ils servaient, ont-ils laissé entendre, mais des clans, des intermédiaires, des figures invisibles qui désormais gèrent les affaires du pays. En clair, ce n’est plus le chef qui gouverne, mais ses ombres. Plus symbolique encore a été l’absence de Laurent Esso, ministre de la Justice, fidèle parmi les fidèles, lors de la réunion politique convoquée par le SGPR pour mobiliser les élites régionales. Lui qui, depuis des décennies, incarnait une loyauté sans faille a choisi de ne pas apparaître. Ce retrait a été interprété par de nombreux observateurs comme un signe d’agacement ou de désapprobation : non pas envers Biya lui-même, mais envers la substitution progressive de sa parole par celle d’un autre qui semble désormais gouverner à sa place.
Le président reste maître des horloges
Cependant, il serait hâtif de conclure à une disparition pure et simple de Paul Biya des affaires de l’État. Le président reste maître des horloges. Son retrait n’est pas un effacement passif, mais un art du dosage, une manière d’installer l’ambiguïté, de laisser croire que tout pourrait s’effondrer, tout en réapparaissant soudain, dans l’éclat d’une nomination, d’un discours, d’un ordre venu « d’en haut ». Il sait jouer de cette oscillation savante entre absence et présence, une tactique qui continue de désarçonner, de désorienter, et donc de tenir en laisse aussi bien ses adversaires que ses fidèles.
Ce pouvoir par intermittence et par procuration mais non sans contrôle installe une logique politique inédite : celle d’un homme affaibli dans son corps, mais encore capable de maîtriser les effets de sa propre absence. Il devient ainsi un président spectral, très exactement situé à la limite du visible, dans une position qui lui permet d’exercer une forme d’autorité absolue sans se montrer, un peu comme un dieu invisible dont les messagers assurent la trace terrestre.
Il faut cependant rappeler que ce style de gouvernement par économie de la présence ne date pas d’hier. Paul Biya a toujours cultivé une certaine discrétion stratégique, faite de silences pesants, de raréfaction de la parole publique, de sorties soigneusement orchestrées. Mais, dans le contexte actuel, cette discrétion est devenue un silence imposé par la fatigue, dicté par les limites du corps, que l’on veut maquiller. C’est donc l’indice d’un affaiblissement physique, que tout le système politique tente de dissimuler. Ce camouflage n’est pas sans rappeler ce que les psychologues du vieillissement appellent la stratégie de « l’optimisation sélective avec compensation », qui consiste, pour les personnes âgées, à se concentrer sur certaines fonctions qu’ils peuvent encore exercer efficacement, en compensant les pertes par l’aide d’autrui ou par des artifices. Lorsqu’un individu perd certaines capacités (physiques, cognitives), il développe d’autres stratégies pour maintenir un certain niveau de contrôle et d’efficacité. C’est exactement ce que semble faire Paul Biya : il compense l’effacement de son corps par l’activation d’intermédiaires ; il optimise ses apparitions pour leur donner plus de poids symbolique. Il gouverne moins par des actes directs que par une présence différée, dans un espace politique où le flou et l’ambiguïté sont des ressources de l’hégémonie politique.
Tuer l’espérance sans tirer : le temps du post-espoir
Des annonces prématurées de décès surgissent régulièrement à chaque absence prolongée du président. Dès que Paul Biya disparaît de l’actualité, les messages affluent : « Il est mort, cette fois c’est vrai. » Ce ne sont pas de simples dérapages de l’information. Ce sont des rumeurs performatives – des paroles qui veulent faire advenir ce qu’elles annoncent. Elles expriment un désir enfoui mais tenace : voir la fin du régime, même si cela doit passer par la mort du vieux monarque. Une mort attendue comme une délivrance. Une mort souhaitée, parfois fantasmée, pour faire enfin basculer un pouvoir figé.
Ce désir de rupture s’est même matérialisé dans des formes de compte à rebours symbolique, très visibles sur les réseaux sociaux, notamment autour de cette phrase prononcée par Paul Biya en 2004 : « Rendez-vous dans une vingtaine d’années. » Depuis 2024, les internautes rappellent en boucle que le temps est écoulé, comme si l’échéance annoncée devait naturellement correspondre à une sortie de scène. Dans le même sillage circule la formule amère : « Seigneur, nous prions au Cameroun, mais cela se réalise ailleurs », lorsque d’autres autocrates tombent ou disparaissent dans leurs pays, pendant que le système gérontocratique camerounais demeure inébranlable.
Le nom de Biya est ainsi revenu sans cesse dans les commentaires autour du décès de l’ancien président nigérian Muhammadu Buhari, comme un fantôme comparatif, dans des sarcasmes, des prières inversées, des soupirs exaspérés. Il y a là une forme de violence pliée, une violence que le peuple ne peut pas exprimer frontalement, mais qu’il murmure, qu’il insinue, qu’il glisse dans la répétition presque rituelle de ces annonces. Elles sont l’écho d’une fatigue collective, d’un espoir de rupture, d’un refus de continuer à subir.
La mort comme condition du changement
Car tout le monde est convaincu qu’au fond il n’y aura pas d’alternance pacifique, pas de passation apaisée. Alors, à défaut de « passer à l’acte », comme dirait Achille Mbembe (AOC Media, 2019), il ne reste que l’ultime solution, inavouable mais omniprésente : la mort comme condition naturelle du changement. Ces fausses nouvelles constituent ainsi des fictions de libération. Des récits partagés, chargés d’une politique de la destruction, qui traduisent l’envie de voir enfin tomber un ordre vieux, paralysant, accablant. Ce ne sont pas des fautes journalistiques : ce sont des actes politiques – des formes de résistance désespérée à un régime qui interdit toute opposition réelle. Et parce que l’ordre gérontocratique en place interdit la destitution, la seule chute possible est biologique. Ce n’est pas un peuple qui fait tomber son président : c’est la vieillesse qui le rattrape ou la mort qui l’emporte. Le politique disparaît, remplacé par la biologie.
En attendant, ce vieillissement du pouvoir s’accompagne d’une érosion progressive du lien social, d’un effondrement des attentes et d’un désenchantement profond. Cette défiance s’accompagne d’une perte d’espoir en une société juste, égalitaire et, surtout, en une société capable d’offrir des opportunités économiques et politiques et des horizons meilleurs à la jeunesse.
Il ne s’agit pas d’une perte du sentiment d’appartenance nationale – l’euphorie lors des matchs de football, l’allégresse lors de l’exécution des pas de danse camerounaise, la nostalgie du pays dans les diasporas et l’alacrité autour des plats de cuisine le prouvent. Mais il s’agit du sentiment que « l’herbe est plus verte ailleurs », que le « pays, c’est pour les autres », qu’il faut quitter Cameroun à tout prix « même s’il ne faut qu’aller au Tchad, ici à côté ». Il y a délitement non pas de la nation et de l’appartenance nationale, mais de la société comme organisme total. C’est bien ce que traduisent des expressions courantes sur les réseaux sociaux : « Mieux on vend le Cameroun, chacun prend sa part », « Nous autres avons déjà compris votre schéma ; voilà pourquoi nous qui rêvons “grand” préférons immigrer en Europe au lieu de courir sur place », soulignant l’absence du capital espoir investi dans cette société du fait d’un sentiment d’accaparement du pays.
« Le pays nous tue »
Au Cameroun, plusieurs jeunes ont véritablement le sentiment que « le pays [les] tue » (Valsero, 2008), la société étant embrigadée par des vieux occupant différents postes dans les hautes sphères. Il y a, parmi ces jeunes, ceux qui aspirent à une dictature radicale pouvant rétablir une société plus juste, surfant sur la nostalgie d’un passé autoritaire qui aurait été glorieux. D’autres préfèrent subir la situation en exerçant des emplois informels mal rémunérés, mais en s’évadant par la consommation d’alcool, de stupéfiants, ou par le sexe. De plus en plus nombreux, des jeunes préfèrent déserter la société : jeunes diplômés, fonctionnaires et militaires démissionnent de leur misérable travail au Cameroun pour trouver « mieux » ailleurs, au Canada ou en Europe, pour rejoindre les rangs de l’armée russe dans sa guerre contre l’Ukraine, pour affronter la traversée du désert et de la mer au risque d’y mourir. Une même fatigue morale se dégage : celle d’un avenir bloqué, d’une espérance trahie, d’un pays devenu un piège plutôt qu’un horizon.
Dans de nombreux pays africains, et au Cameroun en particulier, l’époque n’est pas seulement celle la « post-confiance » dont parle Agathe Cagé (AOC, 2025), mais surtout celle du « post-espoir », c’est-à-dire une situation généralisée de défiance à l’égard des élites dirigeantes qui a pour effet de susciter un désir ardent de partir. Il s’agit donc d’un « moment d’historicité » (Jean-François Bayart, Revue française de science politique, 2016) marqué par la défiance des populations à l’endroit des élites systématiquement accusées de s’enrichir illicitement, d’appauvrir, d’extorquer et d’assécher les populations, de faire stagner la société et l’économie, de confisquer les affaires pendant des décennies, de vieillir au pouvoir et d’offrir très peu de perspectives et de chances aux jeunes.
Cette défiance active une volonté d’aller vivre, de produire, de se réaliser, de se dépenser et d’émerger ailleurs, sans que cela traduise une désaffection du sentiment d’appartenance nationale. De fait, le « post-espoir », c’est la « post-confiance » doublée d’un désir de quitter, de fuir, de partir. Sous l’État-Ehpad, la société camerounaise vit une forme de « post-espérance », où les rêves des indépendances – dignité, égalité, développement, bien-être, sécurité – ont cédé la place à un cynisme latent. Ainsi, l’État-Ehpad ne se comprend pas seulement comme une structure politique : c’est aussi une configuration morale et affective, un régime d’usure silencieuse. Il gouverne moins par la force que par l’éreintement, par l’épuisement des rêves. Et c’est peut-être là sa plus grande violence : tuer l’espoir, sans tirer.
Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables) :
Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables).
 Faire un don
Faire un don
Les articles présentés sur notre site sont soumis au droit d’auteur. Si vous souhaitez reproduire ou traduire un article d’Afrique XXI, merci de nous contacter préalablement pour obtenir l’autorisation de(s) auteur.e.s.
1« Présidents âgés, population jeune, la nouvelle équation de la politique africaine », BBC News Afrique, 15 janvier 2021.
3« Des écrivains africains dénoncent “les présidences à vie” », TV5 Monde, 2 septembre 2020, à voir ici.
4« Ces papis qui gouvernent le Cameroun », Naja TV, 10 février 2021, à voir ici.
5« L’arène », Canal 2 International, 05 août 2018, disponible ici, à partir de 1:12:19.
6Calvin Djouari, « Martin Mbarga Nguele - “Le père de la police” - chanson qui devient planétaire », Afrik sur Seine, 17 juin 2024, à lire ici.
7Tricia Bell, « Controverse autour du décès d’un préfet », Le 360 Afrique, 15 janvier 2019, à lire ici.
8Publication Instagram de Nzui Manto, 26 février 2025.
9Des exemples sont publiés tous les jours et relayés sur les réseaux sociaux, notamment sur les chaînes Telegram et Facebook des lanceurs d’alerte camerounais.
10Le passage en question est disponible ici
11Journal de la Cameroon radio-télevision, juillet 2025.
12« Présidents âgés, population jeune, la nouvelle équation de la politique africaine », BBC News Afrique, 15 janvier 2021.
14« Des écrivains africains dénoncent “les présidences à vie” », TV5 Monde, 2 septembre 2020, à voir ici.
15« Ces papis qui gouvernent le Cameroun », Naja TV, 10 février 2021, à voir ici.
16« L’arène », Canal 2 International, 05 août 2018, disponible ici, à partir de 1:12:19.
17Calvin Djouari, « Martin Mbarga Nguele - “Le père de la police” - chanson qui devient planétaire », Afrik sur Seine, 17 juin 2024, à lire ici.
18Tricia Bell, « Controverse autour du décès d’un préfet », Le 360 Afrique, 15 janvier 2019, à lire ici.
19Publication Instagram de Nzui Manto, 26 février 2025.
20Des exemples sont publiés tous les jours et relayés sur les réseaux sociaux, notamment sur les chaînes Telegram et Facebook des lanceurs d’alerte camerounais.
21Le passage en question est disponible ici
22Journal de la Cameroon radio-télevision, juillet 2025.