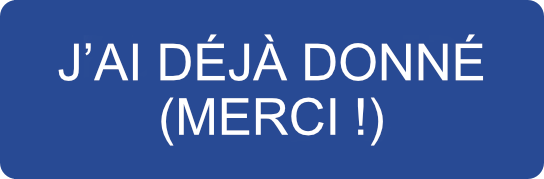Indomptables, réalisé par Thomas Ngijol, dont le titre évoque la célèbre équipe nationale de football du Cameroun, inscrit d’emblée son propos dans un espace-temps bien connu : un pays, ses tensions internes, ses représentations sociales et ses incertitudes. La référence au Cameroun est renforcée par l’ancrage spatial du film dans des quartiers bien identifiables de Yaoundé (Elig Edzoa, Mimboman, Santa Barbara et Étoudi). Ces espaces ne sont pas des décors : ils sont les cadres actifs d’une réalité sociale camerounaise.
Si certains ont évoqué une parenté avec le documentaire Un crime à Abidjan (Mosco Levi Boucault, 1994), qui proposait déjà une enquête sur la mort d’un policier, l’analogie s’arrête là. Le film de Thomas Ngijol s’en écarte rapidement pour s’intéresser aux dynamiques plus vastes qui structurent la vie quotidienne : la dégradation des infrastructures urbaines, la crise de l’autorité parentale, la précarité du travail, l’affaiblissement des repères moraux, la petite corruption de tous les jours. Ngijol ne cherche pas à documenter un fait divers ni à produire la reconstitution rigoureuse d’un crime. L’enquête n’est qu’un prétexte pour présenter, en arrière-plan, le reflet d’une société en déséquilibre mais qui tient tout de même.
Dès sa diffusion, Indomptables a suscité un vif débat dans les sphères médiatique et numérique. D’un côté, certains saluent une tentative de renouvellement du langage cinématographique chez Ngijol, un geste audacieux de la part d’un acteur moins connu pour des polars que pour la comédie. De l’autre, on lui reproche une construction confuse, une impression d’inachevé et une fragmentation narrative qui a conduit certains spectateurs à qualifier Indomptables de « fourre-tout » et à dénoncer une dispersion thématique et un empilement sans cohérence. De fait, Indomptables n’est pas un film de l’harmonie ; c’est un film de la friction. Il échappe aux formes stabilisées du récit linéaire, mobilise des registres et des thématiques multiples et n’offre pas de trame unifiée, mais une constellation de situations de mise en tension : la vie familiale, l’autorité paternelle, les violences urbaines, l’état des infrastructures, les relations affectives et sexuelles, la criminalité juvénile, ou encore les conditions de travail dans les services publics. C’est précisément cette fragmentation qui dérange ou intrigue.
Un espace social complexe et enchevêtré
Au fond, cette critique en dit long sur une attente implicite de linéarité, que le film récuse avec fermeté. Pourtant, ce qui peut apparaître comme de la discontinuité est le résultat d’une démarche délibérée : celle de donner à voir la complexité d’un espace social où les événements ne s’enchaînent pas selon une logique claire, mais coexistent, se superposent, s’enchevêtrent. À l’image d’un Cameroun que ses propres citoyens décrivent comme un « continent », voire une « galaxie », l’œuvre se donne comme une composition polyphonique et éclatée. Ngijol fait le choix du refus de la linéarité du roman policier et du récit historique classiques.
Dans cette perspective, Indomptables n’est pas un film qui raconte : c’est un film qui enregistre. À la manière d’un sismographe, il recueille les secousses du présent : l’effondrement des infrastructures, la perte d’autorité, l’érosion des liens, et la violence devenue la norme. Ces secousses ne sont pas toujours spectaculaires : elles sont diffuses, latentes et inscrites dans la banalité du quotidien. Loin de chercher l’exceptionnel ou le pathétique, le film s’attache à montrer ce qui persiste : les coupures d’électricité, les rues dégradées, les silences familiaux, les gestes contraints de ceux qui vivent dans la précarité. Il trace les contours d’un espace social traversé par des lignes de faille. Le film ne cherche pas à « suturer » ces failles, mais à en restituer la « texture ».
Et si l’on y perçoit parfois une forme de poésie, ce n’est pas une poésie lyrique ou contemplative, mais une poésie sèche, rude, qui naît du quotidien lui-même – dans ce qu’il a d’usé, de brut, de tenace, d’injuste, de brutal, de bricolé et d’inventé1.
Une cartographie des effondrements
Par ailleurs, Indomptables donne moins à voir une progression causale qu’une cartographie sensible. Un « plan » au sens deleuzien où cohabitent – sans hiérarchie ni exclusion – le meurtre d’un policier, la contestation d’une autorité masculine, les ruines de la parentalité, la saleté des rues et la vétusté des hôpitaux, les coupures d’électricité et la toxicomanie des jeunes, les bidonvilles, la banalisation des pratiques sexuelles, la corruption policière, la brutalité quotidienne, la désaffection de l’amour et la fatigue du travail précaire. Ces réalités n’ont peut-être, en apparence, rien à voir les unes avec les autres. Et pourtant, elles se côtoient dans le même souffle. À la manière des « boîtes closes » deleuziennes qui subsistent dans une forme d’« indépendance mutuelle », elles se tiennent ensemble, précisément parce qu’aucun lien ne les unit. Elles convergent dans une même direction, à travers ce que Deleuze appelait une « communication transversale aberrante2 ». Cette technique de l’agencement permet de faire exister ensemble des éléments hétérogènes et disparates.
Les études africanistes et les sciences sociales en général peuvent tirer deux enseignements d’Indomptables. La première leçon concerne l’analyse des réalités camerounaises – et, par extension, africaines – que le film interroge avec acuité à travers trois thématiques structurantes qui, en apparence, n’ont rien en commun : la production de la sécurité publique, la fabrique de la ville et les transformations de l’autorité paternelle dans des espaces historiquement patriarcaux.
Il met en évidence les tensions internes à ces trois sphères : les conditions précaires et souvent brutales dans lesquelles s’exerce la sécurité publique ; les formes désorganisées, inégalitaires, voire abandonnées, que prend la ville dans sa matérialité ; et la crise – silencieuse mais douloureuse – de l’autorité paternelle, de plus en plus contestée, affaiblie ou délégitimée.
« Une esthétique de l’entrelacement des expériences »
La seconde leçon touche au geste même de l’écriture sociologique ou historique. Le film propose une esthétique de l’entrelacement des temporalités et des expériences. Il n’aborde pas séparément les trois thématiques susmentionnées ; il en montre l’imbrication concrète et le chevauchement dans la vie quotidienne. C’est une « écriture suggestive », qui n’abandonne ni la rigueur ni la densité analytique, mais qui prend acte des conditions parfois contraignantes – voire autoritaires – dans lesquelles se déroule le travail intellectuel sur ces terrains. Dans ce contexte, la suggestion devient un mode d’expression stratégique : elle permet de dire sans désigner, de montrer sans exposer.
La trajectoire narrative du film s’organise autour d’un motif central : l’enquête menée par le commissaire Zachary Billong à la suite du meurtre d’un policier retrouvé sans vie durant la nuit. L’enquête ne suit pas une logique linéaire de découverte progressive fondée sur des indices matériels probants, comme dans les romans policiers et d’espionnage classiques. Elle repose plutôt sur un régime de suspicion généralisée, où la vérité ne se construit pas à partir de preuves objectives, mais se déploie dans un climat de présomption de la faute.
La suspicion opère ici non pas comme une étape vers la vérité judiciaire, mais comme un substitut de celle-ci : elle fonctionne comme un cadre de validation anticipée de la culpabilité. Autrement dit, elle précède et structure l’enquête elle-même, de sorte que le soupçon devient, en tant que tel, un élément suffisant pour punir.
Bricolages et brutalités dans la production de la vérité judiciaire
C’est ainsi que les jeunes délinquants du quartier où le corps a été retrouvé sont immédiatement ciblés. Déjà marqués socialement par leur appartenance à des catégories stigmatisées – jeunesse marginale, consommateurs de drogues, chômeurs –, ils apparaissent comme des suspects « naturels ». Ils sont interpellés, traqués parfois jusque dans leur sommeil, violentés, soumis à des interrogatoires musclés. Certaines scènes du film donnent à voir une violence explicite : l’un est traîné sur un sol rocailleux, un autre est suspendu par les pieds à un arbre, un troisième a le dos gravement blessé lors d’une course-poursuite. Ces pratiques ne relèvent pas d’un dérapage isolé mais d’un usage « routinisé » de la brutalité physique comme méthode d’extraction de la vérité au Cameroun3.
Le régime d’enquête mis en scène dans le film repose sur ce que l’on pourrait nommer une « suspicion légitime institutionnalisée » dirigée vers des figures socialement disqualifiées. Ces figures ne se limitent pas aux jeunes des quartiers urbains ; on y retrouve également, dans la réalité camerounaise contemporaine, des petits entrepreneurs accusés de fraude sur les marchés publics ou encore des acteurs associatifs soupçonnés de malversations financières.
La suspicion ne sanctionne pas des actes, mais des identités et des intentions. Elle anticipe la faute sur la base d’un profil, elle transforme la potentielle culpabilité en présomption active. Dans ce cadre, le soupçon ne constitue plus un outil d’investigation, mais une justification de l’exercice de la violence. Il est à la fois le moteur et la preuve de la vérité. Ainsi se reconstituent, sous des formes contemporaines, des pratiques que Michel Foucault avait identifiées dans l’Europe de l’Ancien Régime : la « suspicion légitime » et la torture comme socles de production de la vérité et de légitimation de la punition4. À l’instar des analyses foucaldiennes, Indomptables montre comment l’autorité se replie sur des pratiques de coercition pour produire des « preuves ».
Arracher la vérité par la douleur des corps
Ce régime de production de la vérité judiciaire a ceci de particulièrement pervers qu’il ne se contente pas de fausser la logique de l’enquête : il contribue activement à la diffusion de la brutalité comme manière de gouverner (à travers) des populations marginalisées. Ce qu’Indomptables met ainsi en évidence, c’est la manière dont la vérité judiciaire est souvent arrachée par la douleur des corps stigmatisés. Plusieurs jeunes dans le film finissent par avouer des faits qu’ils ignorent, simplement pour échapper à la souffrance physique. Cette dynamique est loin d’être purement fictionnelle : elle renvoie à des pratiques bien documentées dans de nombreux pays africains, y compris au Cameroun5
Le film illustre avec précision cette réalité : c’est parfois après avoir fait souffrir plusieurs corps innocents, traumatisés à vie, parfois brisés à mort, que l’on parvient, par hasard ou par épuisement des hypothèses, à identifier le véritable coupable. La vérité n’émerge donc pas à l’issue d’un raisonnement probatoire mais à travers un processus de violence cumulative, où les corps servent d’intermédiaires sacrificiels dans la recherche d’un sens6. Le film ne montre pas seulement l’échec des méthodes, mais l’établissement d’un système où la brutalisation constitue l’unité de base de la fabrique sécuritaire et de l’ordre tout court.
Indomptables met également en lumière un phénomène rarement thématisé à l’écran : l’absence totale de réparation pour les victimes d’« erreurs » policières. Les jeunes accusés à tort, malgré les sévices subis, ne portent pas plainte. Non seulement parce que les voies de recours n’existent pas, mais aussi parce que la police, loin d’être inquiétée, renforce sa position par l’intimidation, les menaces et parfois l’incarcération de ces mêmes jeunes, coupables d’autres délits avoués sous la pression bien que sans lien avec le meurtre initial. Le film expose ainsi un pouvoir policier qui se déploie sans contre-pouvoir, ni régulation judiciaire effective, ni contrôle citoyen.
Clore les enquêtes à tout prix
Le film propose, enfin, une critique subtile mais percutante d’un système judiciaire reposant davantage sur la performance individuelle des enquêteurs – souvent contraints par la précarité de leurs conditions de travail ou par des injonctions hiérarchiques à produire rapidement des résultats – que sur la recherche rigoureuse et objective de la vérité. Dans ce cadre, l’« efficacité » institutionnelle se mesure à la capacité de clore rapidement une affaire, quitte à recourir à des pratiques moralement et juridiquement discutables.
Cette logique s’est illustrée de manière tragique dans plusieurs affaires emblématiques, comme l’assassinat, en janvier 2023, du journaliste camerounais Martinez Zogo, ainsi que celui d’autres personnalités connues, qu’il s’agisse de journalistes (Samuel Wazizi, Bibi Ngota, Jean-Jacques Ola Bebe) ou de prélats (Yves Plumey, Engelbert Mveng, Anthony Fontegh, Materne Bikoa, Apollinaire Claude Ndi, Barnabé Zambo, Jean-Marie Benoît Balla, sans oublier les sœurs Germaine Marie Husband et Marie Léone Bordy) ainsi que les « gens quelconques » (dixit Foucault) qui sont tous les jours victimes de viols, d’agressions et d’assassinats impunis. Les conclusions des commissions d’enquête restent floues, souvent limitées à l’identification de prétendus « complices », tandis que les commanditaires véritables demeurent hors de portée. Dans certains cas, les dossiers ont tout simplement été refermés, sombrant dans l’oubli institutionnel.
Indomptables révèle donc l’existence d’un système de policing bricolé au quotidien, produit dans l’urgence, la précarité et la précipitation, parfois avec des objectifs politiques. Il ne s’agit pas d’un ordre sécuritaire rationnel ou planifié, mais d’une forme de sécurité oblique, instable, traversée par la violence arbitraire et l’absence de responsabilité. Ce système ne vise pas la justice au sens strict, mais plutôt la clôture rapide des affaires, la démonstration d’une efficacité institutionnelle au prix du droit. Le maintien de l’ordre, dans ce contexte, n’est pas une fin en soi, mais un sous-produit incertain d’une pratique routinière de la domination politique.
La ville africaine et ses « trous »
La ville constitue la seconde unité d’analyse dans Indomptables. Elle n’est pas un simple décor, mais un véritable opérateur narratif : c’est dans l’espace urbain que s’entrelacent les dimensions de l’enquête policière et de la vie familiale. Le film se déploie dans Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, dont il dresse un portrait sans complaisance. Routes fissurées, flaques stagnantes, amas de déchets visibles sur les trottoirs, circulation paralysée par des marchés encombrés – comme celui d’Étoudi, filmé frontalement – et contrôles policiers de routine : tout, dans l’environnement urbain, participe à la construction d’un espace chaotique, saturé d’irrégularités devenues systémiques.
Les policiers censés assurer la fluidité du trafic y apparaissent davantage comme des agents d’extorsion, comme c’est bien souvent le cas dans des métropoles africaines où le pouvoir policier est au service de logiques de prédation7.
Mais au-delà de ces signes visibles d’une ville dysfonctionnelle, c’est l’intermittence – voire l’effondrement – des services essentiels qui marque véritablement le paysage. L’un des éléments les plus frappants, mis en scène avec une précision documentaire, est la gestion erratique de l’électricité. La symbolique est d’autant plus saisissante qu’il s’agit ici de la capitale politique d’un État souverain. Les coupures de courant y sont si fréquentes qu’elles rythment le quotidien des habitants comme un métronome de l’abandon. Cette réalité est si profondément ancrée dans l’imaginaire collectif qu’elle fait l’objet, sur les réseaux sociaux, d’une chronique numérique intitulée « Minute du délestage », tenue par le lanceur d’alerte N’zui Manto. Cette « minute » désigne une durée indéterminée d’obscurité – parfois des semaines entières – dans Yaoundé et d’autres villes secondaires ou zones rurales, souvent également privées d’eau courante.
La nuit urbaine, révélateur de l’inaction publique
La nuit urbaine constitue, dans ce film, un révélateur : les lampadaires sont hors service, les panneaux électriques inopérants, et les rues ne doivent leur illumination qu’aux phares des véhicules ou, lorsqu’il y a du courant, à la lumière filtrée des maisons alentour. Dans les quartiers périphériques, ce sont les lampes-tempête qui assurent un éclairage minimal, notamment pour le petit commerce informel qui s’exerce dans l’obscurité.
Ainsi, la lumière – service élémentaire de la ville moderne – est un bien rare, réservé à des circonstances exceptionnelles : compétitions sportives internationales, visites de chefs d’État étrangers, espaces sanctuarisés de l’élite administrative, politique et économique (palais, ministères, hôtels de luxe). Autrement dit, la lumière urbaine n’est pas une infrastructure publique généralisée, mais une ressource politique mobilisée de façon ponctuelle et stratégique.
Ce phénomène n’est pas inédit : il prolonge une histoire ancienne de l’inaction et de la dislocation infrastructurelle, déjà dénoncée à la fin des années 1990 par l’écrivain Mongo Beti. Ce qui change, en revanche, c’est son intensification dans un contexte politique figé, marqué par le vieillissement extrême du chef de l’État. À 92 ans, Paul Biya, qui vient d’annoncer sa candidature à un nouveau mandat, se déploie dans un régime que certains décrivent comme un « gouvernement par l’absence », où le pouvoir, bien que toujours affirmé, semble déléguer sans coordination, se désincarner, se disperser.
« On va faire comment ? »
Cependant, malgré l’ampleur des problèmes urbains et la désaffection des pouvoirs publics, l’indignation populaire reste presque apathique. Le mécontentement s’exprime mais ne se convertit pas en action. La formule récurrente « on va faire comment ? » condense cette posture de retrait, entre désenchantement, fatigue civique et stratégies individuelles de survie.
Les formes de fuite sont multiples : certains se replient sur leur quotidien (petit commerce, routine familiale), d’autres s’engagent dans des projets d’exil, quittant leurs fonctions au Cameroun pour exercer des emplois subalternes mais mieux rémunérés à l’étranger, notamment au Canada, ou s’embarquent dans des parcours migratoires risqués vers l’Europe (France, Allemagne, Italie, Portugal, Espagne et, de plus en plus, Russie et Ukraine pour rejoindre les rangs de l’armée). D’autres, enfin, noient leur désillusion dans les formes d’évasion directes offertes par l’alcool, le football ou les distractions sexuelles.
Ce qu’Indomptables donne à voir, c’est donc une ville en désétatisation partielle, où l’État se retire discrètement de certaines missions essentielles tout en maintenant les apparences de sa présence symbolique. Le film offre ainsi une mise en scène de ce que l’on pourrait appeler « un urbain résiduel », dans lequel la gestion des services élémentaires – lumière, transport, assainissement, santé, eau, voirie – repose de plus en plus sur les ajustements informels des citoyens eux-mêmes, quitte à revendiquer leur insertion dans la ville en dépouillant les autres. C’est ce que fait un collègue du commissaire Billong en détournant l’argent prévu pour les soins du véritable coupable, gravement blessé au dos dans l’intervention de la police, conduit aux urgences puis délaissé par les agents de l’hôpital faute de moyens financiers8. Dans le film, la somme détournée par un policier est utilisée pour l’achat d’un groupe électrogène afin de pallier les délestages de son quartier.
Ni misérabilisme, ni afropéanisme
Mais Indomptables ne tombe ni dans le piège du misérabilisme, ni dans celui d’un afropéanisme enchanteur s’insurgeant contre tout discours critique sur l’Afrique. Le film se démarque aussi bien des représentations laudatrices produites par un certain panafricanisme afropolitain – qui tend à promouvoir une image brillante, parfois élitiste et déconnectée des réalités populaires9 – que des discours catastrophistes qui font de la ville africaine une entité exclusivement en crise.
Il opère un déplacement critique : pour reprendre la terminologie de Filip De Boeck (2016), Indomptables donne à voir les « trous » qui balafrent le tissu urbain tout en rendant visibles les multiples sutures et acupunctures – bricolages, ajustements, solidarités informelles, tactiques d’usage – que les citadins y apposent pour rendre leur espace vivable. Cette dynamique de réparation partielle n’efface toutefois pas les failles profondes. En effet, aussi ingénieuses soient-elles, ces stratégies peinent à transformer la ville en un système urbain pleinement fonctionnel.
Loin d’être la manifestation d’un simple dysfonctionnement, les trous de la ville camerounaise sont bien plus des espaces d’opportunités, d’innovations, de rencontres mais aussi de blocages. De plus, ils révèlent la nature fragmentée d’un État qui fonctionne comme une araignée, c’est-à-dire un ensemble d’institutions et de dispositifs qui ne sont activés que dans l’urgence, la nécessité et selon l’importance des enjeux en place10. L’urbanité offerte aux spectateurs est marquée par la ruse des citadins mais aussi par les limites de cette ruse face à un désengagement structurel. Le film ne cherche pas à faire œuvre de plaidoyer ou de dénonciation, mais il pense la ville comme une matérialité incertaine, sans contours achevés.
La crise de l’autorité masculine et paternelle
Indomptables offre aussi un registre plus discret mais profondément structurant : celui de la vie familiale du commissaire Zachary Billong. Plusieurs commentateurs ont noté que cette figure paternelle, incarnée par Thomas Ngijol, puise dans une part de vécu personnel qui introduit une résonance autobiographique dans l’architecture du récit. Mais au-delà d’un reflet intime, le film se déploie comme une méditation sur la transformation – voire l’érosion – des formes traditionnelles d’autorité, et plus précisément sur la crise contemporaine de la paternité dans les sociétés africaines postcoloniales.
Billong incarne une figure paternelle en décalage, exposée à une série de disjonctions affectives et symboliques. Il vit avec une épouse au tempérament affirmé, deux garçons – un adolescent et un enfant – et une fille issue d’une précédente union, désormais éloignée. En rupture ouverte, cette dernière refuse tout contact : elle a bloqué le numéro de son père, et lorsque ce dernier parvient à la joindre en utilisant le téléphone de son fils, elle lui crie de ne pas la déranger avant de lui raccrocher au nez. Elle se rend jusqu’à son lieu de travail pour le sommer de ne plus la chercher et d’agir en « homme » en s’occupant convenablement de ses enfants. Le commissaire est ainsi encerclé de manifestations de « désobéissance » qui mettent à l’épreuve sa légitimité dans les cercles les plus immédiats de son autorité. Il vit dans une famille recomposée où les centres d’autorité sont (devenus) pluriels.
Chaque interaction domestique donne lieu à une scène de contestation, voire d’humiliation : sa femme lui tient tête, le contredit ouvertement, et corrige même ses décisions, comme lorsqu’elle fait annuler son ordre de surveillance de la fille aînée soupçonnée de se prostituer. Les enfants, eux aussi, s’inscrivent dans la rupture : l’aîné est insolent avec ses enseignants et accro aux réseaux sociaux ; le plus jeune rédige des lettres à caractère sexuel pour une camarade. Le gardien de la maison choisit d’obéir à l’épouse. Le père est donc débordé, à la fois symboliquement et émotionnellement, perdant pied dans une maison devenue espace de lutte et de désarticulation de l’ordre symbolique patriarcal. Cette exaspération se prolonge dans son travail, où il manifeste la même nervosité, les mêmes colères, comme si la déstabilisation de l’ordre domestique contaminait son autorité publique.
« Les blessés de l’ordre patriarcal »
À nouveau, Ngijol propose une lecture fine d’un phénomène sociologique profond : la dislocation du pouvoir patriarcal comme point d’entrée vers une forme inédite de vulnérabilité masculine. Le commissaire n’est pas seulement un oppresseur autoritaire : il est aussi un sujet désorienté par la perte d’un monopole symbolique autrefois assuré par sa fonction, son genre et son statut économique. Sa parole est contestée, sa position affaiblie, son autorité fragmentée. Sa souffrance est visible : le film montre un homme blessé, en quête de repères, tenté de restaurer par la violence et la colère une place qu’il sent lui échapper.
Ce qui se joue ici, c’est la mutation d’un ordre patriarcal ancien où le père était à la fois pourvoyeur, détenteur de la Raison et figure incontestée de l’autorité morale. Le commissaire semble aspirer à cette forme d’autorité verticale, mais il se heurte à une modernité technique (téléphone, réseaux sociaux, autonomie informationnelle) et sociale (affirmation féminine, fragmentation de la parole autoritaire) qui la rend obsolète. Bien que sa femme ne travaille pas, elle est connectée au monde, informée et capable de lui résister verbalement. La technologie devient un vecteur de redistribution silencieuse du pouvoir au sein du foyer, qui échappe au contrôle de celui qui en était historiquement le centre.
Ce désajustement entre modèle ancien et réalités contemporaines engendre une souffrance psychique sourde. Loin d’être un simple oppresseur patriarcal, le commissaire devient un « blessé du patriarcat », au sens que Catherine Malabou donne aux « nouveaux blessés » : des sujets qui, affectés dans leur mémoire et traumatisés par la dislocation des cadres de vie, sont en perte de repères et d’orientations et souffrent dans le silence de la fierté et de « l’honneur », ce qui les rend à la fois plus violents et plus vulnérables.
« Un entre-deux épuisant »
Le film n’oppose donc pas autorité masculine et contestation féminine de façon manichéenne. Il met en scène, de manière plus complexe, un monde où les anciens détenteurs de l’autorité sont désorientés, en souffrance, et parfois dangereux, non parce qu’ils détiennent encore le pouvoir, mais parce qu’ils le perdent sans avoir compris les mutations sociales profondes en cours. En ce sens, Indomptables participe d’une réflexion plus large sur les transformations contemporaines de la figure du père dans les sociétés postcoloniales : ni tout à fait maître, ni encore abdiquant, mais coincé dans un entre-deux épuisant, un espace où le désir de contrôle se heurte à des mutations qui le dépassent. Le film parvient ainsi à penser le patriarcat non seulement comme une structure de domination, mais aussi comme une fabrique de souffrance et de perte pour ceux-là mêmes qui en ont longtemps été les bénéficiaires.
Mais cette crise de l’autorité est parfois tempérée, ou rendue supportable, par des formes de « médiation », au sens que Max Weber donnait à ce terme : des relais symboliques, culturels ou affectifs qui permettent de reconduire une forme d’ordre sans brutalité. Ainsi en est-il de la mère du commissaire, qui apparaît comme une figure de sagesse et de tempérance : elle le console, l’incite à dépasser son orgueil, à lâcher prise, à écouter davantage qu’à commander. Elle incarne une autorité féminine de l’ombre, médiatrice, capable de ralentir la spirale de la crispation patriarcale.
Le film compose aussi une esthétique des affects silencieux, qui rompt avec les formes démonstratives de l’amour conjugal promues dans le cinéma romantique. Ici, l’amour circule sans mots, dans des gestes modestes mais lourds de sens : lorsque le commissaire dit à son fils « va aider ta mère à la cuisine », il manifeste un souci de soin, une reconnaissance de la place de sa femme, sans jamais avoir à dire « je t’aime ». De même, l’épouse ne déclare pas sa grossesse avec emphase : elle lui tend simplement, en silence, les résultats d’une échographie. Ce geste, à lui seul, condense toute une intimité partagée, une résilience conjugale, voire un désir reconduit malgré les tensions.
Éviter l’effondrement total
L’amour filial suit le même régime elliptique. Le commissaire se rend à un match de football de sa fille aînée sans l’avertir ni s’annoncer ; il ne lui parle pas, ne l’embrasse pas, mais laisse transparaître un demi-sourire furtif, discret et pudique, trace d’une affection qu’il n’arrive pas à verbaliser. À son fils aîné, il ne dit pas non plus son admiration ou son inquiétude. Il se contente de lui demander s’il peut lui servir un autre verre de jus de foléré (ou bissap, une boisson à base d’hibiscus), geste qui, dans le contexte du film, vaut déclaration et signe de tendresse. Ces silences affectifs et ces médiations féminines ne réparent pas entièrement la perte d’autorité, mais ils évitent qu’elle ne se transforme en effondrement total. Ils dessinent une grammaire nouvelle de la masculinité blessée et fragile mais qui tient tout de même à s’affirmer, même au prix de souffrances. Ni nostalgique de l’ordre ancien ni célébration de son renversement, Indomptables dépeint, avec une justesse remarquable, les contradictions affectives et les tensions structurelles d’un ordre patriarcal en recomposition.
Une question centrale se pose cependant à l’issue du visionnage du film : comment tous ces objets apparemment disparates – enquête policière, crise de l’autorité paternelle, portrait urbain – s’articulent-ils dans un même récit ? Quel est le principe d’unité qui les sous-tend ? À première vue, le film semble échapper à toute structuration narrative conventionnelle : il n’annonce aucun plan explicite, ne se conforme pas à une trame linéaire, ne hiérarchise pas ses motifs. Et pourtant, un regard attentif laisse entrevoir un agencement sous-jacent, où ces éléments ne sont pas juxtaposés mais bel et bien entrelacés précisément par l’absence de lien qui les unit.
L’enquête judiciaire, par exemple, ne peut être pensée indépendamment du contexte urbain qui la conditionne : c’est dans les interstices de Yaoundé – ses bidonvilles et ses quartiers précarisés – que s’élaborent les mécanismes violents de production de la vérité. Ce sont les corps jeunes, marginalisés et épuisés qui sont les supports et les terrains de cette vérité extraite avec brutalité. À ce régime policier s’adosse un espace social spécifique, celui d’une ville décomposée, où se manifestent la faillite des services publics, l’extorsion dans le trafic routier et les coupures d’électricité évoquées plus haut. Plus encore, le film fait le pari audacieux de relier l’intime au politique, l’autorité domestique à l’autorité institutionnelle. Les éclats de colère du commissaire au poste de police résonnent avec les tensions de son foyer.
Écriture entrelacée et puissance des signes
Une scène frappante l’illustre : en pleine audition d’une plaignante, il reçoit un message hostile de son ex-compagne, la mère de sa première fille. Immédiatement, le commissaire interrompt l’entretien, s’agace en silence, puis revient à la déposition sans vraiment écouter. Ce détail révèle l’importance des colères et des agacements privés dans la fabrique du service public, un thème que nombre d’analyses africanistes négligent. La désinvolture, l’indifférence ou la violence de certains agents publics, notamment dans les hôpitaux, écoles ou administrations africaines, ne relève pas uniquement de facteurs structurels (bas salaires, pénurie de moyens) comme l’ont montré de nombreux travaux d’anthropologie (Yannick Jaffré et/ou Jean-Pierre Olivier de Sardan), mais aussi de charges émotionnelles et psychiques non résolues qui débordent l’espace du foyer pour rejaillir dans les arènes publiques.
Par cette mise en tension, le film propose une écriture profondément littéraire, attentive à une interprétation du monde social qui refuse les compartimentages méthodologiques et fait droit à la continuité des espaces et des sphères de vie, même sans lien apparent. Cette écriture s’apparente très clairement à ce que Gilles Deleuze observait dans la manière dont Marcel Proust écrivait, notamment dans À la recherche du temps perdu : « On part d’une première nébuleuse qui constitue un ensemble apparemment circonscrit, unifiable et totalisable. Une ou des séries se dégagent de ce premier ensemble. Et ces séries débouchent à leur tour dans une nouvelle nébuleuse, cette fois décentrée ou excentrée, faite de boîtes closes tournoyantes, de morceaux disparates mobiles qui suivent les lignes de fuite transversale11. »
En cela, Indomptables s’inscrit dans l’exigence d’une pensée « entrelacée » des temporalités et des ordres de l’expérience que revendique la sociologie historique et comparée du politique de Jean-François Bayart. Il met en œuvre ce que Henri Bergson appelait une « compénétration des durées » : passé et présent, subjectif et collectif, s’imbriquent sans hiérarchie ni causalité simple.
« Une écriture oblique et inachevée »
Dans cette optique, la réflexion de l’historien Ibrahima Thioub prend ici tout son sens. Dans sa critique de l’historiographie classique, Thioub dénonçait une écriture de l’histoire figée dans la linéarité, prisonnière de la chronologie, incapable de saisir la simultanéité des expériences ou les discontinuités fécondes. Il appelait de ses vœux une écriture plus souple, capable de restituer la pluralité des durées sociales, les reconfigurations incessantes du présent par le passé, et inversement. C’est exactement ce que le film Xala de Sembène Ousmane (1975), qu’il prend en exemple, parvient à suggérer par la structure disparate de son récit12. En ce sens, Indomptables n’est pas seulement un miroir du social, c’est un acte de pensée en soi, une manière de faire tenir ensemble des réalités et des durées éparses et de proposer un langage pour les étayer.
Mais au-delà de son contenu explicite, Indomptables propose une forme d’écriture oblique et inachevée que l’on pourrait qualifier d’écriture « suggestive », c’est-à-dire qu’elle se déploie à travers des signes qui ne sont jamais complètement élucidés ; ils restent en tension, comme s’ils gardaient en eux une part d’énigme, de refoulé ou d’indicible. Des signes ambigus, polysémiques, porteurs d’un surplus de sens qui structure la densité profonde de la société camerounaise.
Le film ne raconte pas une histoire au sens classique du terme, il tisse un réseau de signes qui ne peuvent se comprendre qu’en « situation » : gestes suspendus, regards fuyants, mots insolites, demi-silences qui sont pourtant évocateurs d’une « historicité » émotionnelle, socioculturelle et politique. C’est dans cette logique qu’il faut comprendre le recours récurrent à l’expression « salue-moi », que le commissaire adresse à divers interlocuteurs : à son fils après une désobéissance ou une bêtise, à sa femme et au même fils après qu’ils lui ont faussé compagnie, ou encore à un collègue trop zélé, réprimandé par la hiérarchie. Chaque fois, le spectateur hésite : que signifie ce « salue-moi » ? Est-ce un pardon voilé ? Une injonction autoritaire ? Une forme d’ironie blessée ? Ou simplement l’indice d’une autorité déclinante qui cherche à subsister par le langage ritualisé ? Le film ne tranche jamais. En laissant ce signe en suspens, il donne lieu à un « conflit des interprétations » dont parlait Paul Ricœur à propos de toute activité herméneutique.
Mais, au fond, cette écriture inachevée est peut-être aussi commandée par la prise en compte de la censure qui frappe toute production cinématographique, journalistique et littéraire au Cameroun, de sorte qu’un réalisateur prudent doit éviter de tout dire, de tout révéler, en prenant acte des contraintes – parfois politiques – dans lesquelles s’élabore la pensée critique dans ce pays et dans bien d’autres. Il esquive ainsi la frontalité, évite le didactisme et mise sur le pouvoir de la suggestion, sur l’économie du mot et la densité du silence. Dire sans nommer, montrer sans accuser, construire une pensée qui tient à la fois de la rigueur et de la retenue : telle semble être la logique formelle qui anime Indomptables.
Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables) :
Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables).
 Faire un don
Faire un don
Les articles présentés sur notre site sont soumis au droit d’auteur. Si vous souhaitez reproduire ou traduire un article d’Afrique XXI, merci de nous contacter préalablement pour obtenir l’autorisation de(s) auteur.e.s.
1Michel de Certeau, L’invention du quotidien, tome 1. Art de faire, Gallimard, 1990 ; Jean-Marc Ela, « Vers une économie politique des conflits au ras du sol », Africa Development, vol. 24, n° 3-4, 1999 ; Fabien Eboussi Boulaga, « La quotidienneté, étalon de nos luttes », Revue Projet, vol. 2, n° 351, 2016-1, p. 73-77.
2Gilles Deleuze, Deux régimes de fous et autres textes (1975-1995), Éditions de Minuit, 2003.
3Patrick Belinga Ondoua, « Violence politique et construction de l’hégémonie au Cameroun. Le complotisme à l’aune des pratiques coercitives à Yaoundé », Politique africaine, vol. 2, n° 170, 2023, p. 85-104.
4Michel Foucault, Surveiller et punir. La naissance de la prison, Gallimard, 1975, p. 25 et suivantes.
5Voir, par exemple, l’article d’Amnesty International, « Chambres de torture secrètes au Cameroun », 20 juillet 2017.
6Michel de Certeau, « Corps torturés, paroles capturées », dans Michel de Certeau, de Luce Giard, éditions du Centre Georges Pompidou, collection « Cahiers pour un temps », 1977.
7Raúl Sánchez de la Sierra, Kristof Titeca, Haoyang Xie, Aimable LaMeKe et Albert Malukisa Nkuku, « The Real State : inside the Congo’s traffic police agency », American Economic Review, vol. 114, n° 12, 2024, p. 3976-4014 ; Calvin Minfegue, « Les corps des tracasseries : circulation, corps et violence sur le corridor Douala–N’Djamena/Bangui », Revue canadienne des études africaines, vol. 57, n° 2, 2023, p. 283-303 ; Patrick Belinga Ondoua, « Vive la libre circulation au sein de la Cemac ! Une ethnographie du dispositif de l’enregistrement », Sociétés politiques comparées, Revue européenne d’analyse des sociétés politiques, n° 64, 2025.
8Au Cameroun, le patient est généralement admis après le versement d’une caution couvrant les premiers soins et examens. Si, à la fin de son hospitalisation, il doit encore de l’argent, il est envoyé dans une « prison » dans l’attente de la « délivrance » par sa famille une fois le solde acquitté.
9Aline Nanko Samaké, « Beyoncé, l’afropolitaine. Pop culture, Identités diasporiques et Afropolitanismes dans le film musical Black Is King », African Diaspora, vol. 16, n° 4, 2025, p. 1-38.
10Patrick Belinga Ondoua, « Faire “corps sans organes”. Essai de schizo-analyse de la ville contemporaine », Sociétés politiques comparées, n° 63, 2024.
11Gilles Deleuze, Proust et les signes, PUF, 1964, p. 205-219.
12Ibrahima Thioub, « Xala, une mise en récit a-chronologique du passé », article non publié.
13Michel de Certeau, L’invention du quotidien, tome 1. Art de faire, Gallimard, 1990 ; Jean-Marc Ela, « Vers une économie politique des conflits au ras du sol », Africa Development, vol. 24, n° 3-4, 1999 ; Fabien Eboussi Boulaga, « La quotidienneté, étalon de nos luttes », Revue Projet, vol. 2, n° 351, 2016-1, p. 73-77.
14Gilles Deleuze, Deux régimes de fous et autres textes (1975-1995), Éditions de Minuit, 2003.
15Patrick Belinga Ondoua, « Violence politique et construction de l’hégémonie au Cameroun. Le complotisme à l’aune des pratiques coercitives à Yaoundé », Politique africaine, vol. 2, n° 170, 2023, p. 85-104.
16Michel Foucault, Surveiller et punir. La naissance de la prison, Gallimard, 1975, p. 25 et suivantes.
17Voir, par exemple, l’article d’Amnesty International, « Chambres de torture secrètes au Cameroun », 20 juillet 2017.
18Michel de Certeau, « Corps torturés, paroles capturées », dans Michel de Certeau, de Luce Giard, éditions du Centre Georges Pompidou, collection « Cahiers pour un temps », 1977.
19Raúl Sánchez de la Sierra, Kristof Titeca, Haoyang Xie, Aimable LaMeKe et Albert Malukisa Nkuku, « The Real State : inside the Congo’s traffic police agency », American Economic Review, vol. 114, n° 12, 2024, p. 3976-4014 ; Calvin Minfegue, « Les corps des tracasseries : circulation, corps et violence sur le corridor Douala–N’Djamena/Bangui », Revue canadienne des études africaines, vol. 57, n° 2, 2023, p. 283-303 ; Patrick Belinga Ondoua, « Vive la libre circulation au sein de la Cemac ! Une ethnographie du dispositif de l’enregistrement », Sociétés politiques comparées, Revue européenne d’analyse des sociétés politiques, n° 64, 2025.
20Au Cameroun, le patient est généralement admis après le versement d’une caution couvrant les premiers soins et examens. Si, à la fin de son hospitalisation, il doit encore de l’argent, il est envoyé dans une « prison » dans l’attente de la « délivrance » par sa famille une fois le solde acquitté.
21Aline Nanko Samaké, « Beyoncé, l’afropolitaine. Pop culture, Identités diasporiques et Afropolitanismes dans le film musical Black Is King », African Diaspora, vol. 16, n° 4, 2025, p. 1-38.
22Patrick Belinga Ondoua, « Faire “corps sans organes”. Essai de schizo-analyse de la ville contemporaine », Sociétés politiques comparées, n° 63, 2024.
23Gilles Deleuze, Proust et les signes, PUF, 1964, p. 205-219.
24Ibrahima Thioub, « Xala, une mise en récit a-chronologique du passé », article non publié.