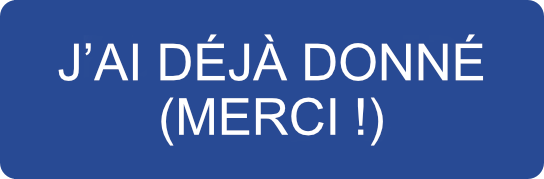Sérgio, ingénieur environnemental d’une quarantaine d’années, instruit des rapports en Afrique pour le compte d’une ONG sur la pertinence de tel ou tel projet. Grand gaillard d’une quarantaine d’années, d’allure solide et rassurante, il semble assez quelconque, mais ses yeux magnifiques suffisent à éveiller la curiosité. Il est envoyé en Guinée-Bissau pour enquêter sur la construction d’une route, dont on a du mal à saisir la pertinence, dans des zones humides où l’on se déplace en barque et où l’on vit au rythme des récoltes de riz.
Au début du film de Pedro Pinho, exceptionnel par sa durée de 3 h 30, Sérgio (Sérgio Coragem) conduit sur une route du désert un vieux break entouré de nuages de sable. Le break va finir par tomber en panne, et Sérgio s’enfonce à pied dans les brumes sableuses, presque en dansant. Le film s’inscrit dès lors dans une sorte de magie : on se demande qui est ce type, qu’est-ce qui va lui arriver. Pour l’heure, on l’attend à Bissau, où son prédécesseur a eu « des problèmes » et a d’ailleurs disparu.
Disparaître du cadre
L’ouverture à la fois brumeuse et magistrale du Rire et le Couteau pose à la fois la problématique du film, la solitude humaine, la grandeur et la puissance de la nature, auxquels va se confronter Sérgio. On peut le dire d’emblée : l’acteur est formidable, comme le personnage qu’il incarne, tout aussi brumeux que le désert qu’il traverse pour rejoindre Bissau. Sérgio semble souvent disparaître du cadre. Il est pourtant présent à chacune des séquences, participe aux nombreuses discussions qui émaillent le film. Mais il reste le plus souvent taiseux, s’étonne d’un regard ou d’un froncement de sourcils et s’endort parfois n’importe où et à n’importe quelle heure. Il ne fuit pas les discussions mais n’apporte guère de réponses. Il écoute, mais que comprend-il ?
Il va très vite rencontrer Diára (Cleo Diára), qui lui pose la question à la fois de base et fondamentale, « pourquoi es-tu ici ? », et son meilleur ami, Gui (Jonathan Guilherme). Espiègle, adepte des perruques et des artifices capillaires souvent somptueux, Diára (prix d’interprétation « Un certain regard » à Cannes 2025), est avec Gui au centre des nuits de Bissau. Gui est, lui, venu du Brésil et s’habille en femme. Sérgio va tenter de les apprivoiser, d’aimer l’une et l’autre, et le film prend une tonalité queer en dynamitant les genres avec des désirs croisés, surprenants, des corps qui se cherchent, se partagent et se donnent.
Des amitiés moqueuses
Personnages passionnants et hyper touchants, Diára et Gui, au-delà de leur amitié moqueuse pour Sérgio, qui pourtant les exaspère aussi (« regardez comme il essaye de s’intégrer comme si tout allait bien »), sont au centre d’une galaxie de personnages, familles, amis, nouveaux riches, nostalgiques de l’épopée décoloniale, paysannes lucides, qui apportent à chaque parole les mots justes, parfois doux et parfois féroces, ceux qui touchent au cœur.
Dans ce pays où la population pratique cinquante langues, Sérgio passe du créole au portugais, du français à l’anglais, et ses paroles deviennent aussi hésitantes que son personnage, qui, lui, a du mal à trouver le mot juste. L’ambiguïté de sa mission l’en empêche, mais il n’a pas le cynisme des gens revenus de tout, ni le racisme décomplexé de ces ouvriers blancs sauf pour les femmes qu’ils achètent, ni la condescendance ridicule des missionnaires d’ONG qui ne font que passer.
Le réalisateur Pedro Pinho se livre avec un scénario ultraprécis et des dialogues exceptionnels de justesse à une plongée qui fracasse tout, sans pour autant donner de leçons. Il filme la « politique » dans ce qu’elle a de meilleur, c’est-à-dire le service du bien public. Ici tout est à nu, même les comédiens, dans des scènes de sexe rarement vues dans un film grand public, mais à hauteur humaine. On saisit parfaitement les enjeux cachés, la corruption, les projets absurdes, peut-être même le meurtre.
Tout est à nu
Tout est à nu car les questions de Pinho sont aussi fondamentales qu’éternelles. Qui est Blanc ? Qui est Noir ? Qui est colonial ? Qui est postcolonial (et en quoi est-ce différent ?) ? Qui a raison ? Qui a tort ? Qui est homosexuel ? Qui est hétérosexuel ? Le personnage incertain qu’est Sérgio indique qu’aucune réponse n’est simple. Mais en ces temps de certitudes martelées, où Hollywood commence à s’abandonner au suprémacisme trumpiste, rance et raciste, Le Rire et le Couteau fait un bien fou.
Que ce film ait un réalisateur portugais et soit tourné en Afrique, avec des producteurs entre autres français, va évidemment a contrario de ce monde péremptoire. Car avec son climat d’incertitudes, ses défis à la vie et à l’amour, ce film nous montre que rien n’est simple, mais que rien n’est perdu non plus. Il n’est pas seulement l’addition d’une longue série de questions mais aussi une forme de réponse, sur un sujet aujourd’hui aussi central qu’universel : fuir et se cacher ou rester et résister. Les paysannes qui ne veulent pas abandonner leurs barques ancestrales au profit d’une route néocapitaliste aux vagues intérêts chinois en savent quelque chose.
La durée hors du commun ne doit donc pas inquiéter. D’ailleurs, une version intégrale de 5 h 15 sortira en septembre. Expérience faite, c’est bien moins ennuyeux qu’un défilé du 14-Juillet à la télévision. Et bien moins bête aussi.
Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables) :
Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables).
 Faire un don
Faire un don
Les articles présentés sur notre site sont soumis au droit d’auteur. Si vous souhaitez reproduire ou traduire un article d’Afrique XXI, merci de nous contacter préalablement pour obtenir l’autorisation de(s) auteur.e.s.