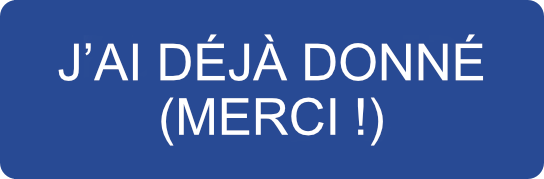Un garçon de 12 ans retrouvé dans une lagune avec des « blessures sur son corps liées à des bastonnades », selon la Ligue togolaise des droits de l’homme (LTDH), des tirs de lacrymogènes et l’utilisation de balles réelles, des citoyens battus et pourchassés jusque dans leurs maisons... Les Togolais sont encore sous le choc à la suite de la répression des manifestations des 26, 27 et 28 juin à Lomé, la capitale du pays. Des vidéos, comme celle qui montre des forces de l’ordre tabassant un homme et le laissant pour mort1, ont fait le tour des réseaux sociaux.
Selon un bilan provisoire de la société civile, les manifestations ont fait au moins sept morts, dont des mineurs, des dizaines de blessés et d’arrestations, et trente et une personnes ont été placées sous mandat de dépôt. Le 4 juillet, dix-huit ont finalement été condamnées à douze mois de prison, dont onze avec sursis, lors d’un procès expéditif2. Amnesty International dénonce même la présence de « miliciens » avec un « recours inutile et excessif de la force et de la violence ».
De son côté, dans un communiqué du 30 juin, l’exécutif togolais parle de « fausses informations », d’une « campagne de désinformation et d’incitation à la haine, à la violence, à l’incivisme et à la désobéissance civile » sur les réseaux sociaux et certains médias. France 24 et RFI sont suspendus depuis mi-juin. Les autorités louent le « professionnalisme » des forces de sécurité et mentionnent des morts par « noyade ». Le 6 juillet, la justice togolaise a annoncé3 une enquête après le décès de cinq personnes repêchées dans des cours d’eau.
Vingt ans de contestations réprimées
Ces scènes de grandes contestations populaires suivies de fortes répressions, le Togo en a déjà connu. Dans les années 1990, des civils avaient été tués lors de manifestations pour la démocratie. En 2005, au moins 800 morts et plus de 4 000 blessés avaient été recensés4 par la société civile dans des protestations suite à la succession de Faure Gnassingbé, à la mort de son père Étienne Eyadéma Gnassingbé, qui dirigeait le pays d’une main de fer depuis 1967.
En 2012-2013, d’autres personnes ont perdu la vie lors des manifestations pour exiger des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Et en 2017-2018, de fortes contestations ont soulevé le pays pour obtenir la limitation des mandats présidentiels et une gouvernance inclusive. Elles ont abouti à de nouveaux morts et à des arrestations – certains contestataires sont toujours en prison en dépit des demandes de libération par la Cour de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao).
L’histoire semble donc se répéter. Avec quelques nouveautés cependant. D’abord, les manifestants sont de plus en plus jeunes. Ensuite, et surtout, des dissensions internes parmi les proches du pouvoir apparaissent plus clairement.
« Entre Kabyès, quand on conteste, la répression est plus dure »
Les récentes protestations ont éclaté après l’arrestation le 26 mai dernier du rappeur Aamron. Artiste populaire au Togo, il avait, durant plusieurs semaines, vivement critiqué Faure Gnassingbé sur les réseaux sociaux. Amené dans un asile psychiatrique, à Zébé, il en est ressorti le 21 juin à la suite de la pression populaire lors de manifestations spontanées les 5 et 6 juin, le tout amplifié par des activistes de la diaspora sur les réseaux sociaux.
« Juste après son enlèvement, on l’a conduit au SCRIC [Service central de recherches et d’investigations criminelles], où il a été soumis à la torture physique et morale », détaille à Afrique XXI Célestin Agbogan, son avocat et président de la Ligue togolaise des droits de l’homme. « De là, on l’a conduit à un autre endroit après lui avoir bandé les yeux. Ses détracteurs lui ont rasé barbe et cheveux, avant de le conduire directement à l’hôpital psychiatrique, où il a même reçu plusieurs injections, sous prétexte de lui prodiguer des soins », poursuit-il. « On ne sait toujours pas de quelles injections il s’agit et, aujourd’hui, il reste affaibli, il a du mal à marcher… Il suit des séances de kinésithérapie », confie le frère du rappeur, Lao-Dja Songdou Tchala.
Fils d’un colonel à la retraite, Aamron n’est autre que le petit-fils du chef des Kabyès, la communauté d’origine des Gnassingbé – bien que la mère de Faure Gnassingbé soit ewe (du sud du Togo). « Il avait été informé de son arrestation la veille, ainsi que du plan consistant à le faire passer pour un fou. Il pensait même se faire tuer. Entre Kabyès, quand on conteste, la répression est plus dure », partage encore son frère.
Le rappeur a été enlevé à son domicile, sans mandat d’arrêt, par des dizaines de personnes en tenue militaire et cagoulées et une poignée d’hommes de la région de la Kara, région des Kabyès (parmi eux, des militaires ou ex-militaires gradés et d’ex-agents publics), selon Lao-Dja Tchala. Le jeune artiste a été perçu comme un porte-parole par une partie de la jeunesse togolaise, et son enlèvement a été vivement critiqué, jusque dans la communauté kabyè.
Avec la réforme constitutionnelle, « le verre était plein »
Le ras-le-bol était déjà latent chez de nombreux Togolais. Dans cet État de 9,3 millions d’habitants, classé dans la liste des pays les moins avancés, le coût de la vie a augmenté subitement en mai 2025, notamment le prix du kilowattheure. Une épreuve sociale de trop, aux yeux de plusieurs citoyens, malgré l’annonce de mesures d’atténuation par les autorités.
De plus, en 2024, le pouvoir a changé la Constitution, passant d’un régime présidentiel à un régime parlementaire. Le 3 mai, le président de la République, Faure Gnassingbé, est devenu officiellement président du Conseil, sans limite de mandats et choisi par un Parlement majoritairement acquis à sa cause. « Le verre était plein », explique Kodjo, un conducteur de taxi-moto dans la capitale. « En plus, peu de Togolais mangent deux repas par jour, la colère commençait doucement à gronder, surtout sur la Toile », conclut-il.
Même au sein de l’Union pour la République (Unir, le parti présidentiel), certains aspects du changement de régime ont eu du mal à passer. Lors du choix du nouveau président de la République (un poste devenu honorifique, alors que le président du Conseil garde la majeure partie du pouvoir exécutif), le nom de Savi de Tové a été « comme imposé » aux Parlementaires de l’Unir, décrit une députée de ce parti sous le couvert de l’anonymat. « Il n’y a pas vraiment eu de consultation du Congrès, ni d’élection, comme cela aurait dû être fait5 », partage cette source.
« Il est temps que la volonté du peuple soit respectée »
La tension a surtout pris de l’ampleur après la sortie d’Essossimna Marguerite Gnakadè, l’ancienne ministre de la Défense (de 2020 à 2022). Le 2 mai dernier, elle a publié une tribune feutrée mais avec un ton offensif. Dans un pays où les voix discordantes sont régulièrement réprimées, cette tribune d’une ex-officielle en a étonné plus d’un. Le rappeur Aamron s’en est emparé, la décortiquant dans l’une de ses dernières vidéos en ligne. Probablement la vidéo de trop pour le pouvoir.
Dans cette tribune, Marguerite Gnakadè explique :
Depuis deux décennies, le peuple togolais fait preuve d’un courage remarquable face à l’adversité. Il endure, espère, se mobilise... Mais trop souvent, il est réduit au silence. Aujourd’hui, alors que le pays traverse une nouvelle phase de crispation politique et d’incertitude démocratique, je prends la plume pour affirmer ceci : il est temps que la volonté du peuple togolais soit enfin respectée.
Elle souligne encore : « Quel est le véritable bilan de Faure Gnassingbé après deux décennies de règne ? […] En dépit de plus de 15 000 milliards de FCFA [23 milliards d’euros] injectés dans l’économie togolaise, les résultats tangibles sur l’amélioration des conditions de vie des Togolaises et Togolais peinent à prendre corps. » Elle n’a pas hésité non plus à dénoncer la corruption au sommet de l’État. Les objectifs économiques « ne peuvent être atteints que s’il y a une réduction significative des détournements de deniers publics et l’instauration de la fin de l’impunité des crimes économiques ».
Gilbert Bawara, ministre porte-flingue
Depuis ce premier brûlot, Marguerite Gnakadè a écrit d’autres lettres, appelant à la libération des « prisonniers politiques », puis s’indignant contre la « répression organisée contre les hommes et les femmes togolais, qui manifestent pacifiquement », suite aux protestations des 26, 27 et 28 juin.
De son côté, le gouvernement a réagi à ses prises de position, notamment à travers le ministre du Travail, Gilbert Bawara, dans Jeune Afrique le 26 juin :
J’observe que mon ancienne collègue fait l’objet d’une grande indulgence et d’une grande mansuétude, notamment de la part de médias généralement prompts à déverser leur bile sur les autorités. Je remarque aussi qu’elle n’assume aucune responsabilité dans l’action publique qu’elle dénonce, alors qu’elle a exercé d’importantes responsabilités à la tête d’entreprises publiques et au sein du gouvernement.
Depuis fin mai, l’ex-ministre des Armées réside à son domicile à Lomé, elle est libre de ses mouvements mais « reste prudente », affirme une source proche à Afrique XXI. Femme discrète, âgée d’une soixantaine d’années, elle est difficilement approchable des journalistes, même quand elle était en poste au ministère des Armées. Originaire du canton de Tchitchao, voisin de celui des Gnassingbé, Pya, elle a fait des études d’économie en France. De retour au Togo, elle a longtemps travaillé à la Banque internationale pour l’Afrique (BIA-Togo), puis un temps à la Cour des comptes, avant de prendre la tête de la Banque togolaise pour le commerce et l’industrie (BTCI), puis d’être promue ministre. Marguerite Gnakadè est aussi la sœur du majordome de Faure Gnassingbé, Darius Gnakadè, qui s’est désolidarisé publiquement des sorties de son aînée.
Le gouvernement l’empêche de créer son parti
Marguerite Gnakadè a par ailleurs un lien familial avec le président Faure Gnassingbé : elle a longtemps été mariée à son grand frère, Ernest Gnassingbé, décédé en novembre 2009. Le couple a eu plusieurs enfants avant de se séparer, autour des années 2000. Lieutenant-colonel, longtemps patron de l’appareil répressif au Togo, Ernest Gnassingbé a été considéré un temps comme le dauphin dans la succession à son père – étant l’aîné des fils Gnassingbé. Mais sa santé s’est dégradée dès la fin des années 1990. De nombreux Togolais le décrivaient même comme un tyran imprévisible. En 2005, à la mort de son père, il n’était déjà plus question qu’il prenne les rênes du pouvoir.
Première femme au Togo à diriger l’appareil militaire, elle est finalement évincée de ce poste, et son ministère est ensuite rattaché à la Présidence. « Quelques mois après son éviction, elle a voulu créer un parti politique, confie une source proche. Cela a suscité beaucoup de remous au sein de l’appareil de l’État et du parti présidentiel. Tout a été fait pour l’empêcher de fonder son parti, déjà en ne lui délivrant pas son certificat d’origine. »
En plus de l’arrestation d’Aamron, la prise de position de Marguerite Gnakadè est en train de diviser plus largement dans la région de la Kara. Depuis 2017, plus aucune manifestation ne s’est tenue dans la région, mais des Kabyès, souvent depuis l’étranger, continuent de s’exprimer sur les réseaux sociaux, invectivant le pouvoir actuel et plaidant pour un Togo dans lequel les richesses nationales profiteraient à tous les Togolais. « Même des informations jadis cachées sortent progressivement sur les réseaux sociaux à travers la diaspora [de la région] », explique une source kabyè. Fin juin, des chefs et des cadres du canton de Tchitchao se sont réunis pour discuter de « l’analyse des causes de la récurrence des voix dissidentes et résistantes portées par des personnalités de leur canton » après la « prise de position politique » de Marguerite Gnakadè. La réunion a provoqué des débats mais n’a pas abouti à une condamnation des propos de l’ex-ministre, ce qui est remarquable.
Kpatcha Gnassingbé, Kadangha Abalo... Des condamnations qui divisent
Au Togo, la communauté kabyè est au cœur du pouvoir depuis la présidence de Gnassingbé père. Ce dernier avait succédé à Nicolas Grunitzky (1963-1967) et l’officier Kléber Dadjo (janvier à avril 1967), qui avaient conduit une transition après l’assassinat, lors d’un coup d’État en janvier 1963, du père de l’indépendance, Sylvanus Olympio, originaire du sud du pays. Selon des archives françaises, Étienne Eyadéma Gnassingbé a été impliqué dans son meurtre.
Beaucoup de cadres militaires des Forces armées togolaises proviennent de la région de la Kara, en particulier des cantons de Tchitchao et Pya, même si cette tendance s’est atténuée depuis 2005. « Longtemps, on a fait croire aux Kabyès que s’ils perdaient le pouvoir les gens du Sud allaient se révolter contre eux et même commettre un génocide », explique une source du sérail. Mais, aujourd’hui, « beaucoup ne pensent plus ainsi », conclut-elle.
Avec le temps, la communauté s’est divisée et des griefs sont apparus. D’une part, la région ne s’est pas développée autant que l’auraient souhaité ses habitants. D’autre part, l’emprisonnement depuis avril 2009 de Kpatcha Gnassingbé (ex-ministre de la Défense, frère de Faure Gnassingbé), pour « complot contre la sûreté de l’État », laissant ainsi le pouvoir total à son frère, n’a pas été du goût de tous.
Soutenu par l’armée et non condamné à l’international
En 2023, la condamnation du général Kadangha (beau-frère des Gnassingbé), pour « complicité d’assassinat » d’un colonel, a accentué la division interne. Apollinaire Mewenemesse, directeur de publication du journal La Dépêche et natif de la Kara, a même été emprisonné un temps pour avoir écrit un article titré6 : « Et si le Général Kadangha Abalo était le Capitaine Dreyfus du Togo ? », en référence à la célèbre affaire française de la fin du XIXe siècle.
Avant Marguerite Gnakadè, quelques personnalités de la région s’étaient déjà opposées au pouvoir en place, comme le commandant Olivier Amah (venu du Pya) et l’ex-ministre de l’Intérieur François Boko (de Tchitchao), tous deux en exil, mais aussi l’ex-ministre de la Justice et opposant Abi Tchessa, ou encore Dahuku Péré (de Bohou), ancien président de l’Assemblée nationale, devenu opposant, et décédé en 2021.
Mais tel un sphinx, Faure Gnassingbé a toujours su renaître de ses cendres après chaque poussée de fièvre politique. Soutenu par les forces de l’ordre qui lui ont de nouveau fait allégeance le 3 mai au terme de sa prestation de serment comme président du Conseil, il s’appuie aussi sur des divisions entre opposants ou membres de la société civile. Tandis qu’il reste bien souvent épargné par les condamnations à l’international, en premier lieu de la France, qui a toujours soutenu la famille Gnassingbé.
Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables) :
Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables).
 Faire un don
Faire un don
Les articles présentés sur notre site sont soumis au droit d’auteur. Si vous souhaitez reproduire ou traduire un article d’Afrique XXI, merci de nous contacter préalablement pour obtenir l’autorisation de(s) auteur.e.s.
5Selon l’article 35 de la nouvelle Constitution, le président de la République est élu par le Parlement réuni en congrès. Lire par exemple Isidore Kouwonou, « Ce qui va changer au Togo avec l’adoption de la nouvelle constitution », BBC News Afrique, 4 juin 2024.
11Selon l’article 35 de la nouvelle Constitution, le président de la République est élu par le Parlement réuni en congrès. Lire par exemple Isidore Kouwonou, « Ce qui va changer au Togo avec l’adoption de la nouvelle constitution », BBC News Afrique, 4 juin 2024.