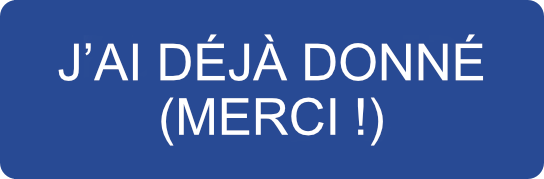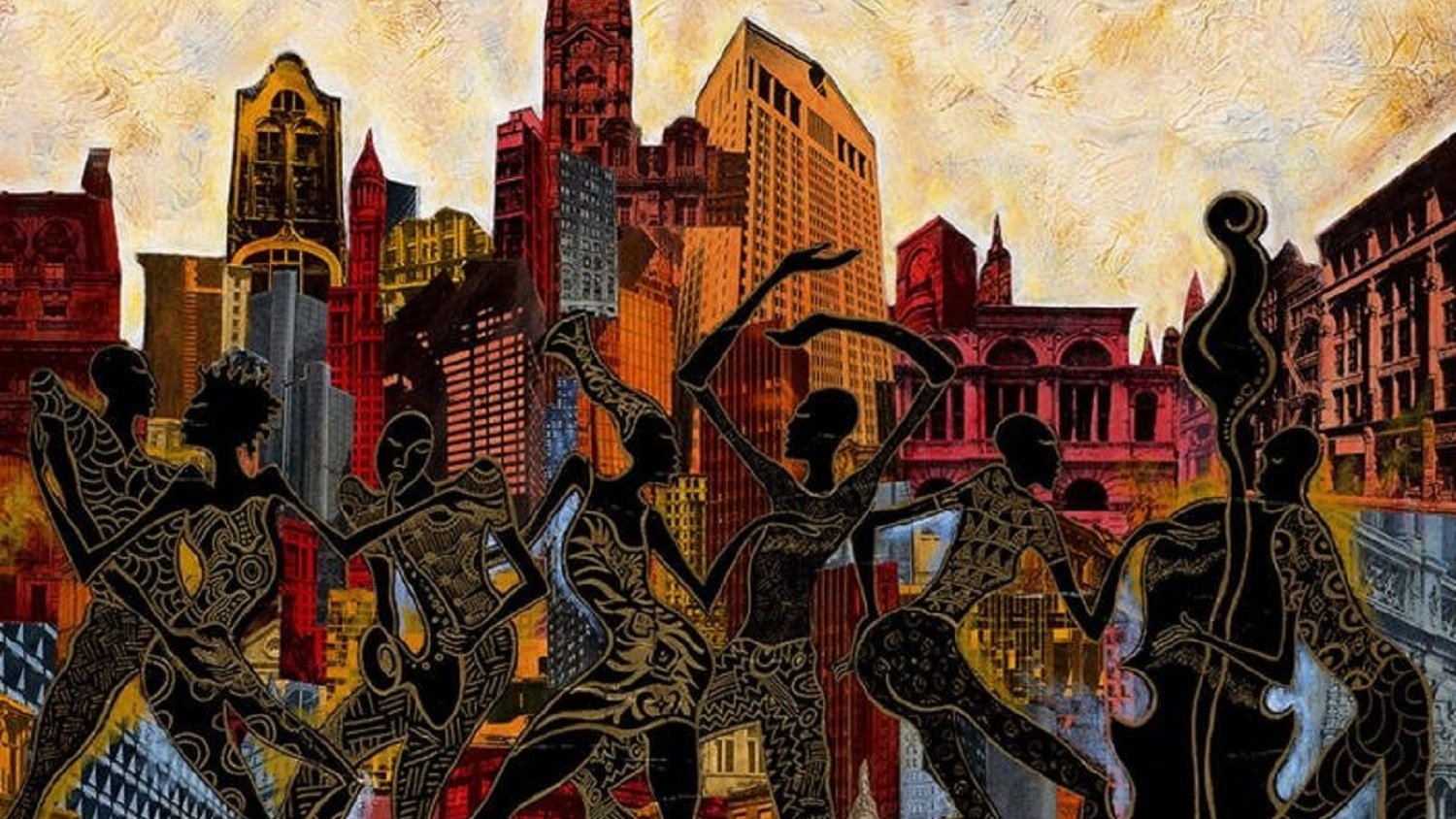
ÉDITO
SANS ÉDUCATION ET SANS PRESSE INDÉPENDANTE, LA « DÉMOCRATIE ÉLECTORALE » EST COMPROMISE
La « démocratie électorale » existe-t-elle encore lorsqu’un candidat remporte un scrutin présidentiel avec plus de 90 % des voix ? Est-il possible qu’un peuple porte au pouvoir un candidat dans un engouement quasi général sans que l’élection ne soit truquée ? En 1992, dans son essai La Fin de l’histoire et le dernier homme (The End of History and the Last Man, Free Press), largement critiqué et commenté depuis, Francis Fukuyama annonçait « la fin de l’histoire » avec la victoire de la « démocratie libérale ». Au même moment, le multipartisme faisait son apparition dans de nombreux pays africains, suscitant l’espoir de joutes électorales honnêtes. Les deux décennies qui ont suivi ont vu de nombreux commentateurs (politiques, journalistes, ONG...) s’interroger sur la santé démocratique d’un pays dès lors que le score semblait anormal.
Or, un peu plus de trente ans après, le score du président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, déclaré vainqueur le 13 avril avec 94,85 % des votes, n’a pas vraiment surpris. Élu face à sept autres candidats pour un mandat de sept ans, c’est la première fois depuis 1967 que l’élection n’est pas remportée par un Bongo (Omar d’abord, puis, après sa mort en 2009, son fils Ali, renversé par Oligui Nguema en août 2023). Et plutôt que de parler de suspicion de fraude électorale (ce qui a été systématiquement le cas avec Ali Bongo), sa victoire a été qualifiée de « plébiscite ».
En 2024, sous (presque) les mêmes latitudes mais de l’autre côté du continent, la quatrième élection du président rwandais, Paul Kagame, avec 99 % des voix, n’avait pas étonné grand monde, tandis que les deux autres candidats se partageaient des miettes. Certes, ce score avait suscité quelques commentaires dans les ONG : Human Right Watch avait pointé du doigt la pression contre les journalistes et la société civile à l’approche du vote. Mais l’Union européenne était restée muette tandis que le Département d’État états-unien avait salué « les efforts déployés par le Rwanda pour accroître la participation démocratique [et] renforcer le respect des droits civils et politiques », rappelait l’agence de presse Reuters. Dans un reportage, Afrique XXI a du aussi faire un constat, il est vrai, difficile à entendre : quand bien même les quelques voix discordantes se trouvent réprimées, les jeunes ont voté massivement pour Paul Kagame et la population semble adhérer au discours sécuritaire et à la politique économique mis en place depuis la fin du génocide des Tutsis en 1994 – traumatisme qui n’est pas étranger à cette situation.
Ces scores ne sont pas nouveaux en Afrique mais le contexte est bien différent. Assez logiquement, il n’était pas rare de les observer du temps des partis uniques : en RD Congo, Mobutu Sese Seko avait remporté le scrutin de 1984 avec 99,16 % des voix ; au Sénégal, Léopold Sédar Senghor remportait celui de 1963, sans opposition, avec 94,2 % ; Julius Nyerere, le président tanzanien, était élu pour un cinquième mandat par 95,5 % des votes (Ali Hassan Mwinyi, son successeur fera le même score cinq ans plus tard) ; Paul Biya, seul candidat en 1984 et 1988, l’emportait à chaque fois avec 100 % des votes… Etc. Le multipartisme n’aurait-il pas dû mettre fin à ces mascarades ?
Depuis 1979 en Guinée équatoriale, les élections à répétition de Téodoro Obiang Nguema Mbasogo avec entre 94 % et 98 %, n’émeuvent plus grand monde, tout comme le troisième mandat d’Alassane Ouattara, en 2020, avec 94,27 %, face à une opposition qui avait décidé de boycotter le scrutin. La prochaine présidentielle, qui doit se tenir en octobre, s’annonce du même acabit : si le président sortant n’a pas encore dit s’il briguerait un quatrième mandat (la constitution ivoirienne n’en prévoit que deux), le principal opposant, Tidjane Thiam, a été écarté sous prétexte d’avoir perdu sa nationalité ivoirienne dans les années 1980 et de l’avoir récupérée trop tard pour prétendre au poste suprême.
Dans le monde, bien d’autres États dit « démocratiques » affichent des scores similaires. En 2020, l’Islandais Guðni Jóhannesson a été réélu avec 92,18 % des votes. Une victoire qualifiée de « triomphale » par la presse internationale qui mettait en avant l’extrême popularité du candidat sortant – et écartait donc une éventuelle fraude. En Corée du Sud, jusqu’au début des années 1980, le président était élu avec entre 90 % et 100 % des voix.
La joute électorale n’est pas un critère suffisant pour déterminer si, oui ou non, le pays concerné est un État démocratique. Le niveau d’information des électeurs tout comme leur niveau de formation sont les garants de la bonne santé d’un État qui se revendique « démocratique ». Or ces deux curseurs sont désormais très bas, dans un contexte mondial de « vérité alternative », de retour des politiques impérialistes et de recul des libertés individuelles.
« Le monde traverse une crise des apprentissages » écrivait la Banque mondiale (la faute à qui ? a-t-on envie de demander...) dans le sillon de la crise du Covid-19. Non seulement le retard dû à la pandémie n’a pas été rattrapé mais, surtout, cette « crise » existait auparavant. Aujourd’hui, « dans 4 pays sur 10, les dépenses liées à l’éducation représentent moins de 15 % des dépenses publiques totales et moins de 4 % du PIB », selon l’ONG Action éducation.
De son côté, l’état de la presse est de plus en plus désastreux. Alors que celle-ci est censée offrir une information fiable afin de donner aux citoyens les armes nécessaires pour faire un choix éclairé, « les conditions d’exercice du journalisme sont mauvaises dans la moitié des pays du monde », écrit Reporters sans frontières dans son dernier classement tout juste publié. Selon l’organisation, « les médias sont aujourd’hui pris en étau entre la garantie de leur indépendance et leur survie économique ». La précarité de la presse fragilise les médias indépendants et renforce les médias de propagande soutenus par des milliardaires ou des dictatures. Récemment, l’enlèvement de journalistes au Burkina Faso a illustré de manière éclatante la situation. En France, l’offensive des milliardaires et la montée de l’extrême droite sont intimement liées.
Ce qui semblait clair hier ne l’est plus aujourd’hui : la « démocratie électorale » existe-t-elle encore ? Son modèle est-il viable dans un monde où l’obscurantisme gagne du terrain ? Faut-il imaginer un autre mode de gouvernance le temps de « réparer » ce qui ne va plus ? Sans réponse, ces questions favorisent l’instabilité et privent les peuples de leurs droits à être dignement représentés – et non juste (mal) « gouvernés ».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
À LIRE
S’ARMER FACE AUX IDÉES REÇUES SUR L’AFRIQUE
Comment s’armer pour faire face aux clichés racistes sur le continent africain ? Dans Afriques : idées reçues sur un continent composite, paru en février aux éditions Le Cavalier Bleu, la maîtresse de conférences en science politique Sonia Le Gouriellec donne des clés indispensables pour répondre en toute circonstance.
« L’Afrique est surpeuplée », « les Africains n’ont pas d’histoire » ou encore « l’Afrique est condamnée à la pauvreté » : l’autrice corrige et nuance une quinzaine de lieux communs ancrés dans l’imaginaire collectif depuis des décennies, voire des siècles.
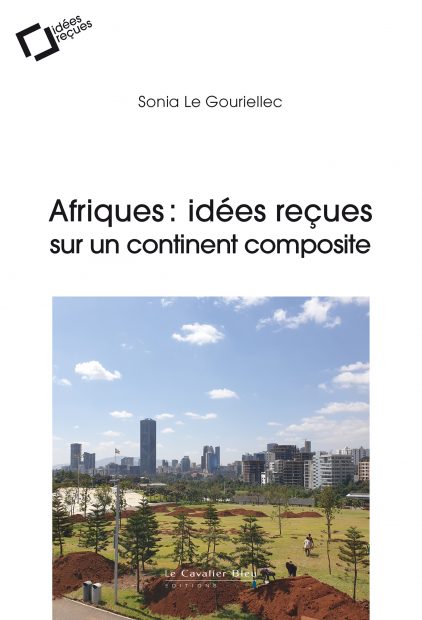
Son travail évolue entre quatre grandes thématiques : les histoires, les sociétés, les politiques/l’économie et les enjeux contemporains des Afriques dans le monde. Et ce n’est pas une erreur, mais bien un choix de l’autrice, de parler des Afriques au pluriel, pour en souligner la complexité. Elle redonne ainsi une profondeur aux discours sur l’Afrique et fait un sort à la vision uniformisante d’« un seul grand pays ».
Dans le chapitre « Il n’y a pas de création en Afrique », l’autrice présente l’exemple nigérian de Nollywood, une industrie cinématographique parmi les plus prolifiques du monde. Elle ajoute que, plus généralement, le marché africain du divertissement a connu une croissance annuelle de 15 % entre 2020 et 2025.
« L’idée était de banaliser l’objet “Afriques”, un continent dont les caractéristiques ont été produites par ses observateurs », confie Sonia Le Gouriellec à Afrique XXI. L’autrice s’inscrit dans la lignée de philosophes comme l’États-unien Valentin-Yves Mudimbe, auteur de L’invention de l’Afrique (1988), et elle propose de sortir d’un récit européano-centré pour penser le continent.
« J’ai voulu montrer une autre histoire : celle que l’on ne raconte jamais. » Pari réussi. Fruit d’un effort pédagogique de vulgarisation, son ouvrage s’adresse en premier lieu au grand public et permet d’accéder à tous les concepts mobilisés. La lecture en est fluide et donne matière à réfléchir sur nos préjugés sur le continent.
Alexia Sabatier
À lire : Sonia Le Gouriellec, Afriques, idées reçues sur un continent composite, Le Cavalier Bleu, 184 pages, 21 euros.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
LES ARTICLES DE LA SEMAINE
Burkina Faso. La fabrique étatique de la violence
Analyse Gagné, à partir de 2016, par l’insécurité venue du Mali voisin, le Burkina Faso a vu l’implantation massive de groupes djihadistes sur son territoire. Au fil des ans et des ruptures politiques, le pays a progressivement plongé dans la guerre civile. Depuis l’arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, on observe une fabrique étatique de la violence : militaire, civile et politique.
Par Tanguy Quidelleur
Le M23 ravive la peur d’une « balkanisation » de l’est de la RD Congo
Enquête Entre les annexions de pans entiers du Kivu par les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, et le retour de l’armée ougandaise dans l’Ituri, pour officiellement lutter contre des groupes armés, de nombreux Congolais redoutent le morcellement de leur pays au profit de leurs voisins.
Par Paul Lorgerie
Le Tata de Chasselay ou la suite de l’imposture mémorielle
Enquête La chercheuse Armelle Mabon poursuit sa quête de vérité quant aux tirailleurs sénégalais enterrés au Tata de Chasselay. Après avoir révélé que les tests ADN qui avaient soi-disant permis d’identifier ces dépouilles étaient bidon, elle se heurte désormais à une administration qui refuse de transmettre les documents à partir desquels le travail d’identification aurait été possible...
Par Armelle Mabon
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
IN ENGLISH
From the U.S. to Nigeria : How a ‘Christian Genocide’ Narrative Is Being Manufactured
Analysis In the United States, Christian political leaders – particularly evangelicals – claim that believers in Nigeria are victims of violence, even a so-called ‘genocide ‘. Political scientist Marc-Antoine Pérouse de Montclos, a specialist in violence in Africa, questions the scientific methodology behind the studies supporting these claims, as well as the biases of those promoting such narratives.
By Marc-Antoine Pérouse de Montclos
Vous aimez notre travail ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables) :
Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables).
 Faire un don
Faire un don
Les articles présentés sur notre site sont soumis au droit d’auteur. Si vous souhaitez reproduire ou traduire un article d’Afrique XXI, merci de nous contacter préalablement pour obtenir l’autorisation de(s) auteur.e.s.