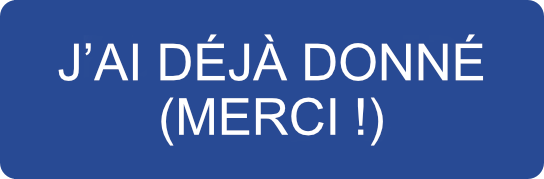Bandrélé et Mamoudzou, Mayotte. Après le passage du cyclone Chido, le 14 décembre 2024, il a d’abord fallu vérifier que ses proches étaient sains et saufs. Les jours suivants, trouver de l’eau et de la nourriture est devenu un combat quotidien, entre l’absence d’eau courante et les rayons vides des magasins. Les jours passant, les habitants ont tenté de réparer leurs maisons avec des bâches et des tôles. Trois mois plus tard, l’île reste dévastée mais, surtout, les esprits sont durablement marqués.
Le bilan officiel de la préfecture du département évoque 40 morts et 41 disparus. Des chiffres contestés. Le 8 janvier, le sénateur Saïd Omar Oili a indiqué avoir posé des questions aux services de l’État, mais n’avoir « jamais eu de réponses » : « On n’a pas cherché tous les disparus. » Par-delà les chiffres, un silence lourd et oppressant s’est installé. Déjà fragilisés par des années d’insécurité, aujourd’hui livrés à eux-mêmes, les habitants de Mayotte font face à un mal moins visible que les maisons détruites et les corps meurtris : les séquelles psychologiques laissées par Chido pourraient avoir des conséquences autrement plus profondes.
Parfois, Chido n’a fait que raviver certains traumatismes existants, alors que la santé mentale des habitants de Mayotte était déjà préoccupante avant son passage. Une enquête menée par l’Insee en 20201 révélait que 59 % des habitants de Mayotte âgés de 14 ans et plus se sentaient « souvent ou parfois » en insécurité (contre 19 % dans l’Hexagone), que ce soit à domicile (48 %) ou dans leur village ou quartier (52 %).
« La pire chose qui pouvait arriver »
Le témoignage d’Amina, une jeune femme d’origine malgache, illustre l’impact de ces événements sur la santé mentale des habitants. En février 2024, lors des barrages organisés par le collectif Les Forces vives de Mayotte, qui dénonçaient l’insécurité et la crise migratoire, elle est violemment agressée. « Quand je suis rentrée chez moi, à Kawéni, [au nord de Mamoudzou, NDLR], des délinquants m’ont lancé des pierres, j’étais blessée, personne n’est venu m’aider », raconte-t-elle. Jusqu’au passage du cyclone, elle se faisait suivre au centre médico-psychologique de Mamoudzou.
Depuis le passage de Chido, les troubles d’Amina n’ont pas cessé, mais elle ne peut plus se rendre dans les centres médicaux pour recevoir des soins. « Je n’ai pas le temps d’y aller. Il faut que je trouve du travail », explique-t-elle, évoquant la destruction de l’appartement où elle effectuait des ménages et l’urgence de survivre au jour le jour.
« Le cyclone a réveillé tout ce qui avait été difficile ces dernières années, explique une psychologue du Centre hospitalier de Mayotte (CHM). Les opérations policières de Wuambushu2, la crise de l’eau, les barrages, et l’insécurité... C’était une année déjà très difficile. Le cyclone a été la pire chose qui pouvait nous arriver », rapporte-t-elle.
« Au niveau psychologique, ça va mal »
Houssein a lui vu son état se dégrader au fil des semaines. Quarante-huit heures après le passage du cyclone, ce jeune homme né sur l’île d’Anjouan (Comores), qui vivait dans le quartier de Doujani, dans le sud de Mamoudzou, expliquait : « Je vais bien, nous tous ça va. Mais je n’ai plus rien. On ne sait pas comment on va vivre mais c’est comme ça. » Plusieurs semaines après le cyclone, le ton de sa voix est devenu grave et son épuisement est palpable. Il vit désormais dans une petite chambre dans le quartier de Cavani : « Au niveau psychologique, ça va mal. Je me force pour avoir un peu de sous, sans quoi je serais KO », admet-il.
Avant le cyclone, Houssein travaillait comme chauffeur en scooter, une activité qui lui permettait de subvenir à ses besoins. Mais la destruction des routes et des infrastructures a ruiné ses revenus. Aujourd’hui, il reprend progressivement son activité, mais les difficultés persistent. Ses revenus sont plus instables qu’avant car les habitants, encore marqués par le chaos du cyclone, hésitent à reprendre leurs habitudes de transport ou de consommation. De plus, le coût de la vie a augmenté et l’eau est devenue une denrée rare, ajoutant une pression supplémentaire à son quotidien. « Je n’ai plus assez d’argent pour acheter de l’eau. 8 euros le pack, c’est trop cher. »
Bien que le ministère de l’Intérieur ait annoncé3 dès le 28 décembre 2024 que « 100 % de la population [avait] accès à l’eau courante », Houssein a vécu plus de trois semaines sans eau. Presque quatre mois après le passage de Chido, il bénéficie d’un approvisionnement par une rampe d’eau et une borne-fontaine installées dans son quartier, mais l’eau qu’il consomme lui cause désormais des troubles digestifs. Le cyclone n’a pas seulement anéanti ses sources de revenus, il a bouleversé son quotidien de manière profonde, affectant sa vie matérielle, sa santé et son équilibre psychologique.
« J’ai peur dès qu’il y a du vent »
Les habitants de Mayotte vivent par ailleurs dans une peur constante de nouveaux cyclones. « Chido a emporté tous les morceaux de ma maison. On ne reconnaît même plus le quartier et j’ai peur dès qu’il y a du vent », confie Houssein. Les pluies diluviennes et les effets de la tempête Dikeledi en janvier ont encore aggravé la situation. Les débris jonchent les rues, tandis que les tentatives de reconstruction, faites de matériaux récupérés, se heurtent aux vols et à l’hostilité des propriétaires fonciers. Il déplore :
Les morceaux de ma maison ont été volés par des délinquants. Il y a des déchets partout, mais pas de tôles, tout a été pris. Et les propriétaires des terrains ne veulent pas qu’on reconstruise des banga4.
Les professionnels de santé de l’île, déjà confrontés à une crise systémique de longue date, se sont retrouvés face à un afflux massif de patients en détresse psychologique. Les soignants accueillent des populations traumatisées par des mois de tensions sociales, de crises multiples, et désormais plongées dans le désarroi total après le cyclone. « Beaucoup de gens n’arrivent plus à dormir, ils sont très stressés », rapporte Virginie Briard, la cheffe du service de pédopsychiatrie du CHM. « Certains ont perdu tout intérêt pour les choses, d’autres sont en état de choc, nous disant qu’ils n’ont plus d’eau, ni de nourriture, ni de maison. Ce sont des habitants de bidonvilles comme de quartiers plus aisés », poursuit-elle.
« Beaucoup de gens miment encore les scènes de terreur »
Plusieurs études consacrées aux conséquences psychologiques de l’ouragan Katrina, survenu en Louisiane en août 2005 et l’un des plus meurtriers des États-Unis avec 1 836 morts, ont révélé l’évolution du syndrome de stress post-traumatique (SSPT) au fil du temps. Quatre mois après son passage, environ 30 % des habitants de La Nouvelle-Orléans souffraient de SSPT5. Et contrairement à d’autres événements traumatiques où les symptômes se dissipent progressivement, les troubles mentaux se sont intensifiés avec le temps. Un an après l’ouragan, le nombre de SSPT est passé de 14,9 % six mois après la catastrophe à 20,9 % douze mois plus tard. Les idées suicidaires ont également connu une hausse inquiétante, plus que doublant pour atteindre 6,4 %, contre 2,8 % juste après le passage du cyclone6. Ces résultats soulignent l’importance de prendre en compte la durée et l’évolution des symptômes dans ces situations de catastrophe.

Les centres médico-psychologiques de Mayotte sont saturés. Les professionnels de la santé mentale se retrouvent confrontés à une explosion des cas de stress post-traumatique dans un contexte où les infrastructures de santé ont été partiellement détruites. « On a des délais de rendez-vous très importants, de huit à douze mois, pour un premier rendez-vous en pédopsychiatrie », atteste la cheffe du service de pédopsychiatrie du CHM. « Beaucoup de gens miment encore les scènes de terreur qu’ils ont vécues pendant le cyclone, hantés par les bruits de la tempête et l’image des tôles qui volaient », raconte le Dr Zaazoua, un psychiatre venu de Martinique pour renforcer les équipes locales.
Les enfants, déjà fragilisés par les tensions sociales et l’insécurité ambiante, sont particulièrement affectés. « Les enfants sont très perturbés », confirme Virginie Briard. « Certains souffrant de troubles autistiques insistent pour revenir dans leurs maisons, même si tout a été détruit, dans l’espoir de retrouver un semblant de repères », témoigne la pédopsychiatre. D’autres sont désemparés face à la destruction de leur environnement. Une mère raconte que son fils, âgé de 6 ans, pleure fréquemment après avoir observé la scène de dévastation qui s’étend devant lui. « À l’école, on leur apprend que l’environnement est essentiel. Or, là, tout a été arraché. Mon fils et moi allions souvent à la plage, on admirait les baobabs et les makis. Tout cela a disparu », confie-t-elle, le cœur lourd.
« Planter un baobab dans un pot de fleurs »
Dans sa volonté pressante de rétablir une normalité apparente, le gouvernement avait insisté pour organiser « coûte que coûte » une rentrée scolaire pour les 117 000 élèves, ignorant les véritables conditions sur le terrain. Finalement, celle-ci a eu lieu le 27 janvier, après deux reports successifs. Et, bien que de nombreux enfants aient été profondément marqués par le traumatisme, leur suivi psychologique a été particulièrement négligé. « À la rentrée, on nous a demandé de faire une liste des besoins des élèves. Les élèves qui le voulaient pouvaient aussi se rapprocher des infirmiers scolaires mais ils étaient quand même réticents à parler spontanément », confiait une enseignante.
Le Dr Zaazoua insiste sur l’incapacité du système de santé à faire face à cette crise psychologique exacerbée par un manque chronique de moyens, mais aussi par un profond décalage culturel. « Vouloir imposer la psychiatrie occidentale dans un contexte qui ne la reconnaît ni comme légitime ni comme nécessaire, c’est comme essayer de planter un baobab dans un pot de fleurs », regrette-t-il.
Dans ce contexte, les habitants de Mayotte se retrouvent piégés entre deux réalités : d’une part, des traumatismes accumulés qu’ils ne peuvent traiter faute de moyens et de soutiens, et, d’autre part, un quotidien fait de luttes pour accéder à des services de base, dans un environnement où catastrophe naturelle et instabilité sociale se superposent. Selon Manuel Valls, le ministre d’État, l’adoption du projet de loi d’urgence pour Mayotte, le 24 février, marque un tournant décisif pour entamer la seconde phase de la réponse à cette crise : la reconstruction du territoire. Mais quels moyens seront mis en œuvre pour accompagner les survivants de Chido afin qu’ils puissent se reconstruire eux-mêmes avant de reconstruire leur île ?
Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables).
 Faire un don
Faire un don
Les articles présentés sur notre site sont soumis au droit d’auteur. Si vous souhaitez reproduire ou traduire un article d’Afrique XXI, merci de nous contacter préalablement pour obtenir l’autorisation de(s) auteur.e.s.
1Institut national de la statistique et des études économiques, « Enquête de victimation “Cadre de vie et sécurité” (CVS) », 2020.
2Wuambushu : en shimaoré, ce terme veut dire « repris ». Il désigne l’opération policière française déployée à Mayotte depuis le 23 avril 2024 pour expulser les personnes en situation irrégulière.
3« Mayotte : les renforts sont à l’œuvre », site du Ministère de l’Intérieur, publié le 16 décembre 2024.
4En shimaoré, ce terme fait référence à une petite case qui n’a qu’une seule pièce, construite avec soins, à Mayotte. De façon abusive, ce terme est employé pour désigner les habitations des bidonvilles de l’archipel de Mayotte
5Sandro Galea, Chris R. Brewin, Michael Gruber et al, Russell T. Jones, Daniel W. King, Lynda A. King, Richard J. McNally, Robert J. Ursano, Maria Petukhova, Ronald C. Kessler, « Exposure to Hurricane-Related Stressors and Mental Illness After Hurricane Katrina », Archives of General, Psychiatry, 2007.
6R. C. Kessler, S. Galea, M. J. Gruber, N. A. Sampson, R. J. Ursano & S. Wessely, « Trends in mental illness and suicidality after Hurricane Katrina », Molecular Psychiatry, volume 13, pages 374–384, 2008.
7Institut national de la statistique et des études économiques, « Enquête de victimation “Cadre de vie et sécurité” (CVS) », 2020.
8Wuambushu : en shimaoré, ce terme veut dire « repris ». Il désigne l’opération policière française déployée à Mayotte depuis le 23 avril 2024 pour expulser les personnes en situation irrégulière.
9« Mayotte : les renforts sont à l’œuvre », site du Ministère de l’Intérieur, publié le 16 décembre 2024.
10En shimaoré, ce terme fait référence à une petite case qui n’a qu’une seule pièce, construite avec soins, à Mayotte. De façon abusive, ce terme est employé pour désigner les habitations des bidonvilles de l’archipel de Mayotte
11Sandro Galea, Chris R. Brewin, Michael Gruber et al, Russell T. Jones, Daniel W. King, Lynda A. King, Richard J. McNally, Robert J. Ursano, Maria Petukhova, Ronald C. Kessler, « Exposure to Hurricane-Related Stressors and Mental Illness After Hurricane Katrina », Archives of General, Psychiatry, 2007.
12R. C. Kessler, S. Galea, M. J. Gruber, N. A. Sampson, R. J. Ursano & S. Wessely, « Trends in mental illness and suicidality after Hurricane Katrina », Molecular Psychiatry, volume 13, pages 374–384, 2008.