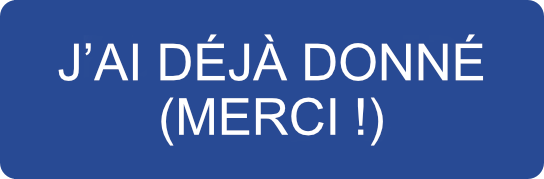Saré Moussayel, Casamance, sud du Sénégal. Lorsque Mamadou Manga (le nom a été changé) entend au loin le grincement aigu des scies électriques, il fonce sur son scooter à travers le paysage aride en direction de la frontière entre le Sénégal et la Gambie. Il termine sa route à pied, courbé, dans les hautes herbes sèches, vêtu d’une chemise beige, afin de pouvoir photographier sans être vu un dépôt clandestin de bois, juste de l’autre côté de la frontière, en Gambie. Il aperçoit plusieurs hommes en train de scier des planches sur des souches d’arbres.
À 47 ans, Manga traque depuis des années l’exploitation forestière illégale. Car les forêts autrefois denses de Médina Yoro Foula, dans la province de Casamance, dans le sud du Sénégal, se transforment en vastes champs de souches d’arbres coupés.
Il s’arrête devant des traces de charrette encore fraîches. « Les arbres ont été abattus ici hier soir. On voit encore la sève rouge sang qui coule, d’où le nom de bois de rose, explique le militant écologiste. Les trafiquants emporteront les souches plus loin ce soir. » La forêt, autrefois connue pour sa diversité et sa faune riche, ressemble aujourd’hui à une savane sèche.
L’exploitation forestière de bois de rose a débuté en Gambie en 2010 et s’est rapidement étendue à la Casamance, puis au Mali. « Les Gambiens viennent voir nos chefs de village et leur offrent jusqu’à 500 000 F CFA (environ 760 euros). Et puis, ils achètent des maires », explique Manga.
L’Amazonie du Sénégal
Jusqu’à récemment, les forêts de Casamance étaient surnommées l’Amazonie sénégalaise. Mais après avoir pillé les forêts d’Asie du Sud, les négociants en bois chinois, en partie en raison de l’absence de contrôle gouvernemental, se sont tournés vers le bois de rose d’Afrique de l’Ouest. En Gambie, au Sénégal et au Mali, où cette essence est protégée depuis 2017 par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (Cites), ils collaborent avec des hommes d’affaires et des fonctionnaires corrompus.
Des conteneurs remplis de bois de rose abattu illégalement partent pour la Chine. Là-bas, ce bois dur rouge cerise et parfumé, aussi appelé « l’ivoire de la forêt », est très prisé par la classe moyenne, en pleine expansion, qui le transforme en meubles de luxe. Les principaux moteurs de recherche chinois, comme Baidu, et les sites de commerce électronique, comme Taobao, vantent les mérites du bois de rose sénégalais et malien.

Selon l’Agence américaine d’investigation environnementale (EIA), entre 2017 et 2022, 3 millions de tonnes ont été exportées vers la Chine via les ports de Gambie et du Sénégal, pour une valeur d’au moins 1,8 milliard d’euros. Le bois de rose est devenu le produit forestier le plus commercialisé au monde, en valeur et en volume.
L’argent rapide
L’exportation de bois de rose est interdite par la loi sénégalaise1, sa constante expansion suscite des tensions entre les habitants des villages environnants. « Mes fils préfèrent l’argent facile – jusqu’à 550 euros par arbre – au dur labeur de la terre », explique Babacar Sane, un agriculteur de 50 ans. Rencontré dans son champ d’arachides, il regrette que ses enfants ne réalisent pas que leur choix « entraîne moins de précipitations et de mauvaises récoltes ».
Les bûcherons, qui ont un atelier à la périphérie de la ville de Sédhiou, abattent jusqu’à trente arbres par semaine. Ils savent qu’ils s’autodétruisent en exploitant la forêt. Mais Yaya Thiam, 45 ans, accuse l’État de les oublier et de ne pas investir « dans l’agriculture en Casamance ». Vêtu d’un tee-shirt jaune délavé, et affûtant une planche, il poursuit : « Pour abattre des arbres, il faut s’enfoncer de plus en plus dans la forêt la nuit. Mais il n’y a pas de travail ici et mes enfants doivent aussi manger. »
La lutte contre ce trafic n’est pas sans danger. « Quand j’entends un scooter, je me prépare à fuir », reprend le militant Mamadou Manga. Des commerçants et des bûcherons, armés et aidés par des drones, menacent ou blessent les militants, parfois mortellement. Manga relève son pantalon vert pour montrer les cicatrices sur ses jambes, causées par une attaque à la machette. « Ils voulaient que je reste en dehors de ça. » Il est devenu plus prudent, mais il n’a pas arrêté son combat.

Outre les cartels chinois, les rebelles indépendantistes du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) profitent du commerce dans cette région, négligée par le gouvernement central depuis des décennies. En plus de contrôler les industries lucratives du cannabis et de la noix de cajou, ils utilisent le commerce du bois pour financer leur lutte latente contre l’État sénégalais, selon l’ONG suisse Trial International.
« Trop de gens profitent de l’abattage »
Manga fait partie d’un réseau de militants écologistes créé par Haidar El Ali, ancien ministre sénégalais de l’Environnement (2012-2013) et l’un des écologistes les plus réputés d’Afrique. El Ali a brièvement réussi à stopper quasiment l’exploitation du bois de rose, avant d’être prématurément déplacé dans un autre ministère.
Le directeur des forêts de l’époque l’avait averti : quiconque agirait trop durement serait licencié. « Le plus cynique, dit Haidar El Ali, presque en éructant de colère depuis son domicile de Dakar, c’est qu’en tant que ministre on ne peut rien faire sans le soutien d’en haut, car trop de gens profitent de l’exploitation forestière : villageois, rebelles, agents des Eaux et Forêts, et même marabouts, politiciens de haut rang et militaires. »
Après son limogeage, Haidar El Ali a constitué un vaste réseau de militants écologistes au Sénégal et au Mali. Selon lui, le Mali est le nouvel épicentre du commerce illégal de bois de rose dans la région. À bord de charrettes tirées par des ânes, les contrebandiers transportent des souches d’arbres depuis l’est du Sénégal par d’étroits sentiers forestiers à travers la frontière poreuse avec le Mali, échappant ainsi facilement aux agents des Eaux et Forêts des deux côtés de la frontière.
« Sous-payés et à peine armés, ils offrent de toute façon peu de résistance à la corruption, à moins qu’ils n’aient déjà reçu l’ordre d’en haut de fermer les yeux », explique El Ali, tout en dessinant avec empressement les itinéraires empruntés par les charrettes et les camions. « Le bois sénégalais est ensuite étiqueté comme malien afin de contourner les quotas. Il est ensuite exporté vers la Chine via les ports de Gambie et du Sénégal. »
Un rapport de l’EIA a révélé qu’entre 2017 et 2022 la Chine a importé environ 1 demi-million de tonnes de rosiers du Mali, pour une valeur de 220 millions de dollars. Et entre mai 2020 et mars 2022, au moins 5 500 autres conteneurs d’arbres de bois de rose.
Au Mali, le Jnim au cœur du trafic
Dans la forêt de Baoulé, encore partiellement impénétrable, un emplacement stratégique à 160 kilomètres au nord-ouest de Bamako, la capitale malienne, un nouvel acteur satisfait la demande chinoise de meubles en bois de rose : depuis 2021, le groupe djihadiste Jamāʿat Nuṣrat al-Islām wal-Muslimīn (Jnim) s’y cache et fait pression sur les bûcherons et les contrebandiers pour qu’ils paient la zakat, un impôt religieux, afin d’accéder à la forêt et d’y être protégés.
Selon l’Institut panafricain d’études de sécurité (ISS Africa), le Jnim utilise l’exploitation forestière non réglementée pour financer et étendre son contrôle dans la région. Fondée en 2017, cette organisation fédératrice de groupes affiliés à Al-Qaida est, avec l’État islamique (EI), l’une des principales organisations terroristes opérant au Sahel.
Alors que le régime militaire malien a réussi à repousser le Jnim dans le centre et dans le nord du pays, il aide indirectement son ennemi juré à gagner du terrain en délivrant des permis d’exploitation forestière à des entreprises chinoises, malgré une interdiction régionale par la Cites depuis 2022 d’exploitation et de commerce du bois de rose d’Afrique de l’Ouest.
Des camions remplis de troncs
De retour d’un voyage clandestin dans le sud-ouest du Mali, Moussa Dembélé (le nom a été changé), militant écologiste et membre du réseau de Haidar El Ali, nous raconte, par téléphone, avoir photographié des dépôts de bois illégaux, relevé des plaques d’immatriculation et vu des camions remplis de troncs d’arbres fraîchement sciés partir pour Bamako.
Depuis des dépôts situés à la périphérie de la capitale malienne, le bois de rose repart avec de faux permis, via les ports du Sénégal et de la Gambie, vers la Chine. « Le Mali est un pays en grande partie désertique, et pourtant, on laisse les gens piller le peu de forêt qui reste », explique M. Dembélé. « Nous transmettons toutes les preuves aux autorités sénégalaises et maliennes, ainsi qu’aux organisations internationales. C’est le seul moyen de faire pression pour que les choses changent. »
Après avoir reçu des menaces, il se cache depuis quelques années dans un pays d’Afrique de l’Ouest qu’il préfère garder secret. Il y a tout juste un mois, le convoi du ministre malien de l’Environnement a été attaqué non loin de la forêt de Baoulé par des combattants du Jnim, qui renforcent leur emprise sur la région.
Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables).
 Faire un don
Faire un don
Les articles présentés sur notre site sont soumis au droit d’auteur. Si vous souhaitez reproduire ou traduire un article d’Afrique XXI, merci de nous contacter préalablement pour obtenir l’autorisation de(s) auteur.e.s.
1Au Sénégal, l’exportation de Pterocarpus erinaceus est strictement interdite en vertu de la législation en vigueur, à savoir le code forestier (loi nº 98-03 du 08 janvier 1998) et le décret nº 98-164 du 20 février 1998. Lire par ailleurs Cheikh Bamba Ndao, Trafic du bois : Comptes et mécomptes d’une catastrophe écologique en Afrique de l’Ouest, Greenpeace, 27 mai 2021.
2Au Sénégal, l’exportation de Pterocarpus erinaceus est strictement interdite en vertu de la législation en vigueur, à savoir le code forestier (loi nº 98-03 du 08 janvier 1998) et le décret nº 98-164 du 20 février 1998. Lire par ailleurs Cheikh Bamba Ndao, Trafic du bois : Comptes et mécomptes d’une catastrophe écologique en Afrique de l’Ouest, Greenpeace, 27 mai 2021.