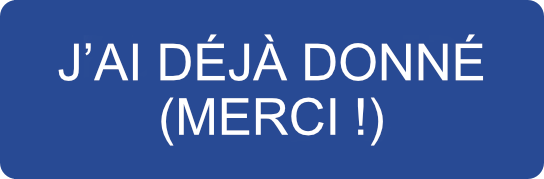C’est une gigantesque foire qui s’ouvre à Saint-Louis (Missouri) en ce 30 avril 1904. La « Louisiana Purchase Exposition », qui tient son nom de la vente, un siècle plus tôt, de la Louisiane aux États-Unis par la Première République française, a nécessité un investissement de 15 millions de dollars. Elle s’étend sur près de 5 km² et s’apprête à accueillir une soixantaine de pays, 43 des 45 États américains et presque 20 millions de personnes. Plus connue aujourd’hui sous le nom d’Exposition universelle de Saint-Louis, elle aurait pu rester dans les mémoires comme l’acte de naissance industriel de la machine à rayons X, inventée par l’Allemand Wilhelm Conrad Röntgen, ou pour la première utilisation des couveuses pour les bébés prématurés, entre autres belles inventions. Elle demeure, malheureusement, une tâche indélébile, preuve accablante du racisme et de l’impérialisme d’une époque.
À Saint-Louis, jusqu’au début du mois de décembre 1904, les nombreux visiteurs ne viennent pas seulement s’extasier sur des machines modernes, découvrir la saveur du Dr Pepper et goûter, pour la première fois, à des glaces servies dans des cônes gaufrés. Ils viennent aussi observer ceux que l’on présente alors davantage comme des animaux que comme des êtres humains : plus de 1 000 Philippins, quelques représentants du peuple tlingit d’Alaska avec 14 totems, 2 maisons et 1 canoë, l’ancien chef apache Geronimo, exhibé dans un tipi de l’exposition d’ethnologie et, à partir de la fin de juin 1904, cinq Pygmées du Congo !
L’un de ces Pygmées attire tout particulièrement l’attention. On l’appelle Ota Benga – son nom complet serait Mbye Otabenga – et il est alors âgé d’environ 21 ans. Plus encore que sa petite taille et la noirceur de sa peau, ce sont ses dents taillées en pointe qui frappent l’imagination des spectateurs. Personne ne cherche à comprendre quel rituel mbuti – le peuple de chasseurs-cueilleurs auquel il appartient – est à l’origine de cette pratique traditionnelle. Beaucoup préfèrent y déceler une preuve de l’anthropophagie à laquelle se livrent, c’est bien connu, les sauvages tribus africaines. Pour 5 cents, Ota Benga, qui est d’un abord facile, accepte de découvrir ses dents affûtées…
Un achat en bonne et due forme
La présence d’un groupe de Pygmées à la Louisiana Purchase Exposition ne doit rien au hasard. Commande a été passée, dès octobre 1903, par la Louisiana Purchase Exposition Company à l’homme d’affaires et « explorateur » Samuel Phillips Verner (1873-1943) pour qu’il ramène des Pygmées d’Afrique. Ou plutôt, pour qu’il offre « à certains indigènes l’opportunité de participer en personne à l’exposition »1. Pour organiser son expédition, Verner a obtenu 8 500 dollars, dont 500 de salaire, ainsi qu’une cagnotte supplémentaire de 1 500 dollars pour faire face aux imprévus. La commande est très précise. Il doit revenir avec : « Un patriarche pygmée ou un chef. Une femme adulte, de préférence son épouse. Deux enfants et leurs mères. Quatre Pygmées supplémentaires, mais incluant un prêtre ou une prêtresse, de préférence âgé(e). »

Cette liste de courses en poche, quelques caisses de provisions, des fusils et des munitions en cale, Verner embarque en direction de l’Afrique en novembre 1903, non sans avoir fait parvenir au roi Léopold II de Belgique, alors propriétaire en son nom de l’État indépendant du Congo, une lettre du secrétaire d’État américain John Hay… Samuel Phillips Verner n’est pas un mercenaire isolé partant chasser l’Africain pour monter sa petite entreprise de zoo humain : il obéit à la logique impériale qui infecte alors une bonne partie de l’Occident.
Le 20 mars 1904, après douze jours de marche dans la forêt équatoriale, Verner peut enfin crier victoire : il tient son premier Pygmée ! D’après ses dires, il l’a obtenu en échange de sel et de vêtements auprès de trafiquants d’esclaves bashilele – de féroces cannibales, dit-on ! À son retour, dans un article pour Harper’s Weekly, Verner écrit : « Il était très content de venir avec nous, puisqu’il était très loin de son peuple et que les Bashilele n’étaient pas des maîtres faciles. » Les versions de la capture d’Ota Benga selon Verner varieront au cours des années, même s’il se présentera toujours en sauveur blanc d’un pauvre Pygmée menacé par des mangeurs d’hommes.
« Plus tourné vers l’aventure que vers l’Évangile »
Jennifer Richard, autrice d’une somme remarquable sur la vie d’Ota Benga (Il est à toi ce beau pays, Albin Michel, 2018, et Notre royaume n’est pas de ce monde, 2022) décrit ainsi le trafiquant d’hommes :
Samuel Phillips Verner, issu d’une famille désargentée de Caroline du Sud, fantasque et schizophrène, était plus tourné vers l’aventure que vers l’Évangile. Sa direction de la mission de Luebo, dans la région du Kasaï, était avant tout motivée par les fantasmes nourris par la lecture des récits de Livingstone et Stanley. Authentiquement curieux, il apprenait les langues et allait à la rencontre des populations, marchant dans les pas des grands explorateurs, avec en tête l’ambition de faire valoir ses découvertes une fois rentré aux États-Unis. Son expérience en Afrique et d’habiles manigances lui permirent de se présenter comme un spécialiste de l’Afrique et un partenaire fiable de l’organisation de l’Exposition universelle de Saint-Louis. Il fut chargé de rapporter des spécimens de faune et de flore congolaises ainsi que des Pygmées. Ce qu’il parvint à faire, s’attirant prestige des muséums d’histoire naturelle, attention de la presse et une coquette somme d’argent.
Le matin du 11 mai 1904, Samuel Phillips Verner embarque à bord d’un steamer pour descendre la rivière Kasaï et rejoindre l’embouchure du Congo. Avec lui, Ota Benga et d’autres jeunes hommes, dont certains des noms sont connus : Malengu, Shumbu, Lanunu, Bomushubba. Pas exactement la commande, puisqu’il manque femmes, enfants et prêtres… Les captifs arrivent à la Nouvelle-Orléans le 25 juin 1904, en retard sur le programme. La Louisiana Purchase Exposition a commencé depuis avril. Malade, Verner est transporté dans un sanatorium tandis que les Pygmées sont acheminés vers la foire où ils vont faire sensation.
Une nouvelle vie commence alors pour Ota Benga. De son passé avant son arrivée en Amérique, dans la forêt de l’Ituri, on ne sait pas grand-chose. « Né sur un territoire vierge de toute domination extérieure, on peut supposer qu’il a passé les premières années de sa vie dans une sérénité semblable à celle qui régnait là depuis mille ans, imagine Jennifer Richard. Mais alors qu’il grandissait, son peuple a commencé à être menacé à la fois par les caravanes des “Arabes” et par les troupes de la force publique. La version de sa vie que j’ai choisi de raconter dans Il est à toi ce beau pays et Notre royaume n’est pas de ce monde est celle qui me semble la plus probable d’après les quelques sources historiques existantes. Selon ces dernières, sa famille aurait été massacrée par la force publique. Il aurait alors été enrôlé ou “recueilli” par les troupes, puis remis à une mission, que je devine être celle de William Henry Sheppard et de sa femme Lucy, deux Africains-Américains (dont la vie mériterait aussi un livre), celle que dirigeait, non parce qu’il était plus expérimenté mais parce qu’il était blanc, Samuel Phillips Verner. » Selon certaines sources, Ota Benga aurait perdu sa femme et ses deux enfants dans l’attaque de la Force publique avant d’être acheté par Verner.
Un retour avorté au Congo
Quand la Louisiana Purchase Exposition ferme ses portes, en décembre 1904, Samuel Phillips Verner emmène Ota Benga en tournée avec lui à travers les États-Unis, vraisemblablement à Washington DC, à Baltimore et enfin à La Nouvelle-Orléans, où la troupe embarque à destination du Congo. De retour au pays, Benga se serait remarié avec une Batwa, laquelle serait morte peu de temps après d’une morsure de serpent, ce qui provoqua le rejet du jeune homme par la communauté. « Ota Benga aurait de nouveau été victime d’un pillage et de massacres dans son village, poursuit Jennifer Richard. Cet événement étant très peu documenté et assez improbable (mais non impossible), j’opte pour un retour de Samuel Verner à la mission de Luebo, sans doute dans le but d’aller chercher d’autres spécimens zoologiques et botaniques, motivé par la perspective d’un nouveau contrat, lui qui souffrait en permanence de problèmes d’argent. J’imagine qu’Ota Benga, trouvant en lui une sorte d’“ami” (il n’avait pas d’autre référent), a choisi de repartir avec lui aux États-Unis en 1906. »
Quoiqu’il se soit passé au Congo, Ota Benga a apparemment choisi de revenir en territoire américain. « Verner se retrouve donc de nouveau à voyager avec Ota Benga à travers les États-Unis, où l’on devine qu’il organise des conférences à caractère ethnologique comme il l’avait fait quelques années auparavant avec deux hommes du peuple tetela : Kassongo et Kondola. Mais le sensationnalisme ne paie pas toujours, et Verner, sans le sou, ne sait rapidement plus quoi faire d’Ota Benga. Il s’arrange alors avec le Musée d’histoire naturelle de New York, qui accepte de le garder contre une petite somme, dans l’idée d’exploiter sa présence parmi ses trophées naturalistes, et Verner s’en va au Panama, où il a trouvé un petit boulot administratif sur le chantier du canal. »
Après l’exposition de Saint-Louis, Ota Benga se retrouve donc logé dans une petite pièce du musée, autorisé à se promener dans tout l’édifice mais interdit d’en sortir. Le sculpteur Casper Mayer réalise un buste de lui en plâtre, sur le socle duquel il appose l’inscription « Pigmy ». Mais ledit Pygmée supporte de plus en plus mal la captivité qui lui est imposée et il cherche plusieurs fois à échapper. Pour le directeur du musée, H.C. Bumpus, la situation devient vite ingérable. « Ota Benga vit mal l’isolement et la profonde solitude qui sont devenus le motif principal de sa vie, explique Jennifer Richard. Dépendant de la bonne volonté de Verner, incapable de s’adapter seul à la société dans laquelle on l’a jeté comme un objet, ne maîtrisant pas l’écriture, mal la langue, il demeure passif face aux événements. Mais on devine que son malaise et sa colère grandissent d’autant plus qu’il dispose de peu de moyens de communication (il existe une très succincte correspondance entre Verner et lui, où percent amitié autant que désespoir). Un jour, il lance une chaise à la tête de Florence Guggenheim, venue visiter le musée avec son mari, l’industriel et mécène Daniel Guggenheim. Verner est prié de venir récupérer “son Pygmée”. C’est alors qu’intervient l’épisode du zoo... »
Encagé avec l’orang-outan Dohang
Verner a en effet trouvé une solution : la cage, même s’il se garde bien de le formuler ainsi. Le 27 août 1906, Ota Benga est conduit au zoo du Bronx, où il est, dans les premiers temps, autorisé à se déplacer et à aider les gardiens qui s’occupent des animaux. Mais, quelques jours plus tard, cette relative liberté lui est enlevée : il est placé dans un enclos de la zone du parc réservée aux singes. Le 9 septembre, le New York Times s’intéresse à son sort et publie un article sous le titre : « Un Bochiman partage une cage avec les singes du zoo du Bronx ». Son succès populaire est indéniable : des groupes de 500 personnes viennent l’observer, tandis qu’il est enfermé avec un perroquet et armé d’un arc et de flèches pour faire plus vrai. On se moque, on grimace, on montre du doigt… Et l’attraction est telle que le directeur du zoo, William Temple Hornaday (1854-1937), décide de lui accorder une plus grande cage et la compagnie d’un orang-outan nommé Dohang.
À la fin du mois de septembre, 220 000 personnes sont venues visiter le zoo, le double de l’année précédente... « Presque tous se dirigeaient directement vers la zone des singes pour voir Ota Benga », écrit Pamela Newkirk dans The Guardian. Une inscription a été placée devant sa cage :
The African Pygmy, Ota Benga
Age, 23 years. Height, 4 feet 11 inches.
Weight 103 pound. Brought from the Kasai River,
Congo Free State, South Central Africa,
By Dr Samuel P Verner.
Exhibited each afternoon during September2
Pour le directeur du zoo, les bénéfices d’une telle exposition sont sonnants et trébuchants. Intellectuellement, la situation est loin de le déranger. Zoologiste de renom, proche de Theodore Roosevelt (président des États-Unis de 1901 à 1909), Hornaday a le soutien de deux membres influents de la Société de zoologie, le paléontologue eugéniste Henry Fairfield Osborn (il baptisera le tyrannosaure et le vélociraptor) et l’avocat racialiste Madison Grant (futur auteur d’un ouvrage sur la supériorité de la « race nordique »). Pour eux, comme pour Verner, exposer un Pygmée dans un zoo est éminemment pédagogique… Au New York Times, Verner soutient que le public est « le seul bénéficiaire » et qu’Ota Benga est « totalement libre ». « La seule interdiction qui lui est faite est de s’éloigner de ses gardiens. C’est pour sa propre sécurité », ajoute-t-il. Quant à la notice apposée devant sa cage, c’est pour lui éviter d’avoir à répondre tout le temps aux mêmes questions… « On vient de loin pour voir le “chaînon manquant”, l’élément que l’on n’avait pas encore pu observer pour comprendre l’évolution entre le singe et l’homme... », note ironiquement Jennifer Richard.
Poursuivi par des hordes de visiteurs
Malgré tout, quelques personnes se récrient. Notamment des religieux africains-américains. Dès le 10 septembre 1906, un jour après la parution de l’article du New York Times, le révérend James H. Gordon se rend au zoo du Bronx pour constater de ses yeux l’enfermement d’Ota Benga et essayer de communiquer avec lui. Placé face à la triste réalité, il fulmine : « Nous sommes suffisamment francs pour dire que nous n’aimons pas que l’un des nôtres soit exposé avec les singes. Nous pensons que notre race est assez dépréciée pour ne pas être, en plus, présentée avec des primates. Nous pensons pouvoir être considérés comme des êtres humains dotés d’une âme ! »
Dans l’incapacité de convaincre Hornaday, qui espère bien exposer Ota Benga encore longtemps, James H. Gordon se tourne vers un avocat noir, Wilford H. Smith, et un riche mécène, John Henry H. Millholland, pour porter la question en justice. Le seul résultat qu’ils obtiennent, c’est qu’Ota Benga ne soit plus maintenu dans sa cage et puisse aller et venir un peu partout dans le musée. Ce qu’il fait, chaque fois poursuivi ou accompagné par des hordes de visiteurs. Un record est atteint le 16 septembre : 40 000 personnes viennent visiter le zoo.
Mais bientôt Ota Benga n’en peut plus et devient de nouveau « ingérable », selon les mots d’Hornaday. « Le garçon fait ce qu’il lui plaît, et il est tout à fait impossible de le contrôler. Il a été tellement exposé dans les journaux, et si souvent sous l’œil du public, qu’il est peu recommandable de le punir, affirme le directeur du zoo. Si nous le faisions, nous serions aussitôt accusés de cruauté, de coercition, etc., etc. » Si la presse nationale multiplie les articles, la plupart sont sur la même ligne : Ota Benga est, au mieux, un sous-représentant de l’espèce humaine… Mais la tendance s’inverse peu à peu. Des religieux africains-américains s’offusquent, tel le révérend Matthew Gilbert, de la Mount Olivet Baptist Church, dont Pamela Newkirk rapporte ces mots : « Seuls les préjugés contre la race nègre peuvent rendre une telle chose possible dans ce pays. J’ai eu l’occasion de voyager à l’étranger et je suis persuadée qu’une telle chose n’aurait pas été tolérée un seul jour dans un autre pays civilisé. » Un pasteur blanc, Robert Stuart MacArthur, s’indigne aussi avec ces mots : « Nous envoyons nos missionnaires en Afrique pour christianiser les gens, et nous ramenons un Africain ici pour le brutaliser. »
Libre, « seul, pensif, triste »
Sans doute l’apparition de critiques de plus en plus virulentes couplée aux réactions de plus en plus violentes d’Ota Benga – il mord, donne des coups de pied, se bat, s’arme d’un couteau – finissent pas convaincre Hornaday de s’en débarrasser. Et, le 28 septembre, c’est accompagné par Samuel Phillips Verner que le jeune Mbuti quitte le zoo pour rejoindre le Howard Coloured Orphan Asylum de Weeksville, dont James H. Gordon est alors superintendant. Il va y rester près de quatre années et y recevoir une forme d’éducation occidentale.
En 1910, Ota Benga est envoyé à Lynchburg, en Virginie, où il est accueilli dans la famille de Gregory W. Hayes et peut participer aux cours du Virginia Theological Seminary and College – où il se lie d’amitié avec une enseignante, la poétesse Anne Spencer. Désormais connu sous le nom d’Otto Bingo, le Mbuti préfère pourtant passer son temps à l’extérieur, dans les forêts, où il chasse ou cherche du miel avec un groupe de jeunes garçons. Des petits boulots, comme le travail dans une usine de tabac, lui permettent de survivre jusqu’en 1916. Mais il n’a plus de nouvelles de Samuel Verner et, avec la guerre qui éclate en Europe, ses espoirs de rentrer au pays s’amenuisent chaque jour. Les enfants avec qui il partait en forêt le voient de plus en plus souvent assis sous un arbre, seul, pensif, triste. Dans la soirée du 19 mars 1916, il allume un feu dans un champ et danse autour, comme en transe. Plus tard dans la nuit, il se tire une balle de pistolet en plein cœur. Ses funérailles auront lieu deux jours plus tard, le 22 mars, en l’église baptiste Diamond Hill de Lynchburg.
« Sans en avoir pleinement conscience, Ota Benga a été le témoin de la colonisation militaire et culturelle de l’Afrique, du développement industriel occidental – étalé aux yeux du monde par les Expositions universelles –, de la ségrégation aux États-Unis, et du déclenchement de la Première Guerre mondiale, explique Jennifer Richard. Pour cela, vous ne m’entendrez jamais dire qu’Ota Benga est le symbole du racisme. Il est bien plus que cela. Il est l’incarnation de l’opprimé. Victime de racisme évidemment – trouvez-moi un peuple sur terre qui, à l’époque, considérait les Pygmées comme des égaux ! –, il a eu le malheur de naître sur une terre convoitée par des peuples armés et conquérants. Aux États-Unis, il a été considéré comme une marchandise par une société où tout s’achète et où la vie ne vaut que pour ce qu’elle rapporte. Il est la victime de la cupidité et de la mégalomanie humaine, dont le racisme est un outil. »
Bien des années plus tard, la Wildlife Conservation Society a présenté des excuses publiques pour avoir maintenu un homme enfermé dans une cage de zoo. C’était le 29 juillet 20203.
Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables) :
Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables).
 Faire un don
Faire un don
Les articles présentés sur notre site sont soumis au droit d’auteur. Si vous souhaitez reproduire ou traduire un article d’Afrique XXI, merci de nous contacter préalablement pour obtenir l’autorisation de(s) auteur.e.s.
1Pamela Newkirk, « The man who was caged in a zoo », The Guardian, 2015.
2Traduction : Le Pygmée africain Ota Benga, âge, 23 ans, taille, 1,49 mètre, poids, 46 kg. Amené de la rivière Kasaï, État indépendant du Congo, Afrique centrale, par le Dr Samuel P. Verner, exposé tous les après-midi de septembre.
3A Statement from the Wildlife Conservation Society, WCSN Newsroom.
4Pamela Newkirk, « The man who was caged in a zoo », The Guardian, 2015.
5Traduction : Le Pygmée africain Ota Benga, âge, 23 ans, taille, 1,49 mètre, poids, 46 kg. Amené de la rivière Kasaï, État indépendant du Congo, Afrique centrale, par le Dr Samuel P. Verner, exposé tous les après-midi de septembre.
6A Statement from the Wildlife Conservation Society, WCSN Newsroom.