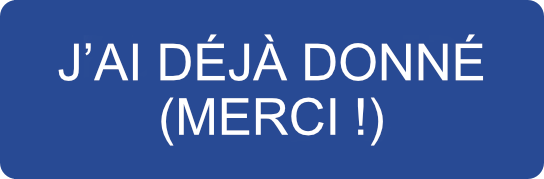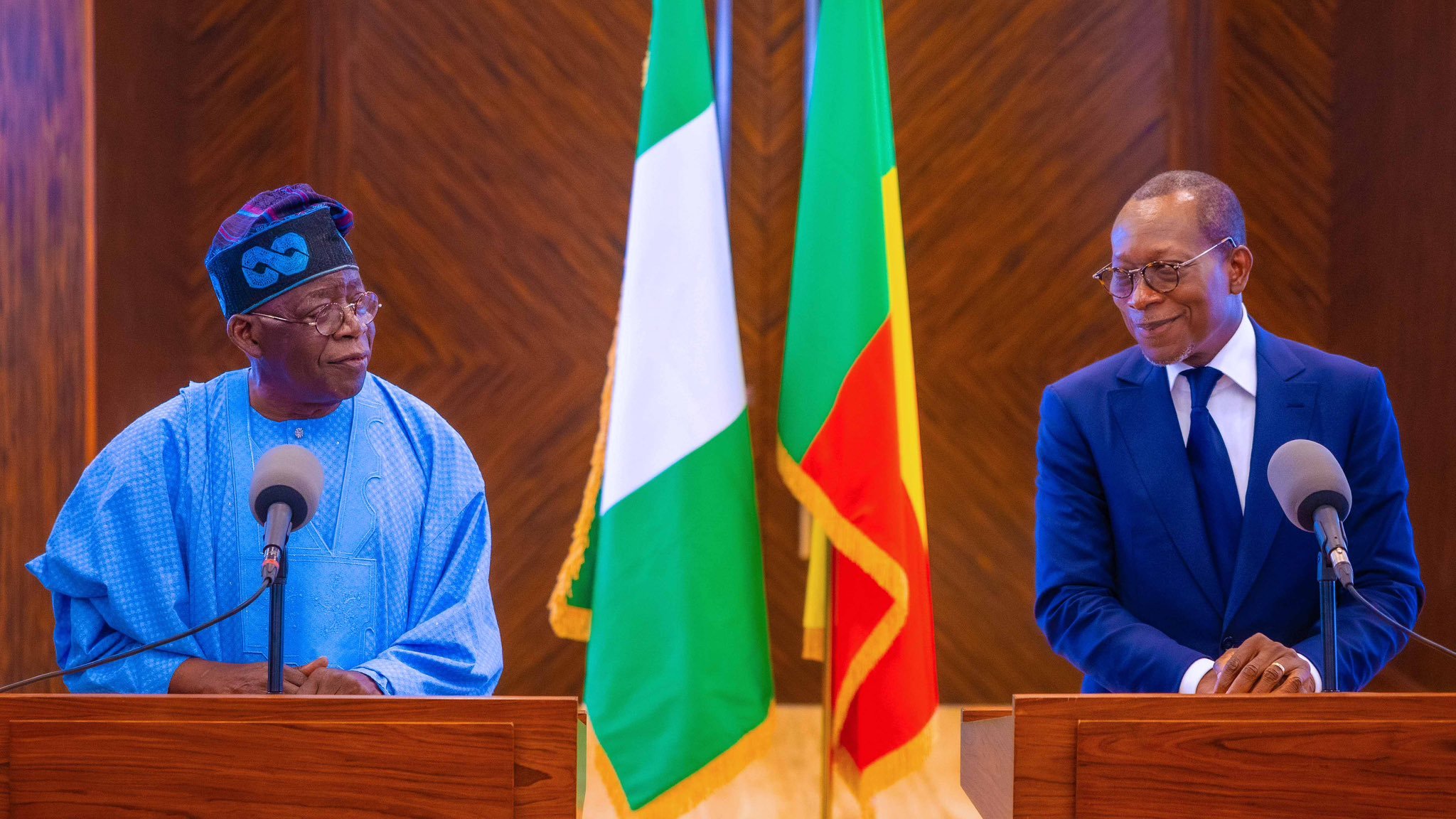
Au Sahel, l’imposition de « sanctions » s’est considérablement accrue ces derniers mois. N’importe quel observateur avisé est désormais familier avec le vocabulaire technique et si spécifique de ceux qui les imposent : gel des avoirs, travel ban, embargo… Au Niger, dernier exemple en date, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) a brandi puis exécuté la menace de sanctions massives, à peine quelques jours après le début du coup d’État mené par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP).
Derrière cette arme économique et politique se cache une réalité multiforme et complexe. Il faut en effet distinguer les mesures individuelles et ciblées des sanctions plus générales touchant un pays tout entier et l’ensemble de son économie. Il faut aussi distinguer les mesures imposées par l’ONU, telles que prévues par la Charte des Nations unies, de celles imposées de manière unilatérale par des États ou par des groupes d’États. Enfin, les motivations et les justifications qui sous-tendent l’application des sanctions dans la région sont variées, allant de la lutte contre le terrorisme à la promotion des droits de l’homme, en passant par la condamnation des coups d’État.
Un vieil outil de politique étrangère
Pour mieux comprendre pourquoi et comment les sanctions sont devenues un nouveau réflexe de politique étrangère, revenons brièvement sur leur histoire. Des travaux riches existent sur le sujet1, et situent l’invention contemporaine des sanctions au carrefour des XIXe et XXe siècles. Nicholas Mulder explique que l’intensification des échanges économiques internationaux à cette époque a fait émerger l’opportunité d’utiliser une nouvelle « arme » consistant à restreindre les relations économiques d’un État pour le contraindre à changer de comportement. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les sanctions furent alors pensées comme un formidable outil de dissuasion pour empêcher la survenue de nouveaux conflits. Dans cette logique, la menace d’un embargo total, « pire que la guerre », devait convaincre tout dirigeant de renoncer à l’usage de la force2.
Bien qu’elles aient été inefficaces face à l’Allemagne nazie ou à l’Italie de Mussolini à l’occasion de l’invasion de l’Éthiopie, ce type de sanctions fut conservé dans le système onusien conçu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec un rôle central donné au Conseil de sécurité.
Si les logiques de blocs prévalant durant la Guerre froide ont limité leur utilisation (à l’exception des mesures visant les régimes racistes de l’Afrique du Sud et de la Rhodésie du Sud), la chute de l’URSS a ouvert la voie à un recours massif aux sanctions par le Conseil de sécurité dans les années 1990, parfois appelées « la décennie des sanctions »3. En Irak, en Haïti ou en Angola, des embargos ont été mis en œuvre durant plusieurs années afin de faire plier les dirigeants en place, provoquant des conséquences humanitaires désastreuses pour les populations, confrontées à l’absence de médicaments ou de produits de première nécessité4. C’est pourquoi le Conseil de sécurité a rapidement abandonné l’imposition de sanctions générales contre des États et des populations dans leur ensemble, au profit de mesures individualisées et ciblées.
Des sanctions ciblées, vraiment ?
Depuis une dizaine d’années, nous observons une multiplication des mesures de sanctions à travers le monde. Bien qu’elles soient présentées comme ciblées, celles-ci tendent à provoquer des effets négatifs sur l’ensemble des populations des pays concernés, et perdent ainsi leur caractère « individualisé ». Trois tendances majeures revêtent une pertinence particulière dans le contexte sahélien. La première concerne le développement des régimes de sanctions visant des organisations désignées comme « terroristes ». Au Sahel, tous les groupes armés affiliés à Al-Qaïda ou à l’État islamique ont été progressivement sanctionnés par l’ONU, ainsi que plusieurs de leurs dirigeants (Iyad Ag Ghali ou Amadou Koufa, par exemple). Ces régimes de sanctions punissent tout soutien à ces groupes et à leurs alliés. En visant des entités sans existence juridique, qui contrôlent parfois des territoires sur lesquels elles exercent leurs modes de gouvernance, ces sanctions peuvent provoquer des effets plus larges sur les populations qui y vivent, empêcher l’acheminement de l’aide humanitaire5 ou entraver les perspectives de paix et de médiation6.
La deuxième tendance est la multiplication des sanctions unilatérales, adoptées en dehors du système onusien. Par exemple, les États-Unis disposent aujourd’hui de plus d’une centaine de régimes de sanctions en vigueur, et l’Union européenne (UE) une cinquantaine – des chiffres en forte augmentation sur la dernière décennie. Ces sanctions s’articulent parfois avec les sanctions onusiennes, mais visent bien souvent à les compléter, lorsqu’un consensus n’a pas été trouvé au sein du Conseil de sécurité. Au Sahel, plusieurs dirigeants politiques maliens sont par exemple sanctionnés par l’UE, alors que les États-Unis ont récemment sanctionné des dirigeants militaires de premier plan, dont le ministre de la Défense. Enfin, de nombreux États ont également adopté des sanctions contre le groupe Wagner et ses principaux dirigeants, dont certaines sont désormais spécifiques aux activités de la société en Afrique.

Une troisième tendance, mise en exergue par les événements en cours au Niger, renvoie aux pratiques de la Cedeao, qui n’hésite pas à utiliser des mesures de sanctions générales, allant jusqu’à l’embargo complet, contre ses propres membres. Certes, ces mesures ne sont pas totalement nouvelles et des sanctions financières ou diplomatiques avaient déjà été imposées dans des situations précédentes. Toutefois, ces deux dernières années, les sanctions se sont rapidement imposées comme l’un des principaux moyens pour faire pression sur les militaires au pouvoir en réaction aux coups d’État successifs au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Au-delà des sanctions institutionnelles (suspension de la participation à l’organisation) et individuelles (travel ban et gel des avoirs pour les dirigeants), la Cedeao a imposé un embargo sur le Mali entre janvier et juillet 2022, à travers la fermeture des frontières, la suspension des transactions commerciales et le gel des avoirs de l’État et des banques nationales auprès de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Malgré les critiques sur la légalité et la légitimité de ces mesures7, la Cedeao a adopté une posture encore plus ferme quant à la situation au Niger.
Quelles sont les sanctions imposées au Niger ?
Au-delà d’une menace d’intervention militaire, qui a monopolisé l’attention médiatique, la Cedeao a adopté une posture très ferme en imposant des sanctions dès le 30 juillet 2023, soit quatre jours après le début de la tentative de coup d’État. La conférence des chefs d’État a imposé plusieurs mesures désormais habituelles en réaction à des putschs : suspension de l’organisation, gel des avoirs et interdiction de voyager visant les dirigeants, etc. Elle a également pris des mesures plus radicales, dépassant celles imposées au Mali en 2022. En effet, la fermeture des frontières et la suspension des relations commerciales s’appliquent à l’ensemble des transactions, sans aucune exemption, y compris pour les produits de première nécessité, ou bien la fourniture énergétique – ce alors que la majorité des importations d’électricité provient du Nigeria voisin.
La réaction de la Cedeao au Niger se distingue également par sa précocité. En effet, si l’embargo imposé au Mali s’inscrivait dans la continuité de longues négociations entre l’organisation régionale et la junte malienne, les sanctions au Niger ont été imposées comme préalable à toute médiation. Utilisées ailleurs pour réduire la durée des transitions à l’issue des coups d’État, elles visent ici à empêcher, voire à inverser la prise de pouvoir par les militaires.
Au Niger, les mesures de la Cedeao ont été en outre indirectement appuyées par d’autres États. Par exemple, l’UE a rapidement annoncé la possible adoption d’un nouveau régime de sanctions visant les responsables de la junte. Pour rappel, l’UE avait également appuyé les sanctions de la Cedeao au Mali en adoptant des mesures restrictives à l’encontre de responsables politiques de premier plan, dont le Premier ministre malien. Plusieurs États européens ont également annoncé la suspension de l’aide publique au développement et du soutien budgétaire. Bien que ces mesures ne soient pas présentées comme des « sanctions », elles s’y apparentent.
Les sanctions sont-elles efficaces ?
La question de l’efficacité des sanctions divise les chercheurs depuis de nombreuses années, et pose de nombreux défis méthodologiques. Dès les années 1960, à la suite des premières sanctions imposées par l’ONU à la Rhodésie du Sud, le sociologue norvégien Johan Galtung avait démontré les effets néfastes et la très relative efficacité de cette pratique. Il observait que des sanctions très dures entraînaient la mise en œuvre de « coping mechanism » et de stratégies de contournement par le pays touché (développement du marché noir, diversification des sources d’approvisionnement…), qui faisaient progressivement décroître l’intérêt de se conformer aux objectifs imposés par les pays émetteurs de sanctions8.
Plus récemment, une équipe de chercheurs a évalué l’ensemble des sanctions onusiennes, en lien avec leurs objectifs affichés. Leurs travaux démontrent que les sanctions les plus efficaces sont celles qui sont graduées, et liées à des objectifs clairs et réalisables. Au contraire, les sanctions les plus légères (un travel ban visant un dirigeant) ou les plus fortes (embargo complet) tendent à être bien moins efficaces et à ne pas déboucher sur l’objectif initial9.
Au Sahel, bien que nous manquions encore de recul pour évaluer l’efficacité des sanctions imposées après des coups d’État, plusieurs éléments amènent à la même conclusion. Certes, ces mesures ont débouché sur des accords entre les pouvoirs militaires et la Cedeao au Mali, en Guinée et au Burkina. Toutefois, aucun retour au pouvoir d’un civil n’a été observé à ce jour dans ces trois pays. Plusieurs transitions ont même été prolongées. Et, surtout, cela ne semble pas avoir dissuadé les militaires nigériens de s’emparer à leur tour du pouvoir par la force. De plus, les sanctions de la Cedeao contre le Mali semblent au contraire avoir provoqué un « effet du drapeau », au moins temporairement. En effet, les manifestations du 14 janvier 2022, organisées en réaction à l’imposition des sanctions, ont été parmi les plus importantes qu’ait connues le pays durant la période de transition. Elles ont par ailleurs alimenté le discours patriotique et souverainiste des autorités, un schéma qui semble se répéter au Niger. En effet, la similarité des discours est frappante, et la dénonciation par le CNSP des « sanctions illégales, inhumaines et humiliantes » de la Cedeao n’est pas sans rappeler les réactions maliennes.
Quels seront les impacts humanitaires ?
Dans les années 1990, de nombreuses études ont documenté et démontré les impacts humanitaires terribles provoqués par les mesures de sanctions générales, comme un embargo, en Irak ou en Haïti. Si la situation du Niger est différente, plusieurs niveaux d’impacts doivent être envisagés. Le premier d’entre eux concerne le contexte humanitaire du pays, puisque les sanctions viennent frapper une population qui affronte déjà des défis considérables. Dans une récente note d’analyse sur le sujet, le Programme alimentaire mondial (PAM) rappelle que 3,3 millions de personnes (13 % de la population) étaient en insécurité alimentaire sévère (phases 3 & 4) durant la dernière période de soudure (juin-août 2023).
Le deuxième élément a trait à la rapidité de la mise en œuvre des sanctions, qui empêche toute action préventive des institutions publiques ou des acteurs humanitaires. Dans le cadre de travaux de recherche portant sur les sanctions de la Cedeao au Mali, j’ai pu observer que la plupart des ONG humanitaires s’y étaient préparées, ce qui leur a permis de continuer à mener leurs activités durant la fermeture des frontières : augmentation des stocks, réserves de cash, etc.
Troisième élément défavorable, l’absence d’exemption humanitaire dans les sanctions de la Cedeao contre le Niger pourrait provoquer des tensions plus fortes sur les produits de première nécessité, et notamment la nourriture. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a par exemple déjà alerté sur les risques pesant sur les stocks de céréales et sur la probabilité d’une explosion de la demande d’aide alimentaire. De même, la réduction de la fourniture d’électricité (un stade jamais atteint au Mali) pourrait avoir des effets délétères sur la continuité de certains services essentiels (en matière de santé notamment), et plus globalement sur l’activité économique. Pour atténuer ces impacts, plusieurs organisations humanitaires et agences de l’ONU ont demandé l’introduction d’exemptions humanitaires visant à ne pas appliquer les sanctions sur les produits essentiels ou sur l’acheminement de l’aide humanitaire. Leur plaidoyer s’appuie en partie sur le récent changement de position du Conseil de sécurité, qui a décidé fin 2022 d’introduire une exemption humanitaire générale sur les régimes de sanctions onusiens10.
Enfin, un quatrième élément déterminant sera la durée d’application de ces sanctions. En cas d’échec des négociations entre le CNSP et la Cedeao, ou en substitution à une intervention militaire, les sanctions pourraient être appliquées durant plusieurs mois et provoquer des effets à moyen terme bien plus néfastes. Par exemple, les sanctions financières et la suspension des transactions commerciales pourraient empêcher ou retarder les transferts de fonds issus de la diaspora. De même, la suspension de l’aide étrangère, qu’il s’agisse du soutien budgétaire ou de l’aide au développement, va largement entamer les capacités financières de l’État11, réduire le peu de services publics existants, voire provoquer l’arrêt de certains programmes en matière d’éducation, de santé, ou de sécurité alimentaire. Enfin, la prolongation des sanctions affectera largement la capacité des organisations humanitaires à importer des biens, à utiliser des fonds, ainsi qu’à assurer la rotation de leurs personnels. À titre d’exemple, le PAM a déjà annoncé que les difficultés d’approvisionnement en pétrole risquent de compromettre sa capacité à opérer des vols humanitaires.
Est-ce que ces sanctions sont légales ?
Les sanctions font l’objet de critiques importantes, en particulier de la part des États non occidentaux, pour leur non-conformité au droit international. La question de leur légalité étant complexe, elle demande une réponse nuancée. En effet, la possibilité pour des États d’adopter des mesures coercitives non militaires est prévue dans certains cas. Tout d’abord, un État peut adopter des mesures de rétorsion dès lors qu’il est victime d’une violation du droit international par un autre État. Ensuite, les sanctions adoptées par le Conseil de sécurité de l’ONU sont généralement considérées comme étant licites, car prévues par la Charte de l’ONU. Enfin, des organisations régionales peuvent sanctionner leurs membres, à condition que cela respecte les textes fondateurs de ladite organisation. Par exemple, dans le cas de la Cedeao, la possibilité d’adopter des sanctions en cas de renversement anticonstitutionnel est clairement prévue12.
Toutefois, les possibilités de sanctions sont limitées (gel des avoirs des dirigeants, suspension de l’organisation…), et la rupture de toutes les relations commerciales, y compris pour les biens de première nécessité, n’est pas inscrite dans les textes. Certes, la possibilité d’imposer un embargo sur les armes est prévue par un acte additionnel de 2012, mais il ne peut être général et s’étendre à tous les biens et produits essentiels13. Surtout, cet acte prévoit clairement que les sanctions adoptées contre un État membre ne doivent pas affecter l’acheminement de l’aide humanitaire 14. Par conséquent, une partie des sanctions adoptées contre le Niger semble donc contraire au droit de la Cedeao.
De même, en droit international, l’imposition d’un embargo total sans exemption humanitaire pour les biens essentiels semble difficilement compatible avec les obligations pesant sur les États. L’Assemblée générale de l’ONU ainsi que le Conseil des droits de l’homme ont condamné à plusieurs reprises ce type de mesures, et ont demandé aux États de s’abstenir de les adopter ou de les appliquer15. Dans un document spécifique consacré à l’articulation entre les sanctions économiques et les droits de l’homme, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU a par ailleurs souligné que « les habitants d’un pays ne sont pas privés de leurs droits économiques, sociaux et culturels fondamentaux parce qu’il a été déterminé que leurs dirigeants ont violé des normes relatives à la paix et à la sécurité internationales »16.
Il semble que le recours de plus en plus récurrent aux sanctions, que ce soit par les organisations régionales ou bien de manière purement unilatérale, traduit des tendances plus profondes dans les relations internationales, auxquelles le Sahel n’échappe pas. Ces mesures, qui peuvent être radicales, semblent s’imposer comme une voie médiane entre les négociations diplomatiques et le recours à la force, un outil intermédiaire dans une zone grise entre guerre et paix. Les sanctions tendent alors à devenir une nouvelle « arme automatique » pour des États coincés entre des postures interventionnistes et une exigence de neutralité. Elles doivent cependant rester ciblées, justifiées juridiquement et proportionnées, sans quoi elles pourraient se transformer en une « arme de la faim », avec des conséquences terribles pour les populations des États sanctionnés.
Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables).
 Faire un don
Faire un don
Les articles présentés sur notre site sont soumis au droit d’auteur. Si vous souhaitez reproduire ou traduire un article d’Afrique XXI, merci de nous contacter préalablement pour obtenir l’autorisation de(s) auteur.e.s.
1Nicholas Mulder, The Economic Weapon, New Haven, Yale University Press, 2022.
2Nicholas Mulder, The Economic Weapon, op. cit., pp. 1-2. L’auteur cite notamment le président des États-Unis Woodrow Wilson, qui considère les sanctions comme étant « something more tremendous than war […] that brings a nation to its senses just as suffocation removes from the individual all inclinations to fight. Apply this economic, peaceful, silent, deadly remedy and there will be no need for force. It is a terrible remedy. It does not cost a life outside of the nation boycotted, but it brings a pressure upon that nation which, in my judgment, no modern nation could resist », c’est à dire : « quelque chose de plus formidable que la guerre [...] qui ramène une nation à la raison, tout comme l’asphyxie enlève à l’individu toute velléité de se battre. Appliquez ce remède économique, pacifique, silencieux, mortel, et la force ne sera plus nécessaire. C’est un remède terrible. Il ne coûte aucune vie en dehors de la nation boycottée, mais il exerce sur cette nation une pression à laquelle, à mon avis, aucune nation moderne ne pourrait résister ».
3David Cortright et George A. Lopez, The Sanctions Decade : Assessing UN Strategies in the 1990s, Boulder, Lynne Rienner Publishers, 2000.
4Commission des droits de l’homme, « Conséquences néfastes des sanctions économiques pour la jouissance des droits de l’homme », 21 juin 2000, Document des Nations unies (E/CN.4/Sub.2/2000/33), §§ 59-73 ; World Health Organization, « The Health conditions of the population of Iraq since the Gulf crisis », document des Nations unies (WHO/EHA/96.1), 1996, 17 pages.
5MSF, « Adding salt to the wound », octobre 2021 ; Emma O’Leary, Principles under pressure, Norwegian Refugee Council, 2018.
6Ferdaous Bouhlel, (Ne pas) dialoguer avec les groupes « jihadistes » au Mali ? Étude de Cas, Fondation Berghof, 2020.
7Lionel Zevounou, « Mali, les sanctions de la CEDEAO sont illégales », Codesria, 2022.
8Johan Galtung, « On the Effects of International Economic Sanctions : With Examples from the Case of Rhodesia », World Politics, Vol. 19, No. 3, 1967, pp. 378-416.
9Thomas J. Biersteker, Sue E. Eckert, Marcos Tourinho et Zuzana Hudáková, « UN Targeted Sanctions Datasets (1991–2013) », Journal of Peace Research, Vol. 55, pp. 404–412.
10Julien Antouly, « La résolution 2664 du Conseil de sécurité : une étape historique vers une meilleure protection des activités humanitaires », La Revue des droits de l’homme, décembre 2022.
11Selon les sources, la part du soutien étranger dans le budget de l’État du Niger oscille entre 40 et 50 %.
12Traité révisé de la CEDEAO, Article 77 ; Protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance, Article 45.
13Il faut souligner que le communiqué final du Sommet extraordinaire de la Cedeao ne cite pas explicitement les textes et instruments sur lesquels se basent les sanctions. De plus, certains de ces instruments, dont le Protocole additionnel de 2012, sont très difficiles à trouver, et il est impossible d’obtenir des informations valides sur leur date d’entrée en vigueur, ou le niveau de ratification. Ce manque d’informations est problématique, et ne peut qu’entamer la légitimité des décisions adoptées.
14Supplementary Act A/SP.13/02/12 on Sanctions Against Member States that Fail to Honour their Obligations to ECOWAS, Article 4§4.
15A/RES/51/103, 12 décembre 1996, Droits de l’homme et mesures coercitives unilatérales, §1.
16Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale No 8 : Relation entre les sanctions économiques et le respect des droits économiques, sociaux et culturels, 12 décembre 1997, Document des Nations unies (E/C.12/1997/8)
17Nicholas Mulder, The Economic Weapon, New Haven, Yale University Press, 2022.
18Nicholas Mulder, The Economic Weapon, op. cit., pp. 1-2. L’auteur cite notamment le président des États-Unis Woodrow Wilson, qui considère les sanctions comme étant « something more tremendous than war […] that brings a nation to its senses just as suffocation removes from the individual all inclinations to fight. Apply this economic, peaceful, silent, deadly remedy and there will be no need for force. It is a terrible remedy. It does not cost a life outside of the nation boycotted, but it brings a pressure upon that nation which, in my judgment, no modern nation could resist », c’est à dire : « quelque chose de plus formidable que la guerre [...] qui ramène une nation à la raison, tout comme l’asphyxie enlève à l’individu toute velléité de se battre. Appliquez ce remède économique, pacifique, silencieux, mortel, et la force ne sera plus nécessaire. C’est un remède terrible. Il ne coûte aucune vie en dehors de la nation boycottée, mais il exerce sur cette nation une pression à laquelle, à mon avis, aucune nation moderne ne pourrait résister ».
19David Cortright et George A. Lopez, The Sanctions Decade : Assessing UN Strategies in the 1990s, Boulder, Lynne Rienner Publishers, 2000.
20Commission des droits de l’homme, « Conséquences néfastes des sanctions économiques pour la jouissance des droits de l’homme », 21 juin 2000, Document des Nations unies (E/CN.4/Sub.2/2000/33), §§ 59-73 ; World Health Organization, « The Health conditions of the population of Iraq since the Gulf crisis », document des Nations unies (WHO/EHA/96.1), 1996, 17 pages.
21MSF, « Adding salt to the wound », octobre 2021 ; Emma O’Leary, Principles under pressure, Norwegian Refugee Council, 2018.
22Ferdaous Bouhlel, (Ne pas) dialoguer avec les groupes « jihadistes » au Mali ? Étude de Cas, Fondation Berghof, 2020.
23Lionel Zevounou, « Mali, les sanctions de la CEDEAO sont illégales », Codesria, 2022.
24Johan Galtung, « On the Effects of International Economic Sanctions : With Examples from the Case of Rhodesia », World Politics, Vol. 19, No. 3, 1967, pp. 378-416.
25Thomas J. Biersteker, Sue E. Eckert, Marcos Tourinho et Zuzana Hudáková, « UN Targeted Sanctions Datasets (1991–2013) », Journal of Peace Research, Vol. 55, pp. 404–412.
26Julien Antouly, « La résolution 2664 du Conseil de sécurité : une étape historique vers une meilleure protection des activités humanitaires », La Revue des droits de l’homme, décembre 2022.
27Selon les sources, la part du soutien étranger dans le budget de l’État du Niger oscille entre 40 et 50 %.
28Traité révisé de la CEDEAO, Article 77 ; Protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance, Article 45.
29Il faut souligner que le communiqué final du Sommet extraordinaire de la Cedeao ne cite pas explicitement les textes et instruments sur lesquels se basent les sanctions. De plus, certains de ces instruments, dont le Protocole additionnel de 2012, sont très difficiles à trouver, et il est impossible d’obtenir des informations valides sur leur date d’entrée en vigueur, ou le niveau de ratification. Ce manque d’informations est problématique, et ne peut qu’entamer la légitimité des décisions adoptées.
30Supplementary Act A/SP.13/02/12 on Sanctions Against Member States that Fail to Honour their Obligations to ECOWAS, Article 4§4.
31A/RES/51/103, 12 décembre 1996, Droits de l’homme et mesures coercitives unilatérales, §1.
32Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale No 8 : Relation entre les sanctions économiques et le respect des droits économiques, sociaux et culturels, 12 décembre 1997, Document des Nations unies (E/C.12/1997/8)