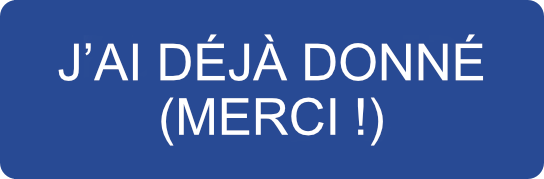Octobre 2024. À Bol, chef-lieu de la région du lac Tchad, l’air est chargé d’électricité. Des nuages noirs à l’horizon annoncent les dernières pluies de la saison. Ya Gana, une femme de 40 ans originaire de l’État de Borno, dans le nord-est du Nigeria, prépare méticuleusement le chaï, ajoutant des feuilles de menthe et versant le liquide doré d’un verre à l’autre. En 2022, elle est devenue l’une des quelque 21 000 réfugiées nigérianes accueillies au Tchad.
« Ils sont arrivés pendant la nuit. Les combattants de Boko Haram1 ont traîné mon mari au centre du village, où les hommes avaient été rassemblés », raconte-t-elle tout en poursuivant, imperturbable, la danse du thé. « Ils les ont tous tués. » Profitant de la confusion, Ya Gana a réussi à fuir avec trois de ses sept enfants. Les autres sont toujours entre les mains du groupe armé. « Nous avons passé quatre mois dans la brousse avant d’atteindre le Tchad. Je n’ai plus eu de nouvelles de mes enfants depuis. » Ya Gana a été accueillie par une association locale qui soutient, notamment, les victimes de Boko Haram.

Depuis 2009, les régions autour du lac Tchad sont devenues un champ de bataille crucial pour ce groupe armé né dans le nord du Nigeria au début des années 2000. Le lac, en perpétuelle mutation, avec son dédale d’îles et de canaux, a offert un refuge idéal pour établir des bases, échapper aux contrôles et coordonner des attaques. L’insurrection a atteint son apogée entre 2015 et 2016 et elle est devenue un problème régional impliquant non seulement le Nigeria, mais aussi le Tchad, le Cameroun et le Niger.
« Le Tchad a emprunté une autre voie »
« À l’époque, même si le phénomène avait déjà commencé au début des années 2010, de nombreux jeunes ont migré du Tchad, du Niger et du Cameroun vers le nord-est du Nigeria », explique Oubadjim Dehba Désiré, analyste tchadien, en désignant les madrasas de Borno comme les principaux lieux de prosélytisme et de radicalisation. Mais au-delà de l’idéologie, des facteurs structurels – sociaux, politiques et économiques – ont également contribué à la croissance et à l’implantation de Boko Haram. Les zones autour du lac Tchad présentent en effet des taux de pauvreté similaires et un manque généralisé de services de base, tandis que tout le long de ses rives, la majorité de la population partage le sentiment d’un abandon total de la part de l’État. « Ceux qui sont revenus, endoctrinés et affiliés au groupe, ont ensuite étendu la portée du message, exploitant la frustration sociale et promettant à quiconque rejoindrait le groupe une vie différente », poursuit l’analyste.
En 2016, la scission de Boko Haram en deux factions – Jama’atu Ahl as-Sunna lil-Da’wa wal-Jihad (JASDJ) et Islamic State West Africa Province (ISWAP) – a encore compliqué la situation sur le terrain, entraînant une recrudescence des violences et des attaques contre les civils. Les conséquences de ce phénomène se lisent dans les chiffres : plus de 6 millions de personnes ont été directement affectées par l’insurrection djihadiste. Mais bien que l’insécurité touche toute la région du lac, le Tchad, parmi les quatre pays frontaliers, est celui qui a le moins souffert de la brutalité de Boko Haram, que ce soit en termes d’attaques ou de conséquences sociales.

« Je pense que ces chiffres sont le résultat d’une combinaison de facteurs spécifiques, explique Oubadjim Dehba Désiré. La première phase de la réponse tchadienne à Boko Haram a été essentiellement militaire. Mais, autour de 2018, le Tchad a emprunté une autre voie. » La stratégie du gouvernement de N’Djamena incluait le renforcement de la coalition internationale créée pour lutter contre le groupe, un programme d’amnistie nationale pour les anciens combattants ayant déposé les armes, ainsi qu’une approche plus ouverte aux solutions communautaires. Dans ce contexte, la société civile a joué un rôle significatif.
« Nous cherchions de l’argent et à étudier l’islam »
« Les communautés avaient déjà commencé un travail important pour aborder les enjeux sociaux et panser les blessures, poursuit l’expert. Elles ont adopté une posture d’écoute ciblée, identifiant les zones d’intervention prioritaires. » L’un des domaines d’action les plus urgents, étroitement lié au contexte local, concernait l’accueil et la réinsertion des anciens combattants, en réponse au grand nombre de repentis ayant quitté le groupe. Le centre de réinsertion de Bol est situé juste à l’extérieur de la ville. Derrière un long mur gris, une grande cour centrale sépare plusieurs maisons en dur destinées à accueillir les pensionnaires.
« Ils sont tous tchadiens, la plupart sont encore mineurs », explique Abakar Adoum Mbami, chef communautaire et responsable du centre. « Plus de 200 personnes, en grande majorité des jeunes ayant volontairement choisi de quitter l’organisation, sont passées par ce centre », précise-t-il, avant d’ajouter que les pensionnaires y séjournent cinq mois – le temps nécessaire pour mener à bien un parcours d’accueil et d’accompagnement.

Les autorités régionales contribuent au financement des programmes de réintégration des jeunes proposés par le centre, tandis qu’Abakar prend en charge les frais liés aux repas et les salaires des gardiens, avec l’aide de la communauté et, parfois, de bailleurs de fonds extérieurs.
Au cours de leur parcours, les anciens combattants reçoivent une formation professionnelle en agriculture, pêche ou élevage. « Nous venons de différents lieux, mais la majorité est originaire de la commune de Baga Sola », expliquent deux des membres les plus âgés du groupe. Assis sur une natte, leurs visages portent les marques de scarifications typiques des communautés vivant autour du lac Tchad. « Nous cherchions de l’argent et l’opportunité d’étudier l’islam. Mais nous avons vite compris que les choses étaient très différentes à l’intérieur de l’organisation », racontent-ils.
« Nous aimerions trouver un travail »
Les journées au centre s’écoulent lentement, entre séances de formation, prières et parties de cartes. Le plus jeune n’a que 13 ans – il a été enlevé par l’organisation à l’âge de 9 ans – et le plus âgé 19 ans. « Une fois sortis du centre, nous aimerions trouver un travail et, peut-être, retrouver nos familles », explique ce dernier.
Le processus psychologique de réintégration est l’une des étapes les plus complexes. « Ils ont intériorisé des comportements violents », explique Abakar.

« Dans le cadre de leur parcours, nous les invitons à participer à des exercices psychologiques, au cours desquels ils peuvent choisir de brûler les vêtements donnés par Boko Haram. » Ce qui pourrait sembler un simple geste symbolique est en réalité crucial pour reconstruire l’identité des anciens combattants : une manière de se libérer des fantômes du passé et de ce qui les relie au groupe.
« Au début, jusqu’aux attentats de N’Djamena, en 20152, les autorités ont sous-estimé la menace de Boko Haram, explique Abakar. La réponse du gouvernement a été principalement militaire. Mais les armes seules ne peuvent pas résoudre un phénomène aux racines aussi profondes et complexes. »
Au cours des cinq dernières années, l’approche des autorités a progressivement changé. En plus des opérations militaires, le gouvernement – sous pression à cause du grand nombre de repentis – a commencé à reconnaître une certaine autonomie à la société civile dans la réponse au phénomène. Depuis 2020, il a autorisé des ONG locales et internationales à opérer dans la région, collaborant dans certains cas à des projets sociaux.
« Il faut dépasser la phase d’urgence »
Cependant, le système mis en place par les autorités présente des lacunes importantes. « Jusqu’à aujourd’hui, les centres accueillent hommes et garçons ensemble, sans aucune séparation, explique Hoinathy Remadji, chercheur à l’Institut d’études de sécurité (ISS). De plus, le système manque de moyens pour répondre aux besoins des femmes qui fuient le groupe. La plupart d’entre elles sont soutenues par la société civile. »
Le manque de financements pour la réintégration complique encore la situation. Selon Remadji, « il faut dépasser la phase d’urgence et établir un véritable cadre de réintégration. Les projets destinés aux anciens combattants doivent répondre aux besoins spécifiques des adultes et des enfants, avec des programmes axés sur le soutien psychologique, une réinsertion professionnelle complète pour les adultes et un accompagnement éducatif pour les plus jeunes ».
Bien que la réponse des autorités ait été insuffisante, la région du lac Tchad a vu émerger des initiatives privées et communautaires. De nombreuses associations locales et des groupes informels se sont constitués à Bol, travaillant, dans un premier temps, à rechercher des solutions de logement pour les femmes victimes de Boko Haram. Ensuite, ces mouvements se sont concentrés sur la nécessité de fournir des informations fiables sur le groupe afin de lutter contre la désinformation et les fausses promesses qui avaient attiré des centaines de jeunes. Parallèlement, ils ont aidé les femmes ayant fui le groupe à retrouver un emploi.

Dans ce contexte, les radios communautaires ont joué un rôle clé dans la diffusion de l’information concernant l’amnistie gouvernementale et dans la contre-narration, surtout durant les périodes les plus critiques de la crise. Kabaye FM, en activité depuis quatorze ans, est une véritable référence à Bol. Son modeste siège – une petite maison gris-bleu située non loin des eaux du lac Tchad – est facilement reconnaissable grâce à son antenne de trente mètres de haut. La station couvre une zone de plusieurs centaines de milliers d’habitants, jusqu’au Cameroun.
« Raconter aux autres ce qu’ils ont vécu »
« La radio a été fondée grâce à des dons privés et au soutien d’organisations locales et internationales, explique Michael Ngomajita, directeur des programmes. Durant les années les plus critiques de l’urgence, nous avons élargi notre rayon d’écoute autant que possible. Nous savions que, pour beaucoup, dans la région du lac, la radio était le seul lien avec le pays, et les informations, un cordon ombilical vital avec le monde extérieur. »
Entre 2016 et 2017, pendant les années les plus sombres, Kabaye FM a complètement revu sa programmation. L’équipe de la radio a introduit des émissions spécifiques abordant la menace de Boko Haram sous divers angles, ajoutant des talk-shows et des débats animés par des experts. « Un programme dont nous sommes particulièrement fiers a été construit autour des témoignages en direct des “repentis” », explique Ngomajita. Ces voix se sont révélées être de puissants outils de sensibilisation montrant la réalité crue de la vie au sein de l’organisation. « Ce qui est le plus surprenant, c’est que les jeunes qui ont donné leurs témoignages étaient fiers de parler et de raconter aux autres ce qu’ils avaient vécu. »
Kabaye FM fait partie d’un réseau de radios locales qui ont coordonné leurs efforts pour pallier les manques structurels et institutionnels. L’un des objectifs les plus importants atteints par ce réseau a été l’éducation. Pendant les périodes de fermeture des écoles liées aux attaques de Boko Haram, des programmes éducatifs radiophoniques ont été proposés à plus de 200 000 enfants dans la région.
À côté de la radio, le théâtre a aussi trouvé sa place comme vecteur de changement social. La rue principale de Bol est un chemin de terre battue et de sable. Après la station de police et le marché central, on arrive à un centre de santé. Dans sa cour, quelques jeunes se préparent pour un spectacle, enfilant leurs costumes et se maquillant. Adamou Garba, 29 ans et cofondateur en 2012 de la troupe de théâtre, est parmi eux. « Nous faisons principalement du théâtre participatif et jouons dans la rue », explique l’acteur.
« Voir ces spectacles a éveillé quelque chose en moi »
La troupe d’Adamou, née grâce aux fonds d’un projet international, a grandi au fil du temps, portée par la volonté d’aborder les problématiques locales. « Nous avons vu de plus en plus fréquemment surgir des conflits dans notre société et nous avons décidé de nous engager personnellement », ajoute-t-il. Les représentations, souvent teintées d’humour, attirent un public mixte d’enfants, d’adolescents et d’adultes, qui participent activement, riant, plaisantant et parfois se fâchant. « Nous pensons qu’en impliquant le public, il est plus facile de faire passer le message. »

La troupe explore des thèmes comme les conflits intercommunautaires, la famille, l’abus d’alcool et de drogues, et, bien sûr, la sensibilisation à la menace de Boko Haram. « J’ai commencé comme spectateur. Voir ces spectacles a éveillé quelque chose en moi, ça m’a aidé à un moment très sombre de ma vie. C’est pour cela que je me suis rapproché du théâtre », conclut Adamou, aujourd’hui président de la troupe.
En remontant l’artère principale de Bol en direction de l’aéroport, on arrive à la mosquée centrale de la ville. Non loin de là se trouve l’Association des femmes pour la paix et la cohésion sociale, fondée en 2017. « La société est une éponge. Elle absorbe la violence et la restitue sous différentes formes », explique Daraya Yacoub Koundougou, la présidente.

« Lorsque le conflit se propage, il affecte inévitablement les relations familiales, sociales et de coexistence commune. » Depuis sa création, l’association s’occupe des crises dans différents contextes : communautaire, familial et économique. « Notre rôle est d’agir comme un pont entre les parties, en travaillant à trouver des solutions pacifiques aux conflits concernant divers sujets, comme le mariage, la propriété foncière, l’héritage », développe Daraya.
« J’espère revoir mes enfants »
L’association intervient dans les zones rurales de la province de Bol, invitant les femmes à participer activement aux discussions et se concentrant sur la recherche de solutions concrètes aux conflits qui naissent dans les familles et les communautés avant qu’ils ne s’étendent. Mais elle ne se limite pas à la sensibilisation. Depuis sa création, elle a accueilli de nombreuses femmes victimes de Boko Haram, pour lesquelles elle recherche un emploi.
Dans la cour intérieure de sa maison, Ya Gana Mohamed, membre de l’association, explique, devant un chaï qui refroidit dans les tasses : « J’ai rejoint l’association peu après mon arrivée à Bol. » Elle poursuit : « Ici, j’ai trouvé un point de référence. Les autres membres m’ont aidée à surmonter ce que j’ai vécu. » Ya Gana dit se sentir prête à affronter la douleur vécue deux ans plus tôt, mais sa pensée revient constamment à sa terre natale. « J’espère retourner dans mon village et revoir mes enfants, mais je ne crois pas que cela arrivera un jour », raconte-t-elle en se préparant pour la prière de midi.
Selon un rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), parmi les plus de 250 000 personnes déplacées internes et réfugiées au Tchad, 55 % sont des femmes. Arrachées à leurs villages, souvent de force, elles ont peu de perspectives d’avenir. « Nous ne pouvons pas faire grand-chose à part leur offrir un refuge. Au mieux, nous pouvons les aider à trouver un emploi comme domestiques », explique Daraya, ajoutant : « Les ressources sont limitées alors que les besoins sont énormes. »
Les efforts spontanés pour promouvoir la paix et contrer le prosélytisme extrémiste parmi les populations du lac Tchad ont été efficaces jusqu’ici. Cependant, le soutien financier et institutionnel reste insuffisant. « Ce qu’il faut, c’est une vision pour l’avenir », résume Hoinathy Remadji.
Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables) :
Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables).
 Faire un don
Faire un don
Les articles présentés sur notre site sont soumis au droit d’auteur. Si vous souhaitez reproduire ou traduire un article d’Afrique XXI, merci de nous contacter préalablement pour obtenir l’autorisation de(s) auteur.e.s.
1Nous prenons le parti ici de respecter les usages langagiers des témoins, même si l’utilisation du mot « Boko Haram » ne reflète plus la réalité de ce groupe qui a subi de nombreuses transformations.
2Une série d’attaques en juin 2015 contre la direction de la Sécurité publique, le commissariat central et l’école de police ont fait 38 morts et une centaine de blessés.
3Nous prenons le parti ici de respecter les usages langagiers des témoins, même si l’utilisation du mot « Boko Haram » ne reflète plus la réalité de ce groupe qui a subi de nombreuses transformations.
4Une série d’attaques en juin 2015 contre la direction de la Sécurité publique, le commissariat central et l’école de police ont fait 38 morts et une centaine de blessés.