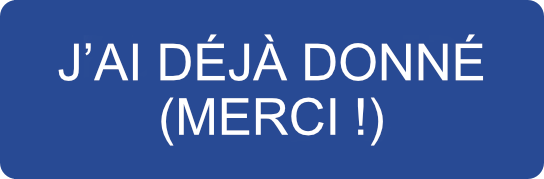« Comment chasser un dictateur depuis Amsterdam ? » s’interroge un twitteur après la diffusion, le 12 novembre 2022, au Royal Theatre Carré, dans la capitale des Pays-Bas, d’un documentaire sur la candidature à la présidence du leader de l’opposition ougandaise, Robert Kyagulanyi – une star de l’afrobeat plus connue sous son nom de scène, Bobi Wine. Les 2 000 personnes présentes ont été choquées par les exactions de l’autocrate ougandais, le général Yoweri K. Museveni.
Le film dépeint l’oppression et la torture dont sont victimes les opposants politiques dans un pays où le président est au pouvoir depuis 1986. Intitulé The People’s President, il est décrit par un site d’information néerlandais comme une « histoire captivante de résilience, de sacrifice et de courage face à une grande injustice ». Il poursuit : « Les gens ont pleuré, se sont mis en colère et ont été choqués par ce qui se passe en Ouganda. »
La projection au Carré a suscité des dizaines de tweets aux Pays-Bas et ailleurs. À travers ces messages, leurs auteurs ont exprimé leur indignation face à la situation ougandaise et leur solidarité avec l’opposition, incarnée par Bobi Wine, qui assistait à la projection. Fils d’un vétérinaire qui a eu trente enfants, ce dernier a grandi dans le quartier défavorisé de Kamwokya, dans le centre de Kampala, la capitale ougandaise. Il est devenu célèbre en se présentant comme « le président du ghetto » et en chantant des chansons en luganda sur la politique et le sort des habitants de ces quartiers pauvres.
Certains tweets en provenance d’Ouganda ont salué avec espoir les sentiments émanant des Pays-Bas. « Grâce à ce film, le monde est informé de l’entreprise criminelle en cours dans notre pays, l’Ouganda », a écrit l’un d’eux. Mais après avoir posé la question de savoir comment un dictateur pourrait être destitué par des gens assis dans une salle de cinéma à Amsterdam, les esprits se sont quelque peu refroidis. En effet, comment faire tomber un dictateur depuis Amsterdam ?
La menace des « drones »
En Ouganda, la répression exercée par le régime du Mouvement de résistance nationale de Museveni ne cesse de s’intensifier. Le pays abrite l’une des populations les plus jeunes du monde, avec 77 % des citoyens âgés de moins de 25 ans. Ils sont de plus en plus urbanisés, mécontents et rancuniers, et s’irritent d’un État sécurocrate qui fournit peu de services de base tels que les soins de santé et l’éducation. Les dissidents vivent sous la menace d’un enlèvement par des agents de l’État qui circulent dans des véhicules banalisés appelés « drones ».
Une fois en captivité, ils risquent la torture, une détention potentiellement indéfinie, et même la mort. Selon Wine, plus de 1 000 de ses partisans auraient été enlevés, détenus, et certains torturés. Wine lui-même a été arrêté et torturé à plusieurs reprises, tandis que son chauffeur a été assassiné en 2021 et que, le 5 novembre 2020, son garde du corps, Jamshid Kavuma, a disparu, et n’a toujours pas refait surface.
Pour un nombre croissant de jeunes adeptes des médias sociaux, se taire n’est plus une option. L’accès à Facebook, Twitter, TikTok et à d’autres plateformes permet de voir à quoi ressemble la vie dans les autres régions du monde. Parallèlement, les informations instantanément disponibles sur les personnalités puissantes – âge, affaires de corruption et incompétence… – ont remis en cause la retenue dont ils faisaient preuve autrefois.
Cette situation se traduit notamment par des foules de milliers de personnes qui suivent les propos de l’universitaire et poétesse rebelle Stella Nyanzi, lorsqu’elle compare Museveni à une paire de fesses « qui ne font que se trémousser, péter et chier », ou qui lisent les écrits du romancier Kakwenza Rukirabashaija, avec leurs titres évocateurs tels que Banana Republic (« République bananière ») et The Greedy Barbarian (« Le barbare avide »).
Répression et torture
Ces deux auteurs ont cependant payé le prix fort pour leur franc-parler. Nyanzi a été emprisonné à plusieurs reprises et a dû faire face à un long procès pour le crime d’« insulte à la personne du président ». Rukirabashaija a publié un tweet malheureux dans lequel il se moquait du fils (et héritier présumé) de Museveni, le général Muhoozi Kainerugaba, le décrivant comme « obèse », « avec des hanches et des seins énormes », et demandant comment « un soldat […] peut avoir un corps aussi sédentaire », avant de déclarer que « Dieu punit les corrompus d’une bonne manière avec […] une silhouette stupide ». Ce tweet a conduit à sa détention et à des tortures. Selon lui, il été battu pendant des jours, et la chair de ses jambes a été arrachée avec des pinces. Les deux écrivains sont depuis exilés en Allemagne.
La torture est officiellement illégale en Ouganda. Mais si Rukirabashaija a bénéficié d’un procès rapide pour ses insultes, ses poursuites pour tortures n’ont toujours pas été entendues par la Haute Cour ougandaise. Ce n’est pas une surprise : le président Museveni nomme tous les juges, favorisant généralement ceux qui s’alignent sur sa rhétorique nationaliste qui vante l’indépendance de l’Ouganda et accuse l’influence corrosive de « l’Occident », qui soutiendrait l’opposition.
En conséquence, même face à des preuves irréfutables impliquant des membres de toutes les branches des forces de sécurité dans des actes illégaux, seules des peines légères ont été sporadiquement appliquées. Commentant ces affaires, Museveni a déclaré que la torture n’était pas largement utilisée en Ouganda et qu’elle était l’apanage de quelques vieux fonctionnaires à la « mentalité coloniale ». Cependant, plutôt que de soutenir les enquêtes sur ces pratiques, le président a récemment demandé que le système judiciaire soit encore plus aligné sur les « valeurs » du gouvernement.
Un espionnage massif
Ces dernières années, la politique de répression a également été appuyée par de nouveaux outils, notamment dans le domaine de la surveillance des réseaux sociaux. En décembre 2021, des diplomates de l’ambassade américaine de Kampala ont découvert que leurs téléphones avaient été infiltrés à l’aide du célèbre logiciel de piratage Pegasus, qui avait été vendu à l’État ougandais par le fabricant d’armes israélien NSO. Le programme peut infecter les iPhones à l’insu de l’utilisateur, espionnant tout, des appels vocaux aux messages de discussion chiffrés, en passant par les données de localisation.
Huit mois plus tard, en août 2022, le quotidien israélien Haaretz a rapporté qu’une autre société israélienne, Cellebrite, avait vendu aux forces de police ougandaises une technologie leur permettant de pirater les téléphones portables. Dans une déclaration, Cellebrite n’a pas nié la vente mais a affirmé être « scrupuleuse » quant à l’utilisation légale et éthique de ses produits.
Les autorités ougandaises justifient la surveillance numérique par un arsenal juridique toujours plus large utilisé contre ceux qui ont le malheur d’attirer l’attention avec leurs critiques. Alors qu’un tweet de Kakwenza Rukirabashaija a suffi pour qu’il soit inculpé pour « trouble à l’ordre public », en octobre 2022, un parent du journaliste ougandais et militant pro-démocratie Remmy Bahati, installé aux États-Unis, a été accusé de « se faire passer pour un soldat » ougandais après être apparu sur une photo de groupe au côté de Bahati, vêtu d’une chemise olive et noire. Cette accusation a servi de prétexte à l’enlèvement et à la détention de cinq proches de Bahati pendant plusieurs jours. Ils n’ont été libérés qu’après que Bahati eut tiré parti de son importante présence sur les médias sociaux pour coordonner une campagne de communication contre les ravisseurs.
Les internautes criminalisés
Un instrument juridique relativement nouveau utilisé pour museler l’opposition est la « loi sur l’utilisation abusive des ordinateurs », récemment modifiée1, en vertu de laquelle Stella Nyanzi a été inculpée de délits d’injures. Le TikToker Teddy Nalubowa a été emprisonné en vertu de la même loi après s’être enregistré en train de se réjouir de la nouvelle de la mort, le 25 août 2022, de l’ancien ministre de la Sécurité Elly Tumwine.
De nouveaux amendements à la loi ciblent plus explicitement les médias sociaux. Les personnes reconnues coupables de diffusion d’« informations non sollicitées, fausses, malveillantes, haineuses et injustifiées » encourent jusqu’à dix ans de prison. Il est également interdit d’accéder « sans autorisation » aux « données ou informations, aux enregistrements vocaux ou vidéo d’une autre personne » et de partager « toute information concernant une autre personne », ce qui criminalise de fait les recherches sur Internet concernant les individus.

Même les lois sur le blanchiment d’argent ont été utilisées contre des activistes. Le 22 décembre 2020, alors que le pays se préparait aux élections du 14 janvier 2021, l’avocat et défenseur des droits de l’homme ougandais Nicholas Opiyo s’est retrouvé menottes aux poignets après que son association caritative, Chapter Four, eut reçu de l’argent de sources extérieures. Alors qu’ils déjeunaient dans un restaurant, lui, ses trois collègues avocats et un membre de l’opposition ont été emmenés par des agents en civil, menottés et conduits dans une camionnette banalisée aux vitres teintées. Ils ont passé huit jours en détention avant d’être accusés de blanchiment d’argent et d’« actes malveillants connexes ». Ils ont été libérés sous caution. Les charges ont été discrètement abandonnées plus d’un an après.
La société civile attaquée
Les 340 000 dollars (environ 316 000 euros) qui faisaient l’objet d’accusations de blanchiment d’argent avaient été mis à disposition par des donateurs pour les efforts de Chapter Four visant à « promouvoir un gouvernement ouvert, défendre les droits de l’homme, renforcer la société civile et faciliter la libre circulation des informations et des idées ». Ce don avait vraisemblablement attiré l’attention des autorités, car le Bureau national des organisations non gouvernementales avait suspendu le Chapter Four, ainsi que cinquante-quatre autres organisations de la société civile (OSC), afin de limiter précisément ce type d’activités.
Les permis des OSC avaient été suspendus en août 2020 sur la base d’une série d’accusations administratives, notamment le fait d’opérer avec des permis expirés et de ne pas avoir déposé de déclarations annuelles et de livres audités. Cette mesure semble être une réaction aux dossiers déposés par les agences du renseignement, qui les accusaient d’abriter des « agents de l’agenda néocolonial » et de chercher à apporter un soutien financier à l’opposition avant les élections.
Le même mois, deux de ces « agents » se sont retrouvés dans l’impossibilité de continuer à travailler en Ouganda. Tout d’abord, le conseiller de l’Union européenne pour les élections, Simon Osborn, a été expulsé. Osborn était auparavant salarié d’une ONG américaine entretenant des liens étroits avec le gouvernement américain et était chargé de débourser des budgets pour l’éducation civique et les activités liées aux élections. Puis, deux semaines plus tard, le Néerlandais Marco de Swart, qui était chargé des campagnes électorales au sein d’un fonds multidonateur pour la société civile en Ouganda, a été empêché de rentrer dans le pays. Le fonds lui-même, appelé « Democratic Governance Facility », qui avait aidé d’innombrables organisations de la société civile, a été supprimé peu de temps après.
La contre-insurrection pour briser les manifestations
Sans se laisser décourager, l’opposition a néanmoins réussi à organiser des manifestations exigeant la fin du règne de Museveni. Celles-ci ont culminé avec des marches dans le centre de Kampala en novembre 2020. Prises à revers, les forces de sécurité ougandaises ont répondu par une violence sans précédent. Des unités de soldats aguerris, ramenés d’un déploiement à Mogadiscio, en Somalie, ont déclenché des tactiques normalement adaptées au contrôle d’une insurrection. Dans les rues étroites de la ville, les militaires ont tué une centaine de citoyens.
Lors de la même manifestation, on pouvait voir des véhicules de police portant la mention : « Avec le soutien financier du Royaume des Pays-Bas ». L’image, si choquante qu’elle a fait la une du journal néerlandais De Volkskrant à l’époque, illustre l’impasse dans laquelle se trouvent les « partenaires de développement » occidentaux de l’Ouganda. S’ils restent déterminés à soutenir les mouvements de la société civile favorables à la démocratie, les Occidentaux entretiennent également une relation pragmatique avec l’État ougandais, qui est considéré comme un pilier de stabilité dans une région par ailleurs instable.
Ils se voient donc contraints d’accorder une aide qui, bien qu’elle soit destinée à la santé, à l’éducation et à d’autres services publics, libère également des fonds que le gouvernement peut ensuite dépenser en tanks, véhicules et armes. Sans surprise, malgré sa fréquente rhétorique nationaliste et anti-occidentale, le gouvernement de Museveni semble avoir peu de scrupules à accepter une telle aide.
« Cessez de payer nos oppresseurs »
Godber Tumushabe, directeur associé de l’Institut d’études stratégiques des Grands Lacs (Great Lakes Institute for Strategic Studies), estime qu’il est essentiel que les donateurs soutiennent la démocratie plutôt que la répression, et que « l’aide à la santé et à l’éducation » ne peut être le seul critère. « Le secteur de la santé est déjà en difficulté, et l’éducation n’est pas de première qualité, rappelle-t-il. On ne peut améliorer la situation que si le gouvernement est fonctionnel. »
Il suggère aux donateurs de mettre les fonds « directement entre les mains du secteur privé et des citoyens plutôt que de les dépenser pour un gouvernement corrompu ». Comme autre alternative, il propose d’imposer des sanctions aux « individus qui violent les droits de l’homme et dépensent leur butin issu de la corruption en parcourant le monde et en donnant une bonne éducation à leurs enfants à l’étranger ».
Les activistes de la société civile et les leaders de l’opposition en Ouganda se sentent impuissants face à ce qu’ils décrivent comme le « soutien » du régime par l’Occident, et demandent aux partenaires du développement de « cesser de payer nos oppresseurs ». Cependant, ils craignent également que les rares services auxquels le public ougandais a accès soient les premiers à disparaître si les bailleurs de fonds se retirent. C’est la raison pour laquelle une position auparavant absolutiste exigeant la suspension totale du financement a récemment été révisée pour expliquer que l’aide au gouvernement ougandais devrait être arrêtée « dans tous les secteurs humanitaires, sauf les plus fondamentaux ».
Pendant ce temps, les militants pro-démocratie qui souffrent de l’étranglement financier de l’État continuent de demander un financement pour leurs activités. « Car, même lorsque vous faites votre travail communautaire bénévolement, vous avez toujours besoin d’argent pour le transport et les données », déclare l’un d’entre eux.
Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables).
 Faire un don
Faire un don
Les articles présentés sur notre site sont soumis au droit d’auteur. Si vous souhaitez reproduire ou traduire un article d’Afrique XXI, merci de nous contacter préalablement pour obtenir l’autorisation de(s) auteur.e.s.
1Le 10 janvier 2023, la Cour constitutionnelle ougandaise a annulé la section 25 de la loi sur l’utilisation abusive des ordinateurs. C’est une victoire pour les militants des droits de l’homme Andrew Karamagi et Robert Shaka, qui avaient déposé une pétition à cet effet.
2Le 10 janvier 2023, la Cour constitutionnelle ougandaise a annulé la section 25 de la loi sur l’utilisation abusive des ordinateurs. C’est une victoire pour les militants des droits de l’homme Andrew Karamagi et Robert Shaka, qui avaient déposé une pétition à cet effet.