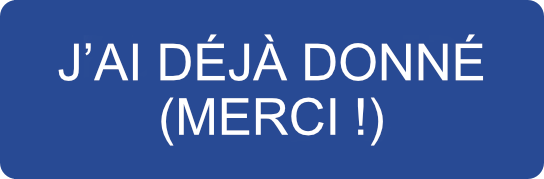Aux Comores, un double vote se tiendra dimanche 14 janvier en Grande Comore, à Anjouan et à Mohéli (Mayotte étant sous administration française), dans un scrutin direct majoritaire à deux tours. Les électeurs sont appelés à choisir le gouverneur de leur île respective, et le président du pays. Mais c’est cette dernière élection qui attire tous les regards. Six candidats se disputent le fauteuil présidentiel, dont le président sortant, Azali Assoumani, qui brigue un troisième mandat depuis son retour au pouvoir, en 2016 (et qui est le président de l’Union africaine depuis février 2023).
Un seul de ses cinq adversaires fait figure d’outsider et semble en mesure de rivaliser avec lui. Il s’agit de Salim Issa Abdillah. Inconnu du grand public il y a deux mois, ce quinquagénaire choisi par les grands électeurs du Juwa, le principal parti de l’opposition extra-parlementaire (l’opposition qui a boycotté les élections législatives en 2020), dispose, grâce au mouvement de l’ancien président Ahmed Abdallah Sambi (2006-2011), d’une grande capacité de mobilisation et d’une importante base électorale. Sambi, qui est le président d’honneur du Juwa, reste très populaire aux Comores, notamment depuis qu’à l’issue d’un procès controversé en novembre 2022, qualifié de « politique » par ses partisans - relatif à l’affaire de la « citoyenneté économique », un programme de vente de passeports comoriens à des apatrides du Golfe initié sous sa présidence -, il purge une peine de prison à vie.
Les quatre autres candidats – tous des hommes – sont des figures politiques connues de l’archipel. Parmi eux : Daoudou Abdallah Mohamed, ministre de l’Intérieur de 2016 à 2021, a joué un rôle central dans l’appareil sécuritaire avant son remerciement, en 2021. Il incarne pour beaucoup de Comoriens la répression qui s’est abattue sur toute forme de contestation entre 2018 et 2019. Les autres prétendants sont Bourhane Hamidou, ancien président de l’Assemblée Nationale et ancien ministre de l’Intérieur, Mouigni Baraka Saïd Soilihi, ancien gouverneur de la Grande-Comore, et Aboudou Soefo, ministre des Affaires étrangères durant la première présidence d’Azali Assoumani (2002-2006).
« Un coup KO »
Après des débuts poussifs, la campagne a pris un peu de couleurs quinze jours après son ouverture officielle, le 17 décembre. Elle se résume en deux slogans contraires : « Azali nalawe » (« Azali dégage ») d’un côté ; « Azali nabaki » (Azali reste) de l’autre. Ces deux mots d’ordre illustrent la polarisation politique dans cette ancienne colonie française de 870 000 habitants qui a longtemps composé avec une instabilité politique faite de coups d’État, de présidents assassinés ou déportés et de crises séparatistes.
Ainsi, il semble déjà loin le temps où la Convention pour le renouveau des Comores (CRC), le parti d’Azali, et ses alliés occupaient seuls le terrain et les réseaux sociaux au lancement de la campagne. Le 23 décembre, Azali tient son premier meeting en Grande Comore, à Mitsoudje, la ville d’où il est originaire, située à une vingtaine de kilomètres de Moroni, la capitale. À la tête d’une centaine de partisans majoritairement de bleu vêtus, la démarche vive et assurée, un sourire en coin, c’est à pied que cet ancien militaire de 65 ans se rend dans le stade de foot qui abrite la grand-messe. Là, l’attendent ses partisans, qui patientent sous une chaleur accablante. Tout le gouvernement est présent, ainsi que les dirigeants de l’administration publique et des sociétés d’État, dont certains sont des éminents membres de la CRC. À un journaliste qui s’étonne de la présence de voitures appartenant à l’État, un ministre rétorque : « Azali n’est pas seulement candidat, il est également président. »
L’animateur du meeting répète à l’envi : « Azali sera élu dès le premier tour, ce sera un coup KO » – une formule devenue incontournable en Afrique, notamment lorsque le président sortant est candidat à sa propre succession, et qui annonce parfois des fraudes électorales. Ses soutiens rêvent d’un remake de l’élection présidentielle de 2019 : il avait été déclaré élu dès le premier tour avec plus de 60 % des voix lors d’un scrutin entaché d’irrégularités. Les missions d’observation de l’Union africaine et du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (Comesa) avaient indiqué, dans une déclaration commune, ne pas pouvoir « se prononcer de façon objective sur la transparence et la crédibilité du scrutin ». Une crise postélectorale s’était ensuivie, qui avait fait trois morts1.
Abdillah Ahmed Ali, soutien du candidat-président, assure que ce dernier sera élu dès le premier tour grâce à un bilan « favorable ». « L’engagement du président envers la régularité des salaires des fonctionnaires a été une priorité, ce qui a assuré une stabilité financière aux travailleurs du secteur public. Il a lancé et supervisé divers chantiers à travers le pays, en mettant un accent particulier sur les projets routiers. Ces initiatives visent à améliorer la connectivité et à stimuler le développement économique », argue-t-il. Interrogé sur son bilan, Azali Assoumani indique que sa plus grande réussite est « le maintien de la paix et de la sécurité ».
L’alliance présidentielle conspuée
Pour les autres candidats, la campagne a débuté un peu plus tard, le 1er janvier – sans doute par manque de moyens. Ce jour-là, le candidat du Juwa s’est rendu à Anjouan, la deuxième île de l’archipel d’où est originaire Sambi. Salim Issa Abdillah a été chaudement accueilli par les militants et sympathisants du Juwa à l’aéroport de Ouani. Mais la marche sur la voie publique a été rapidement dispersée par les gendarmes, qui ont fait usage de gaz lacrymogènes – une répression qui a été suivie en direct sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué de presse, la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) avait paru vouloir justifier l’usage de lacrymogènes en précisant que « les marches sur la voie publique [étaient] strictement interdites » - un communiqué diffusé seulement début janvier. En réalité, elles ne le sont que si elles sont organisées par l’opposition...
L’intervention de la force publique n’a toutefois pas empêché la tenue du meeting au stade Missiri, à Mutsamudu, chef-lieu de l’île, au cours duquel Salim Issa Abdillah a bandé les muscles. Le candidat promet notamment « la libération des prisonniers politiques » (dont Sambi) et « le retour de la présidence tournante à Anjouan »2.
Depuis lors, la configuration de la campagne a changé du tout au tout. Le terrain est désormais occupé par l’opposition. Des vidéos virales montrant l’alliance de la mouvance présidentielle vilipendée dans la rue se multiplient. Cela a commencé à Anjouan, dans la petite localité de Bazimini. Puis cela s’est poursuivi en Grande Comore, dans les localités d’Ouzio et de Chezani. Des affrontements ont eu lieu entre les partisans d’Azali et ceux de l’opposition à Ntsoudjini (le fief de Mouigni Baraka Saïd Soilihi) et à Mkazi. « C’est vrai, nous avons été chassés de Chezani, nous n’avons même pas pu accomplir la prière du vendredi dans la sérénité, mais ce sont des jeunes manipulés. Je les préviens : les agressions ne resteront pas impunies », a réagi le 8 janvier le président-candidat lors d’une conférence de presse à Beit-Salam (le palais présidentiel).
Boycotter ou pas ?
Les Comores, dont 45 % de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté, selon la Banque mondiale, sont confrontées à une inflation à deux chiffres (12,5 % en décembre 2023, selon l’Institut national des statistiques), à une éducation moribonde (les enseignants du public font grève depuis plusieurs semaines), à des problèmes énergétiques, à des pénuries cycliques d’eau, à une détérioration du système de santé et un rétrécissement de l’espace civique. Un tableau sombre, qui ne joue pas en faveur d’Azali.
Toutefois, malgré la percée de l’opposition, dans les zones rurales notamment, sa force de frappe est altérée. Outre l’emprisonnement de Sambi et l’exil de plusieurs responsables politiques contraints de quitter le pays après la crise postélectorale de 2019, à l’instar de Saïd Larifou, et de Hassan Hamadi, gouverneur de la Grande Comore de 2016 à 2019, elle part désunie dans cette bataille électorale. Certains mouvements appellent par ailleurs au boycott. Un débat qui touche même le parti Juwa, partagé entre ceux qui veulent participer à l’élection et ceux qui s’y opposent, parmi lesquels figurent Me Mahamoudou Ahamada, qui fut le candidat du mouvement lors de la présidentielle de 2019, ou encore Ahmed Hassan El-Barwane, le secrétaire général du mouvement.
Le 9 janvier, le mouvement pro-boycott a appelé à une grande manifestation. Mais celle-ci a été interdite. Les journalistes présents pour couvrir la manifestation ont été chassés de la place de l’Indépendance par les forces de l’ordre qui étaient déployées dans la capitale. Plus tôt dans la matinée, Achmet Saïd Mohamed, leader du mouvement Hury dont la candidature a été invalidée, avait été interpellé. « C’est un enlèvement. Nous ne savons pas où il se trouve. Ils l’ont pris alors qu’il revenait chez lui après avoir déposé ses enfants à l’école », s’est écrié un membre de sa famille. La veille, Azali avait mis en garde les partisans du boycott : « Ceux qui veulent boycotter peuvent rester chez eux ou aller en France. » Au lendemain de sa réélection contestée, en 2019, une partie de la diaspora qui vit en France avait organisé plusieurs manifestations, à Paris et à Marseille notamment.
La crainte d’un scrutin joué d’avance est grande, Azali Assoumani contrôlant les instances chargées de valider les résultats. Le 11 janvier, les cinq candidats de l’opposition ont eu toutes les peines du monde à obtenir les accréditations de leurs représentants dans les bureaux de vote. Pour cela, il ont dû camper plusieurs heures devant les locaux de la Ceni. Ils dénoncent par ailleurs des irrégularités - ils exigent notamment que les listes des membres des bureaux de vote soient renouvelées. « Un membre de bureau de vote doit avoir un bac +2 et beaucoup ne répondent pas à cette condition », indiquait le 11 janvier Ali Mmadi, du Juwa.
Un « maigre bilan »
Durant cette campagne, les débats portent essentiellement sur l’issue du scrutin et sur la possibilité d’un second tour. « Les moyens déployés par le pouvoir en place pour contrôler ces élections témoignent de la faiblesse générale de son électorat. Le maigre bilan de ce pouvoir, la régression démocratique, le retournement de ses principaux alliés, y compris en interne [des barons de la CRC ont été exclus pour s’être présentés aux élections gouvernatoriales alors qu’ils n’étaient pas investis par le parti, NDLR] et le rejet manifeste de la population, y compris de la diaspora, sont autant de raisons qui militent pour un second tour. À condition d’une élection libre, ouverte et transparente », avance l’experte en gouvernance Nadia Tourqui.
Selon elle, « les dernières élections que l’on peut considérer comme régulières sont celles de 2016, lorsqu’Azali Assoumani avait obtenu 14,9 % des voix au premier tour, derrière Mouigni Baraka Said Soilihi [15 %] et Mohamed Ali Soilih [17,6 %] ». Azali ne l’avait emporté au second tour (avec 41,43 % des voix contre 39,66 % pour Mohamed Ali Soihili et 18,81 % pour Mouigni Baraka) qu’avec l’appui conséquent de Sambi et de Daoudou Abdallah Mohamed.
Même si Azali a de nombreux atouts en main, dont les moyens de l’État et le contrôle des instances électorales, le camp du président sortant n’est pas des plus sereins. Dans chacun de ses meetings, avant de prendre la parole, Azali feint d’égrener un chapelet en psalmodiant : « Azali nabaki », non sans avoir demandé à ses militants de répondre : « Amin ».
L’ancien militaire, qui est arrivé pour la première fois au pouvoir en 1999 par un putsch, ne se contente pas de demander à Dieu de le maintenir. Il s’en donne aussi les moyens. Ainsi, le 7 décembre, dix jours avant le début officiel de la campagne électorale, Azali a brutalement mis fin aux fonctions de Harimia Ahmed, la présidente de la section constitutionnelle et électorale de la Cour suprême, l’organe chargé de valider en dernier recours les résultats des élections. « Elle a commis un acte répréhensible, cette décision a été prise en concertation avec la Cour suprême, je n’en dirai pas plus car toute vérité n’est pas bonne à dire », a justifié le président-candidat. Ahmed Ali Amir, le coordinateur de la communication présidentielle, argue de son côté que « la nomination des membres de la Cour suprême relève de la compétence constitutionnelle du président ». Contactée, l’ancienne bâtonnière du barreau de Moroni a refusé de commenter cette décision.
Quel rôle pour l’armée ?
Peut-on imaginer un coup de force du pouvoir ? Avant le double scrutin, beaucoup de citoyens et de candidats se demandaient quel rôle jouerait l’armée. Azali, qui était chef d’état-major avant de prendre le pouvoir par les armes, en 1999, a toujours pu compter sur ses frères d’armes. Durant la campagne, il a indiqué que, le jour du vote, « la police et la gendarmerie seront à proximité des bureaux de vote », mais aussi que l’armée sera positionnée « pas loin, au cas où ». « Comment cela se fait-il qu’un candidat se permette de s’immiscer dans la gestion des élections !? Nous connaissons son objectif, nous irons jusqu’au bout. Les militaires peuvent venir dans les bureaux en étant bien armés. Nous prendrons le peuple et l’opinion internationale à témoins », a réagi Salim Issa Abdillah.
« Azali a toujours pu compter sur l’AND [Armée nationale de développement] pour prendre le pouvoir et s’y maintenir, notamment en corrompant des officiers, explique un officier à la retraite. Le pouvoir pourrait très bien tenir un discours officiel devant tous les acteurs de la sécurisation des élections, y compris les militaires, tout en envoyant des officiers sur le terrain pour des missions parallèles ».
Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables).
 Faire un don
Faire un don
Les articles présentés sur notre site sont soumis au droit d’auteur. Si vous souhaitez reproduire ou traduire un article d’Afrique XXI, merci de nous contacter préalablement pour obtenir l’autorisation de(s) auteur.e.s.
1Trois hommes vraisemblablement tués dans un camp militaire à la Grande Comore, dans des circonstances non élucidées.
2La Constitution adoptée en décembre 2001 prévoyait qu’un représentant de chacune des îles accède tous les quatre ans au poste de président du gouvernement. Son article 13 stipulait : « La Présidence est tournante entre les îles. Le président et les vice présidents sont élus ensemble au suffrage universel direct majoritaire à un tour pour un mandat de quatre ans renouvelable dans les respect de la tournante entre les îles ».
3Trois hommes vraisemblablement tués dans un camp militaire à la Grande Comore, dans des circonstances non élucidées.
4La Constitution adoptée en décembre 2001 prévoyait qu’un représentant de chacune des îles accède tous les quatre ans au poste de président du gouvernement. Son article 13 stipulait : « La Présidence est tournante entre les îles. Le président et les vice présidents sont élus ensemble au suffrage universel direct majoritaire à un tour pour un mandat de quatre ans renouvelable dans les respect de la tournante entre les îles ».