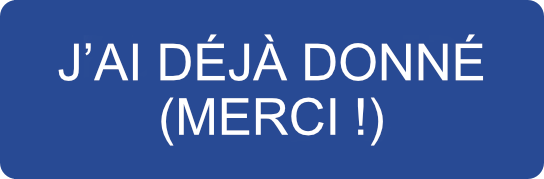La guerre en Ukraine et les sanctions infligées à la Russie ont, par effet domino, des conséquences majeures sur les économies nationales à travers le monde. Au premier rang de celles-ci, la flambée des prix des produits alimentaires qui font courir le risque d’un soulèvement populaire comparable aux émeutes de la faim et au Printemps arabe qui ont touché l’Afrique et le Moyen-Orient entre 2008 et 2012. Le prix du blé a atteint des sommets, le 14 mai 2022, après l’embargo indien sur les exportations privées. Des doutes subsistent sur la capacité du Cameroun à s’approvisionner en blé sur le marché international.
Cette situation doit nous pousser à prendre les devants pour faire des propositions pragmatiques en vue de structurer une économie résiliente sur le long terme. Dans cette perspective, l’exploration des pâtisseries à base de farines locales apparaît comme une piste intéressante en raison de l’envolée des prix du blé et de son impact sur la balance commerciale. Ces farines dites « locales » proviennent principalement des céréales (sorgho, millet, maïs, fonio, riz), légumineuses (cornille1, pois de terre), tubercules (manioc, patate, igname, taro, macabo), fruits (banane, plantain, citrouille, potiron) et feuilles légumières (feuilles de baobab, moringa, corète potagère, manioc).
Produits interdits à l’exportation
Au même titre que le blé, les intrants agricoles se font de plus en plus chers sur les marchés internationaux. Leurs prix ont connu, eux aussi, une hausse spectaculaire. En cause une fois de plus, l’invasion de l’Ukraine, qui se passe à des milliers de kilomètres. Pour rappel, la Russie était, en 2021, « le premier exportateur d’engrais et le deuxième fournisseur d’engrais potassiques et phosphorés », rapporte l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). De plus, les engrais azotés ont pour ingrédient principal le gaz, dont la Russie est également le premier producteur mondial. Il faut, en raison de cette pénurie, s’attendre à des baisses importantes de productions sur les deux prochaines années, ce qui aura un impact considérable sur tous les secteurs de l’économie.
L’engouement observé, en ce moment, pour les farines locales, notamment dans la fabrication du pain, qui coûte relativement cher — 500 francs CFA les 250 grammes (environ 76 centimes d’euros) -, pourrait donc s’estomper à mesure que sera mis à mal le pouvoir d’achat des Camerounais avec les difficultés économiques qui se précisent de plus en plus.
En conséquence, il n’est pas étonnant que les farines locales figurent dans la liste des six produits interdits à l’exportation par le ministère du Commerce, comme l’atteste une note confidentielle datée du 22 avril 2022. En plus de cette mesure préventive, il serait stratégique que l’État du Cameroun recommande aux boulangeries, comme c’est déjà le cas au Nigeria voisin, l’incorporation de 10 % de farines locales dans la fabrication du pain. L’enrichissement du pain de blé aux farines locales avait déjà été suggéré, en 2010, par l’ingénieur-agronome et activiste Bernard Njonga (1955-2021). L’occasion ne s’y prête-t-elle pas enfin ?
Makala à tout-va
Il est vrai qu’on trouve très peu d’informations sur les pâtisseries dans les traditions culinaires africaines en général, et camerounaises en particulier. Ce sujet mérite donc d’amples investigations. Selon une idée reçue, les gâteaux, les beignets et tout ce qui se rapporte à ces spécialités n’auraient été introduits que récemment, sans doute au XXe siècle avec la colonisation. Pour autant que cela soit vrai - les études ultérieures nous en diront certainement plus -, il conviendrait de rappeler que, tout comme la langue, la cuisine est dynamique, c’est-à-dire qu’elle est toujours influencée par d’autres. En ce sens, elle se caractérise notamment par les emprunts culinaires qui résultent des contacts entre les peuples. Il est probable que les populations aient adopté certaines pâtisseries venues d’Europe, d’Amérique et d’Asie, mais que celles-ci aient par la suite été adaptées. À partir de cet instant, il est logique de parler de pâtisseries camerounaises.
Nous connaissons probablement tous une pâtisserie camerounaise, considérée comme telle soit parce que son gastronyme vient d’une langue nationale, soit parce que la matière première servant à sa fabrication est issue d’un produit local. L’une des pâtisseries les plus connues est sans aucun doute le pain kumba (kumba bread en anglais), fait entièrement ou en partie avec de la farine de patate, de la margarine et du sucre. Comme son nom l’indique, ce pain de mie de la forme d’une briquette vient de la ville de Kumba, dans la région du Nord-Ouest. Il faut savoir que ce pain de mie est la variante de l’agege bread, introduit au Nigeria par le Jamaïcain Amos Shackleford, d’après le documentaire Where Did Agege Bread Come From ? (voir ci-dessous), tout en étant très exactement, à la base, un gâteau chinois fait à partir du tangzhong, un roux de farine cuit à l’eau ou au lait.
Les beignets, encore plus connus sous le terme générique de makala, avec des variantes telles que makara, akara ou akala, sont les pâtisseries locales qu’on rencontre le plus, et ce sur toute l’étendue du territoire. Entre autres, nous avons les beignets de manioc, d’igname, de maïs, de banane, de riz, de sorgho, de millet, de cornille, mais également de blé. Ces beignets s’accompagnent de produits alimentaires très divers, notamment le haricot et la bouillie, dont les recettes se déclinent à l’infini. Qui, dans les grandes villes camerounaises, peut prétendre ne pas connaître le beignet-haricot-bouillie (BHB) ? Cette spécialité urbaine est une institution nationale au point que Tchop et Yamo, un célèbre fast-food, en a fait un incontournable de sa carte.
Nakiya, gourassa, alkoubouss...
Mais force est de constater que la plus grande diversité de beignets possible s’observe davantage dans le nord du Cameroun. Dans les trois régions septentrionales, la consommation de beignets est fortement ancrée dans les habitudes alimentaires des populations, chez les Peul, les Kanouri et les Haoussa - pour ne citer que celles-ci. Pour ces derniers, les farines n’ont plus aucun secret en pâtisserie.
On distingue en haoussa le massa/maché, qui désigne une galette de riz épaisse, le waïna, un petit gâteau à base de farine de riz ou de mil, d’œufs et de lait. Dans les habitudes, cependant, ces mots renvoient d’un côté spécifiquement à un crumpet (une sorte de pancake) de riz fermenté, et de l’autre à tout beignet de sorgho, de millet ou de blé. On peut dénombrer une dizaine de pâtisseries, dont les plus connues sont probablement : le kossaï, beignet de niébé ou de cornille ; le tsatsafa, fleur de lotus, à base de farine de céréale ; le dan wanké, gnocchi de cornille, de farine de céréale ou de manioc habituellement enrichie de poudre de feuilles de baobab ; le sinasir, pancake de riz fermenté ; l’alkaki, nœud généralement glacé au sirop, à base de farine de céréale ; l’awara, tofu frit, à base de soja fermenté ; le fankasou, « tore », à base de farine de céréale ; le douboulan, merveille généralement glacée au sirop, à base de farine de céréale ; le nakiya, sablé à base de farine de céréale épicée torréfiée et de miel ; l’alkoubouss, mantou à base de farine de céréale ; le gourassa, naan à base de farine de céréale...
Le Cameroun est riche de plusieurs dizaines de pâtisseries locales. Il est donc crucial de faire connaître ce patrimoine culinaire au plus grand nombre de Camerounais. En effet, elles mériteraient d’être portées, avec leur nom d’origine, à l’attention du public, des gastronomes et des chefs cuisiniers. On devrait, puisque la crise du blé nous en donne l’occasion, leur accorder une place importante dans les émissions radiotélévisées et dans les livres de cuisine, dans les écoles de formation en restauration, dans les réceptions gouvernementales et, surtout, dans les vitrines des boulangeries-pâtisseries.
Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables).
 Faire un don
Faire un don
Les articles présentés sur notre site sont soumis au droit d’auteur. Si vous souhaitez reproduire ou traduire un article d’Afrique XXI, merci de nous contacter préalablement pour obtenir l’autorisation de(s) auteur.e.s.